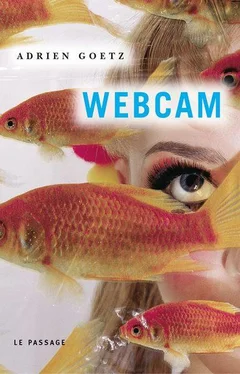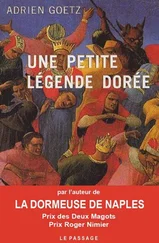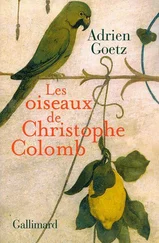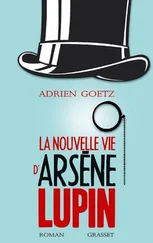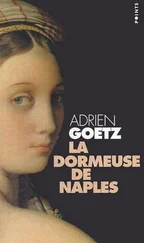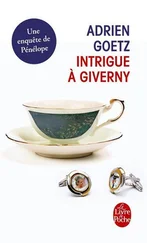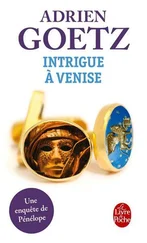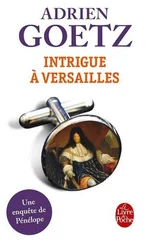« Il faudrait que tu reviennes. Je n’aime pas ton Cérisoles. Magnac t’attend.
— Tu veux dire, que je revoie, avant de mourir, notre feu dans la cheminée. Adieu notre petite table ?
— C’est la maison que tu as peinte, la chambre de tes œuvres, avec notre lit, notre canapé, le cabinet aux mosaïques, la chapelle de la croix du Temple.
— Mort tout cela, mon Isabelle, mort comme moi aujourd’hui. Je t’ai juré que je n’y reviendrais plus lorsque nous nous sommes séparés. Ensuite tu m’en as toi-même chassé. Souviens-toi.
— Sombre vieillard, égocentrique, baveux, c’est lui qui est mort, notre fils, toi tu vis. Tu ne vois que ta mort, à toi, depuis toujours. Tu n’as jamais pensé qu’à ta mort. Tu sais qu’il venait souvent à Magnac, il aimait la maison, notre maison, lui, il y avait grandi. Il y vivait. »
C’est vrai que nous n’y vivions pas. Nous nous y torturions.
Je l’enfermais au grenier quand elle n’avait pas été sage. J’étais un ogre qui dévorait la petite fille, ou qui ne la dévorait pas, qui la laissait attendre, se dévorer de peur, de peur de n’être pas aimée, pas prise, pas regardée.
Nous nous étions partagé l’île déserte. Elle voulait m’envahir. Je voulais la rendre esclave. Puis elle a été enceinte. Je suis parti.
Je l’ai laissée neuf mois seule. Elle ne m’en voulait pas. J’ai organisé pendant ce temps la galerie de Manette. Notre association a été fondée, avec ma petite galeriste, la seule de mes femmes que j’avais intérêt à garder. La plus intelligente. Celle qui ne me fatiguait pas. Elle avait compris qu’elle et moi étions faits pour tuer. Je n’ai jamais touché Manette — et elle n’en a jamais manifesté le moindre désir. Déjà ça. Nous traitions de puissance à puissance. Quand Manette venait à Magnac, Isabelle se cachait. Manette restait dîner. Elle venait avec une petite camionnette pour emporter les toiles. Nous faisions croire aux acheteurs, aux journalistes, aux critiques, aux amis, que je ne résidais pas à Paris. J’y étais très souvent. Je suis devenu, à cette époque, l’inaccessible, l’intouchable, l’artiste à l’écart des modes et des courants qui, seul, au centre de la forêt de Vercingétorix, peint des arbres et des fleuves, sans parler. Et des nus, toujours du même modèle, dans les mêmes poses obsédantes, avec une lumière d’Enfer et de cachot.
Il fallait, à Paris, régler les modalités du divorce avec Eugénie, surtout, monter la galerie comme une machine de guerre. Je me cachais des journalistes. Je donnais à tous ceux que je voyais l’impression que j’étais une sorte de bûcheron gentilhomme, venu, par force, pour vingt-quatre heures, et qui n’avait rien à dire. « Je scie, moi-même, les planches de mes panneaux, je les prépare comme au XIII e siècle, je ne laisse ce soin à personne d’autre. Ce bleu, c’est dans un traité d’alchimie de la Renaissance que j’en ai trouvé la recette, ces ombres, c’est Carel Van Mander qui explique comment on les obtenait, au XVI e siècle. » Cela changeait des ratiocinations habituelles des artistes. Mes sornettes trouvaient preneur tout de suite. Contre ceux qui me traitaient de réactionnaire, de petit maître dépassé qui n’apportait rien à la peinture, je répondais que Picasso et Nicolas de Staël avaient eu certains de mes nus dans leur collection personnelle, et que mes œuvres-phrases avaient été citées par Breton. On me comparait à Kurt Schwitters que je ne connaissais même pas de nom et la cote commença à grimper. La presse artistique est bovine. Ils ruminent ce qu’on leur donne. Ils broutent tous dans le même champ, qu’on leur montre. Quand on propose de l’herbe à l’un, tous viennent demander leur part. Je n’ai pas eu beaucoup de peine à orchestrer, avec la complicité de Manette qui rêvait depuis longtemps de monter un coup avec un artiste tout à elle, mes premiers vrais succès.
La semaine de la naissance de Virgile, je restais à Paris pendant qu’Isabelle était à la clinique, à Limoges. La veille de ma première exposition dans la galerie de Manette (qui n’aime rien tant que de raconter cette aventure semi-légendaire), j’ai filé chercher mon fils et ma femme. Je voulais qu’à deux jours, mon fils soit là pour le premier triomphe de son père. Je crois qu’Isabelle n’avait jamais été aussi heureuse. Elle ne voyait même pas que je lui volais son triomphe à elle. Son enfant. C’était la première fois que je venais vers elle. J’ai roulé toute la nuit. En arrivant, j’ai vu qu’Isabelle se reposait, elle avait pris le bébé dans la chambre, avec elle.
C’est Jeanne, la fille qui tient aujourd’hui encore la maison, qui est venue m’ouvrir. C’est avec elle que j’ai fait l’amour toute la matinée en attendant que ma femme se réveille avec les cris de mon fils. Jeanne avait accouché un mois plus tôt, elle aussi, et n’avait pas fait l’amour depuis. Je me souviens de ce curieux sentiment, de ce désir d’elle parce qu’elle était mère et de la certitude que je n’aimerais plus jamais physiquement Isabelle. J’avais aimé une jeune fille. La mère de mon enfant me dégoûtait. Je crois que c’est une réaction assez fréquente chez les hommes. Plusieurs amis m’ont raconté comment ils s’étaient forcés pour revenir vers leur femme, pour éviter l’enfant unique, pas pour le plaisir. Moi je n’ai jamais su me forcer.
Nous avons pris la voiture après le déjeuner. Mon fils et moi à l’avant, Isabelle derrière. Le couffin sur le siège à côté de moi. J’ai conduit comme un fou. Sur les routes du Limousin, nous frôlions le précipice à chaque tournant. À six heures du soir, nous étions à la galerie. Tout le monde s’est levé pour applaudir. C’est ainsi que mon fils a appris la célébrité — à prendre pour lui les hommages qui ne sont dus qu’au génie de son père.
Isabelle s’est installée une semaine dans la maison de Paris, dans les meubles d’Eugénie, et je l’ai envoyée par précaution consulter le psychiatre de ma première belle-mère. Elle n’était pas encore complètement folle, j’avais ainsi la garantie qu’elle le deviendrait plus promptement. Je voulais la garde de l’enfant. Je ne pouvais plus peindre Isabelle, plus la voir. L’urgence était de me débarrasser d’elle, quitte à ne plus revoir Magnac.
À Split, je n’écoutais pas Isabelle. Je la regardais. Je voyais la vieille femme aux cheveux blancs et je pensais à la jeune fille que j’avais autrefois, pour la première fois, pour moi, pour lui apprendre, forcé à me faire l’amour.
J’en oubliais de prêter attention à cette maison splitoise où je n’avais pas remis les pieds. Je ne me souviens de rien, que de la toile cirée de la table devant laquelle nous nous sommes assis et du paquet de photos de Magnac qu’elle avait apporté. C’est étonnant d’être à ce point aveugle à la maison de son enfance. Elle était vide, mais c’est comme si je n’avais pas cessé d’y vivre. Je n’y voyais que le cadre familier de toute ma vie. Une maison que je n’avais pas voulue, pas achetée, pas meublée : ma maison où rien n’était encore à moi.
Pauvre Isabelle, encore une fois, le soir de l’enterrement de notre fils, je l’abandonnais, mais désormais, Dieu m’est témoin, je ne lui voulais aucun mal. Le soir, avant de quitter Split, m’étant assuré qu’elle reprenait un avion, je me suis rendu, sous la pluie noire, dans la rotonde du palais de Dioclétien. Je me suis allongé sur la dalle trempée, je me suis obligé à maintenir les yeux ouverts, sous les étoiles et sous la pluie. Au retour à l’hôtel, un bain brûlant. J’ai fait réserver un avion pour Paris. J’avais tout compris, déjà, en voyant les photos : il manquait une pièce, dans notre demeure, qu’Isabelle ne me montrait pas.
Читать дальше