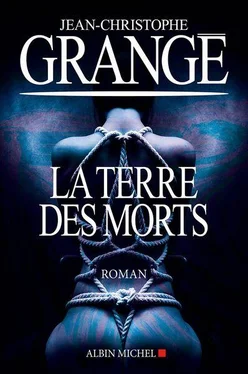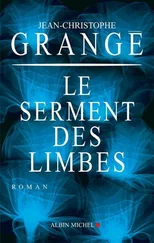Pourtant, les oiseaux chantaient dans les feuillages et la lumière du crépuscule baignait le tableau dans une clarté très douce, couleur de pulpe d’orange. Vraiment pas le décor pour une perquise tendue à bloc.
Le serrurier gravit les quelques marches qui conduisaient au perron protégé et s’attaqua à la nouvelle serrure.
— Même pas blindée, commenta-t-il avec mépris.
Corso monta à son tour la volée de marches. Ça ne collait pas : si Sobieski avait mené là une quelconque activité occulte ou laissé des indices compromettants, il aurait installé un système de sécurité drastique. Corso n’avait pas oublié comment il s’était fait niquer par les caméras invisibles de l’atelier. Outre le camouflage « petit-bourgeois » du lieu, le peintre-tueur aurait opté pour un dispositif inviolable.
La porte ouverte libéra une odeur atroce de moisi qui les fit reculer de plusieurs pas.
— Ça pue là-dedans ! grogna le serrurier en agitant la main. Personne a foutu les pieds ici depuis des lustres, moi j’vous le dis.
Les flics échangèrent un regard. Tout ce qu’ils avaient finalement, c’était un pavillon loué par une boîte qui s’appelait Thémis et dont le siège social se situait chez Sobieski. S’étaient-ils encore plantés ?
Corso était sur le point de céder au dépit quand son regard se posa sur le garage mitoyen presque aussi grand que le pavillon, au bas mot cent cinquante mètres carrés au sol.
— Ouvrez-moi ça aussi, ordonna-t-il en désignant le local.
L’artisan descendit les marches et s’attaqua à la porte pivotante. Aussitôt, il émit un sifflement d’admiration.
— Qu’est-ce qui se passe ? demanda Corso en s’approchant.
— Bah là, mon gaillard, c’est une autre histoire. Y z’ont installé un système de sécurité comme on n’en voit pas souvent.
Malgré lui, Corso prit la main de Barbie. Ils avaient trouvé. Le putain de repaire d’un tueur en série qui semblait insaisissable. Les deux flics choisirent de garder leur sang-froid et allèrent s’installer sous les arbres. Ils s’assirent sur un banc, comme dans un jardin public, et prirent leur mal en patience. Le serrurier les avait prévenus, « au moins une demi-heure ».
Par téléphone, ils suivaient l’évolution de la seconde équipe, maintenant en poste aux abords de l’atelier de Sobieski. Le peintre était chez lui. Stock, qui pouvait l’apercevoir à travers une des verrières, confirma qu’il était en train de préparer des toiles comme si de rien n’était. Encore une fois, Corso le revit rôder dans le quartier homo de Blackpool, puis l’image du cadavre au cri flottant lui revint — le sang-froid du salopard forçait l’admiration.
Il leur ordonna d’attendre encore : s’ils trouvaient vraiment des éléments confondants dans ce nouveau local, l’arrestation n’en serait que plus belle.
Enfin, à près de 22 heures, alors que la nuit était tombée, le serrurier — il avait appelé un assistant — vint à bout de la porte du garage. Corso leur intima de reculer et, accompagné de Barbie, il pénétra dans l’espace. Il n’avait qu’une torche à la main — avec son attelle, pas moyen de tenir à la fois une lampe et une arme —, alors que son adjointe braquait son calibre en soutien.
Il ne voyait pas grand-chose, mais déjà les formes, les objets, les ombres dans son faisceau lumineux lui laissèrent craindre le pire — ou le meilleur, c’était selon.
— Va chercher des protège-chaussures, des charlottes et des gants, ordonna-t-il à Barbie d’une voix blanche.
La petite souris détala, alors que Corso, raide comme une clôture électrifiée, demeurait sur le seuil. Il balayait lentement les lieux de sa torche. Pas de fenêtre. Un comptoir le long du mur de gauche. Un plan de travail en bois au milieu de la pièce — Corso se souvenait de l’hypothèse du légiste, « l’étal d’un boucher », et des échardes dans la chair d’Hélène Desmora. Sur le sol, des pots de produits chimiques qui exhalaient des odeurs acides. Plus loin encore, il discerna un engin colossal, une sorte de caisson en métal doté d’un hublot qui pouvait largement accueillir un être humain…
Barbie revint avec le matos demandé. Ils s’équipèrent sans un mot, puis Corso fit un pas à l’intérieur et chercha un commutateur. Sous la lumière électrique, les choses se précisèrent et les deux flics surent qu’ils avaient trouvé.
Rien que du lugubre, de l’abject et de l’effrayant. Avec ses esquilles de bois et ses traces sanglantes, le plan de travail évoquait beaucoup plus le billot d’un boucher que l’établi d’un artiste. Surtout, une presse dotée d’une molette de serrage y était fixée — pas besoin d’une grande imagination pour visualiser une victime placée de profil, la tête coincée dans cet étau.
Le comptoir sur la gauche présentait tout un tas d’outils qui pouvaient servir à un peintre montant ses toiles lui-même mais qui, dans ce contexte, s’avéraient beaucoup plus funestes, surtout que la plupart portaient des traces brunes. Du sang ?
En s’en approchant, le flic buta contre un carton posé par terre. Il baissa les yeux : il était rempli de pierres. Exactement le même genre de galets que ceux qui obstruaient la gorge de Sophie et d’Hélène. Les tremblements de Corso étaient devenus brefs et constants, comme s’il marchait au 220 volts. Il aurait voulu dire quelque chose, ou peut-être simplement respirer, mais tout ça devenait foutrement difficile.
Barbie de son côté inspectait l’établi fixé au mur et détaillait chaque instrument. Deux visiteurs dans un musée s’extasiant chacun sur des œuvres différentes, mais prisonniers d’une émotion commune.
Sans se concerter, ils se dirigèrent vers le caisson du fond. C’était une chambre aux parois d’inox équipée sur sa façade centrale d’un système de commande compliqué.
— On dirait un four…, murmura Barbie, confirmant d’emblée la pensée de Corso.
— Appelle l’IJ, ordonna-t-il d’une voix altérée. Je veux toute la cavalerie ici dans moins d’une heure.
Barbie s’exécuta. Stéphane poursuivit sa visite. Il cherchait encore le signe indiscutable de la présence de Sobieski. Après tout, rien ne disait concrètement que cette chambre de torture était celle du peintre.
À ce moment-là, il repéra, affichées tout au bout de l’établi de gauche, plusieurs reproductions maculées de peinture, des œuvres des grands maîtres de la peinture espagnole : Vélasquez, Le Greco, Zurbarán… Parmi elles, sans surprise, il reconnut les Pinturas rojas de Goya.
Le détail qui lui manquait.
Il attrapa son téléphone et appela Stock :
— On arrive dans cinq minutes. On tape avec vous.
— Y a du nouveau ?
— On a trouvé le repaire du monstre.
— Ça va ? T’es bien installé ?
Sobieski, tête nue, ne répondit pas. Assis dans le bureau de Barbie et de Ludo, il semblait avoir saisi que les choses se gâtaient vraiment pour lui. Il devait aussi avoir intégré que la proximité de Ludo ne l’aiderait pas. Au contraire .
Il était si pâle que son visage ressemblait à un moulage de plâtre, uniformément blanc et inexpressif. Corso connaissait ce masque. Ce n’était ni celui de la culpabilité, ni celui de la crainte. Sobieski portait l’expression de la terreur — celle d’une phobie réveillée : la taule se rapprochait, et pour de bon.
Corso, un mince dossier à la main, prit place derrière le bureau de Barbie. La fliquette se tenait debout dans un coin de la pièce, la main sur le calibre. Stock et Ludo étaient aussi présents, silencieux, fermés, aussi compacts que des blocs de propergol. L’air était chargé d’une tension presque insoutenable. On avait fini de rire. Si tant est qu’on ait ri un jour dans cette histoire.
Читать дальше