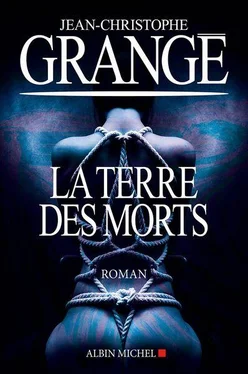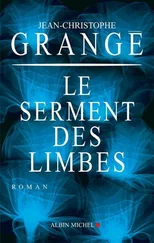Pour l’heure, son analyse était rudimentaire. Jacquemart lui avait répété que Sobieski était un psychopathe, un tueur asocial incapable de pitié et d’empathie. Ses dix-sept années de prison avaient sans doute aggravé ce comportement. Il ne se souciait plus de ce qui pouvait se passer « hors les murs » de son atelier. Seule comptait l’œuvre. Et l’ex-taulard était prêt à tout pour avoir le bon sujet, pour que le monde s’accorde à ce qu’il avait en tête, à ce qu’il voulait coucher sur la toile.
Au fil des années, la peinture s’était insinuée dans son cerveau pour devenir, en quelque sorte, l’arme du crime. Ou du moins l’inspiration du meurtre. Homicide et peinture se confondaient dans son esprit malade. La victime choisie n’était que le brouillon de l’œuvre à venir.
En attendant les bleus, Corso n’avait pas cherché à discuter avec Sobieski, il ne voulait surtout pas gâcher son interrogatoire. Il se doutait par ailleurs que le peintre ne lui répondrait pas.
Allait-il se mettre à table au 36 ?
Aucune chance.
Ce dont Corso était sûr, c’était que Sobieski était un coupable hors normes. Il connaissait la loi, les rouages des procédures et, pire encore, le monde des médias. Il allait s’en donner à cœur joie pour proclamer son innocence et crier au harcèlement. Il n’aurait aucun mal à rameuter le bataillon de ses supporteurs : artistes, intellos, politiques, tous ceux qui l’avaient fait sortir de prison et qui allaient se battre aujourd’hui pour qu’il n’y retourne pas.
Quand les deux-tons des flics avaient résonné dans la cour pavée, Philippe Sobieski s’était fendu d’un rire silencieux et noir, découvrant ses chicots à la manière des Japonaises des temps anciens qui avaient les dents laquées.
Son visage n’avait plus aucune profondeur, juste un masque.
— Tu fais la pire connerie de ta vie.
— T’as bien compris la situation ? lui demanda Corso une demi-heure plus tard dans son bureau du 36.
Affalé sur la chaise des suspects, Sobieski regarda les quatre murs, s’attarda sur celui qui était mansardé, puis sur la lucarne bardée de grillage — depuis le suicide de Richard Durn, la norme désormais à la BC.
— Faudrait que je sois vraiment distrait.
— T’es parti pour passer l’autre moitié de ta vie au trou.
Le peintre haussa les épaules. Pour son arrivée en fanfare au 36, il avait demandé à se changer. Il avait endossé un ensemble survêtement à liserés dorés, sans doute une grande marque mais qui lui donnait l’air de ce qu’il était : un maquereau en route pour le ballon. La veste était ouverte sur son torse nu et ses chaînes en or, quincaillerie de rappeur à deux balles qui scintillait dans le jour naissant. Un borsalino en feutre gris à bandeau tigré lui dissimulait la moitié du visage.
De l’index dressé, dans un geste de caricature, il releva le bord de son chapeau et lâcha :
— Toi et moi, on vient du même monde, Corso, alors essaie pas de m’intimider ou j’sais pas quoi. La partie fait que commencer.
Corso alluma son ordinateur sans répondre.
— Nom, prénom, adresse, date de naissance, intima-t-il en ouvrant un nouveau document pour son PV d’audition.
Sobieski obtempéra d’une voix neutre. Quand Stéphane l’interrogea sur son emploi du temps les nuits des meurtres, il répéta sa première version : il avait passé la nuit du 16 au 17 juin avec Junon Fonteray et celle du 1 er au 2 juillet en compagnie de Diane Vastel.
Corso posa ses mains sur le bureau et lui parla posément, comme pour convaincre un enfant buté :
— Sobieski, il faut que tu sois raisonnable. Avec ce qu’on a découvert dans ton atelier, tes alibis ne tiennent plus.
— C’est pourtant la vérité.
— Quand Junon comprendra ce qu’elle risque dans cette affaire, elle se rétractera.
— Vous pouvez essayer de lui foutre les jetons, ça marchera pas. Cette petite a de la tête et du cœur.
Corso se souvenait surtout d’une étudiante trop sûre d’elle. Quand on lui foutrait sous le nez le tableau de Sobieski, elle se dégonflerait comme un ballon d’anniversaire.
— Prenons les choses autrement. Si t’as passé la nuit du 16 au 17 juin avec Junon, comment as-tu pu peindre un tableau de la victime après sa mort dans l’exacte position où elle a été retrouvée à la Poterne des Peupliers ? Tu as représenté les liens qui l’entravaient et la pierre dans sa gorge. Ces détails n’ont pas été diffusés, les photos de la scène de crime n’ont pas été publiées. Seul l’assassin connaît ces précisions. Qu’as-tu à répondre à ça ?
— La force de mon inspiration.
— Trouve quelque chose de plus convaincant.
— J’ai lu les articles des journaux, les infos sur le Web. Le reste, c’est de la déduction.
— T’as raté ta vocation, tu aurais dû être flic.
— Les journalistes ont raconté que la petite était ligotée avec ses sous-vêtements. C’était pas difficile de deviner qu’il l’avait attachée les mains dans le dos.
— Personne n’a jamais précisé que tous les liens étaient solidarisés et reliés à la gorge, provoquant l’étouffement au moindre geste.
— Si t’étais un peu branché SM, tu saurais que ce type d’attache est un classique.
— Personne n’a jamais dit que l’assassin était branché SM.
— T’es con ou quoi ? Le gars choisit des strip-teaseuses, il se sert de leurs sous-vêtements pour les attacher, il les défigure. On est dans le registre de la perversion ordinaire…
— Les nœuds que t’as dessinés sont exactement ceux que le tueur a utilisés.
Sobieski se fendit d’un sourire oblique.
— Ma toile est pas aussi précise. J’ai pas dessiné les nœuds. T’auras du mal à faire passer un coup de pinceau pour une preuve objective.
Corso avait envie de le baffer mais il se cramponna à son clavier pour éviter tout geste déplacé.
— Et les mutilations au visage ? Comment tu expliques que t’aies dessiné exactement les blessures infligées par le tueur ?
— Arrête ton cirque, Corso. Sur ma toile, le visage est de profil, et qu’est-ce qu’on voit au juste ? Une bouche démesurée.
— La plaie de Sophie Sereys.
— J’ai simplement pensé au Cri d’Edvard Munch. Et à mon avis, ton assassin y a pensé aussi.
— Pourquoi pas à Goya ?
— J’te vois venir… Les Pinturas rojas , justement affichées dans mon atelier.
— Justement, oui. Y a pas qu’ça, Sobieski. Ton problème, c’est que de nombreux faits te désignent comme l’assassin : tu couchais avec les victimes, tu rôdais dans les coulisses du Squonk, t’es un amateur de shibari…
— Tout ça fait pas de moi un coupable.
— Pris séparément peut-être. Mais l’ensemble commence à peser, tu crois pas ? Surtout pour un mec qu’a passé dix-sept ans en taule.
— J’ai payé et je me suis racheté.
— Ton meurtre de l’époque présente des similitudes avec ceux d’aujourd’hui et…
— Non. On en a déjà parlé. Ça n’avait rien à voir avec les sacrifices de Sophie et d’Hélène. Putain de Dieu, tu vas droit dans le mur sur cette voie-là. Tout ce que tu vas récolter, c’est des emmerdes avec tes supérieurs.
Le flic esquissa un sourire.
— Tu vas m’attaquer pour harcèlement ?
— Pas moi, Corso. Mes amis, mes soutiens, tous ceux qui se sont battus pour que je sorte de prison.
— Je suis terrifié.
Sobieski se pencha en avant. Il avait les sourcils très fins et très mobiles. Il les inclinait vers les tempes pour un oui ou pour un non, accentuant une expression de contrariété ou de consternation. Bompart appelait ça les « sourcils en toit de chiottes ».
Читать дальше