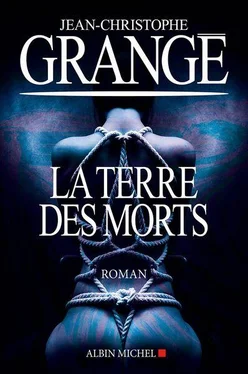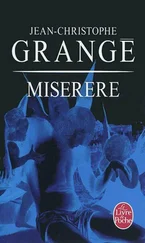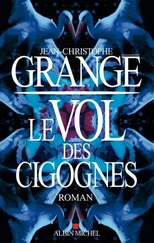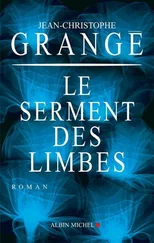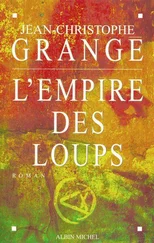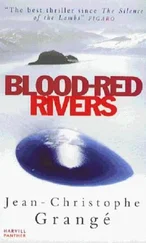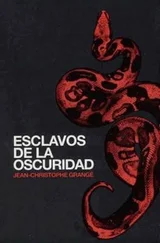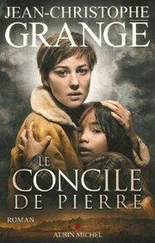Le petit Philippe est poussé dans l’escalier, roué de coups, livré à lui-même. Il disparaît régulièrement dans les forêts voisines. Arrêté plusieurs fois pour vol et vandalisme. En CM2, il ne va déjà plus à l’école. Il n’y a plus d’argent à la maison. C’est Philippe qui va chercher les allocs. Au retour, il est battu comme plâtre : Monique l’accuse d’avoir chapardé de l’argent.
Elle organise aussi un rituel : elle invite d’autres enfants du quartier pour des « goûters » très spéciaux. Les jeux tournent autour de sévices et de châtiments infligés à Philippe. Quand vient la puberté, les tortures redoublent, la mère accuse son fils d’être un obsédé sexuel, de « ne penser qu’à ça », « comme son père ». Des coups, des brûlures de cigarette, des passages à la flamme de son sexe (Monique appelle ça la « désinfection »).
Les services sociaux s’en mêlent. Le jour où l’enfant est enlevé à sa mère, à 13 ans, les résultats de sa visite médicale sont sidérants : Philippe présente de nombreux signes de malnutrition (sa peau alterne des parties dépigmentées et hyperpigmentées, il souffre d’eczéma, son ventre est gonflé ; il perd déjà ses cheveux). Par ailleurs, son corps est un catalogue de cicatrices : des marques de brûlures, d’entailles, de mutilations. Les radios montrent de nombreuses fractures mal réduites, des traumatismes crâniens : un miracle qu’il soit encore vivant — et qu’il ait toujours sa raison.
Monique Sobieski est arrêtée — elle prendra douze ans ferme —, Philippe est placé en foyer, puis en famille d’accueil dans la région de Gap. Violent, irritable, impulsif, l’enfant n’est pas un cadeau. À 15 ans, il viole une de ses sœurs adoptives, handicapée mentale, dans sa famille d’accueil.
Envoyé dans un foyer spécialisé pour les jeunes en difficulté, on essaie d’oublier ses frasques mais il tabasse un môme qui diffuse du rock dans le dortoir — on découvrira que sa mère lui infligeait ses sévices au son de Led Zeppelin, Deep Purple, The Who, Ten Years After. Sobieski ne supporte plus d’entendre une guitare saturée.
Un an plus tard, il agresse sexuellement une fille dans une cafétéria. Mineur et bénéficiant de circonstances atténuantes, on passe encore l’éponge. Nouveau centre, nouveaux problèmes. Sobieski se met à boire et vit de petits trafics. À 18 ans, il intègre un foyer de jeunes majeurs à Chambéry. À cette époque, il zone sur la région frontalière avec la Suisse, oscillant entre petits braquages et boulots de service d’ordre.
Les témoignages sont unanimes : Philippe Sobieski est un prédateur sexuel. Dans son entourage, on l’a affublé d’un surnom qui lui restera, « Sob la Tob ». Il est aussi avéré qu’il se prostitue déjà. Contrairement à ce qu’il racontera plus tard, il n’a pas attendu la prison pour devenir bisexuel.
En 1982, il est une nouvelle fois arrêté pour viol à Morteau. Condamné à cinq ans de prison, il bénéficie d’un régime de semi-liberté au bout de deux et reprend aussitôt ses activités de videur et ses trafics. À cette époque, très instable, il sévit sur toute la frontière sud-est de la France. Sobieski n’est pas à proprement parler un routard ni un punk à chien. Plutôt un voyou qui a la bougeotte, qui ne parvient même pas à s’intégrer dans son milieu hors la loi.
À partir de 1984, il « se pose » à nouveau à Besançon. Il joue à la fois le rôle de rabatteur et d’homme de main, faisant ses rondes autour du parking Battant, quartier chaud de la ville. Il touche aussi au trafic de drogue dans les quartiers de Planoise et des 408. En 1987, au moment des faits qui lui seront reprochés, Sobieski est bien connu des gendarmes. Il faudra attendre le coup de la canadienne pour le mettre définitivement hors d’état de nuire. Vingt ans d’emprisonnement, dont dix-sept années de sûreté.
De retour chez lui, la lecture des pièces du dossier laissait Corso sceptique. Ce profil de délinquant pourri jusqu’à l’os — il en avait connu des milliers comme lui — ne cadrait pas avec le meurtrier récidiviste qu’il poursuivait, un tueur organisé qui avait réussi à ne pas laisser la moindre trace derrière lui et qui faisait preuve dans son mode opératoire d’une cruauté sophistiquée.
Par ailleurs, le dossier de Jacquemart ne comportait pas de détails (ni de photos) du meurtre de 1987. Il aurait voulu voir les plaies du visage de Christine Woog ainsi que les liens que l’intrus avait bricolés cette nuit-là…
En réalité, les assassinats de Sophie et d’Hélène correspondaient beaucoup plus au nouveau Sobieski, le peintre, le réhabilité, le héros des médias. Jacquemart avait consacré une partie spécifique de son dossier à cette mutation.
À la maison d’arrêt de Besançon, Sobieski passe son bac puis une licence de droit. Au milieu des années 90, il est transféré à Fleury-Mérogis où il se met au dessin. Peu à peu, détenus et surveillants découvrent les dons du numéro d’écrou 28 34 66. Le taulard est capable de brosser le visage de n’importe quel codétenu ou, selon la demande, de caricaturer les matons, ou encore de reproduire d’après photos les personnes chères aux prisonniers.
Bientôt (et malgré sa réputation de fouteur de merde), il obtient l’autorisation de recevoir des pigments à l’huile et d’aménager dans sa cellule un minuscule atelier. Sobieski devient le portraitiste officiel de Fleury. Parallèlement à ces travaux de facture classique, il développe un style propre, expressionniste, réalisant une série de toiles stupéfiantes de violence et de vérité.
En 2000, une exposition intra-muros est organisée. Des photos sont diffusées. En 2002, une galerie expose officiellement les toiles de Philippe Sobieski, et pas n’importe quelle galerie, celle de Nicole Crouzet et de Jean-Marie Gavineau, une des plus réputées du marché de l’art contemporain. Les associés parient sur le talent du peintre — et sans doute sur son image d’assassin reconverti. Bourgeois et intellos adorent ceux qui transgressent leur petit monde policé.
Bientôt, des pétitions circulent. Des personnalités prennent la défense de l’artiste, qui a « largement payé sa dette à la société ». De son côté, Sobieski laisse parler ses toiles. Il a raison : pour tous, un tel peintre ne peut plus être un criminel. Et s’il l’a été, cela ajoute à la puissance implicite de son œuvre. On évoque à son sujet Le Caravage, bagarreur et assassin, et on le reconnaît désormais comme un témoin de premier plan de l’univers carcéral.
La politique s’en mêle : les figures de gauche mais aussi de droite, même si le pardon et la clémence ne sont plus très à la mode dans les années 2000, montent au créneau. Il faut libérer Sobieski !
Corso parcourait avec consternation les articles, les pétitions, les discours des défenseurs de l’artiste — des noms connus, dans tous les domaines. Il avait souvent eu affaire à ces gueulards, des écrivains, des chanteurs, des politiques, des mecs en vue persuadés d’avoir la science infuse alors même que l’affaire n’était pas jugée et que les flics piétinaient…
Le cas de Sobieski était différent : il était question de réhabilitation, de deuxième chance, et bizarrement du pouvoir purificateur de l’art. Corso ne voyait pas trop pourquoi Sob la Tob, après s’être enfilé près de vingt ans de prison et s’être mis à la peinture, aurait cessé d’être un prédateur. Comme disait Bompart : « Vous pouvez toujours éduquer un psychopathe. Tout ce que vous obtiendrez, c’est un psychopathe bien élevé. »
Corso passa aux images des toiles. Là, il y avait de quoi être impressionné. Les études consacrées aux taulards, réalisées dans les années 2000, étaient d’une force inouïe. Elles exprimaient un univers claustrophobique où les visages paraissaient curetés par la solitude ou au contraire bouffis par la mauvaise bouffe et l’ennui. Les peintures de strip-teaseuses étaient éblouissantes. Pour chaque fille, Sobieski choisissait un accessoire, un peu comme les portraits royaux de Goya au XVIII e siècle. Il les transformait en reines, exprimant aussi leur solitude d’objets de désir relégués sur une scène comme les taulards emprisonnés dans leur cage.
Читать дальше