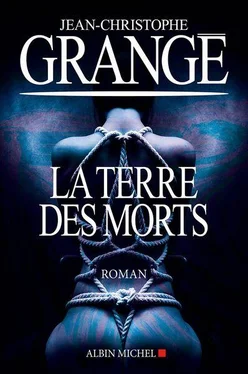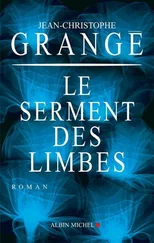Sa ligne fixe sonna. Un bref instant, il fut tenté de ne pas répondre. Puis, avec peine, il s’arracha du canapé et décrocha.
— Commandant ? (La voix du planton, entre respect et indécision.) Y a un gars en bas qui demande à vous voir. J’le fais monter ?
Corso regarda sa montre : 21 heures passées.
— Comment il s’appelle ?
Un temps. Le bleu devait lire la carte d’identité du visiteur.
— Lionel Jacquemart.
— Connais pas. Tu l’envoies chier. Je veux dire, se reprit-il, tu le diriges sur les flics chargés de recueillir les témoignages. S’ils sont partis, qu’il revienne demain, à une heure normale.
— Il dit qu’il est d’la maison, insista le bleu à voix basse.
— T’as vu son badge ?
— Il est à la retraite.
Corso soupira :
— Fais-le monter.
— Y a un autre problème… Il est handicapé.
— Comment ça ?
— Il boite. Il a une canne.
Nouveau soupir :
— Dis-lui d’emprunter l’ascenseur de l’escalier E. Je l’attendrai au troisième.
Corso prit un premier couloir puis un second jusqu’à atteindre l’ascenseur — plutôt un monte-charge — utilisé seulement par les handicapés ou les suspects récalcitrants qui refusaient de monter les marches.
Les portes s’ouvrirent sur un homme d’une soixante d’années, curieusement vêtu d’un gilet multipoche style reporter. Une tignasse grise, des yeux assortis, qui tenaient plus du fil barbelé que de la perle noire, une barbe hirsute. Un vrai gugusse.
Corso fut tenté d’appuyer sur le bouton du rez-de-chaussée sans lui laisser le temps de franchir le seuil de la cabine, mais il fit un effort de mansuétude et se présenta, laissant son visiteur pénétrer à l’étage de la Brigade criminelle.
— Lionel Jacquemart, fit l’autre avec un accent à couper du comté. J’faisais partie du SRPJ de Besançon dans les années 90. (Il éclata de rire.) Un pur Jurassien !
Il s’appuya des deux mains sur sa canne comme s’il voulait la planter dans le sol — c’était une espèce de bout de bois tordu et verni digne d’un roman de Giono.
— J’m’excuse pour l’heure tardive… C’est mon train, y a eu des soucis techniques. J’arrive tout droit de Besançon ! J’me suis dit qu’j’allais tenter ma chance au 36 avant d’aller à mon hôtel.
Dix minutes , se dit Corso, pas une seconde de plus .
— Suivez-moi. On va dans mon bureau.
Il reprit le chemin des couloirs à pas retenus, entendant l’autre clopiner derrière lui. Enfin, il fit entrer l’escogriffe. Avant même de lui proposer de s’asseoir, il l’interrogea brutalement sur la raison de sa visite.
Pas du tout troublé, Jacquemart partit d’un sourire matois et leva sa canne comme pour frapper les trois coups.
— C’est tout simple, je connais votre tueur.
Corso fit asseoir l’espèce de loup-garou boiteux et le laissa déblatérer son histoire, par pure solidarité de flicard — un cambriolage qui avait mal tourné dans la banlieue de Besançon en 1987, avec homicide de la fille des propriétaires des lieux et arrestation du coupable quelques mois plus tard. Stéphane écoutait patiemment tout en se répétant pour lui-même un adage personnel : il n’y a pas de bons dimanches soir, il y en a simplement des pires…
Pourtant, il sentit son attention se réveiller quand Jacquemart lui révéla que le dénommé Philippe Sobieski avait purgé dix-sept ans de sûreté, dont une dizaine à Fleury-Mérogis, et avait été libéré en 2005. Et il bondit carrément de sa chaise quand le Jurassien ajouta que Sobieski avait réussi une réhabilitation sans faute en devenant peintre. Ayant commencé à pratiquer en prison, il était même parvenu, les dernières années, à exposer dehors et s’était rapidement affirmé comme un nom qui comptait dans le monde de l’art parisien.
— Vous avez des photos de lui ? demanda soudain Corso.
— J’vous ai amené tout l’dossier, répondit Jacquemart sans paraître remarquer le changement de ton de son interlocuteur.
Il sortit de son cartable un classeur toilé. À l’intérieur, un porte-vues — ce qu’on appelle à l’école un « lutin » — contenait des portraits découpés dans des magazines. En un seul coup d’œil, Corso sut qu’il tenait son client.
Un homme d’une soixantaine d’années, sec comme une trique, gueule émaciée, regard provocant, posait, serré dans un costume blanc de maquereau, un manteau de vigogne sur les épaules. Un borsalino, blanc lui aussi, s’inclinait sur son front pour insister, au cas où on n’aurait pas compris, sur le côté voyou du personnage.
Corso était pétrifié, le cœur bloqué dans la gorge comme une balle en travers d’un canon. S’il avait dû faire le portrait-robot de l’homme de Madrid, c’est exactement cette silhouette qu’il aurait dessinée.
L’image appartenait à une série réalisée en 2011 par un magazine de mode. D’autres suivaient. Malgré l’allure totalement ringarde de l’ex-taulard, Corso comprit qu’il s’agissait de prises de vue hautement branchées — le costard du pimp était signé d’un célèbre créateur italien.
Surtout, grâce aux légendes sous les photos, il comprenait à qui il avait affaire : un cas d’école comme les aiment les médias et les intellos, un tueur qui avait payé sa dette à la société et dont le talent inattendu avait éclaté à la face du monde. Mais l’artiste avait gardé ses manières de mauvais garçon. Brut de fonderie, vulgaire et provocateur, le sire Sobieski avait tout pour faire frissonner la bourgeoise. Que du bonheur .
— Vous avez des photos des œuvres ?
Jacquemart lui passa un autre lutin. Des personnages nus, musculeux, aux couleurs bleuâtres ou terreuses. Des traits torturés, et en même temps flegmatiques, brossés comme à coups rageurs, jaillissant de la superposition des couches de peinture.
Pas besoin d’être flic pour deviner qu’il s’agissait de junks, de putes, de taulards, une population venue du ruisseau dont Sobieski avait réussi, exactement comme dans le cahier d’esquisses, à révéler la part de pureté, d’innocence.
Tout de suite, cette œuvre violente, dense et expressive, plut à Corso. C’était comme si l’artiste avait tordu le cou à la peinture elle-même pour la faire plonger dans la réalité la plus basse. Mais l’artiste, grâce à une empathie profonde, avait sublimé la tragédie de ces hommes et de ces femmes jusqu’à en faire des êtres éthérés, presque des anges. La cour des Miracles avait trouvé son portraitiste officiel.
L’ultime choc l’attendait dans les dernières pages.
Un tirage représentait Hélène Desmora. Un grand portrait (120 × 160) daté de 2015, où l’effeuilleuse posait de trois quarts, bras gauche appuyé au premier plan, visage légèrement penché, regard par en dessous, avec cette coupe à frange noire qui avait sur la toile la netteté d’un casque. Miss Velvet était en tenue de travail : boa mauve, string noir. Mais l’esprit du tableau n’était pas celui du néo-burlesque. La jeune femme était grave, livide, hantée. Sa peau vivait à coups d’aplats de blanc, de beige, de brun. Les seules couleurs vives, hormis le serpent de plumes, provenaient des tatouages dont le peintre avait accentué la présence, choisissant de les faire vivre sur l’épaule et le bras du premier plan, comme des lianes suçant les chairs blafardes de la strip-teaseuse. Une logique de forêt équatoriale, la vie se nourrissant de la mort… Au-dessus de ce combat atroce, le visage était déchirant de beauté et d’innocence.
Corso constata qu’il tremblait. Il posa les clichés et glissa ses mains sous le bureau. Résumons-nous . Sobieski était l’auteur du carnet d’esquisses du Squonk. Aucun doute. Il était également l’amant — le « père de substitution » — d’Hélène Desmora. Aucun doute non plus. On pouvait aussi lui attribuer le rôle de boyfriend de Sophie Sereys. Quant au personnage à chapeau du musée de Madrid, il était bien placé pour le casting.
Читать дальше