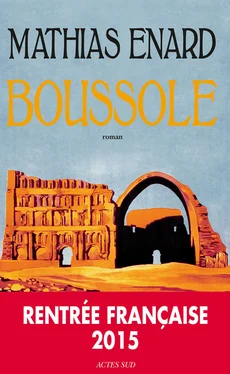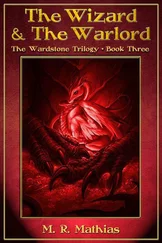Avant que l’aurore rouge des guerriers du Livre des Rois ne descende du Damavand, dans le silence essoufflé, encore stupéfait, émerveillé par la présence de Sarah contre moi, alors qu’on l’oublie à Téhéran, qu’on ne l’entend jamais, discret, noyé dans les sons de la ville, retentit l’appel à la prière — un miracle fragile dont on ne sait s’il provient d’une mosquée voisine ou d’un appartement proche, l’ adhan tombe sur nous, nous enveloppe, sentence ou bénédiction, onguent sonore, “Alors que mon cœur bondit dans un amour ardent de cette ville et de ses voix, je commence à ressentir que toutes mes randonnées n’ont jamais eu qu’une signification : chercher à saisir le sens de cet appel”, disait Muhammad Asad, et enfin j’en comprends le sens, un sens, celui de la douceur du partage et de l’amour, et je sais que Sarah, comme moi, pense aux vers des troubadours, à la triste aubade ; l’appel se mêle au chant des premiers oiseaux, passereaux urbains, nos rossignols des pauvres (“ Sahar bolbol hekâyat bâ Sabâ kard , À l’aube le rossignol parle à la brise”), aux glissements des automobiles, aux parfums de goudron, de riz et de safran qui sont l’odeur de l’Iran, à jamais associée, pour moi, au goût de pluie salée de la peau de Sarah : nous restons immobiles, interdits, à écouter les strates sonores de ce moment aveugle, en sachant qu’il signifie à la fois l’amour et la séparation dans la lumière du jour.
Pas encore de réponse. Est-ce qu’il y a internet à Kuching, capitale du Sarawak ? Oui bien sûr. Il n’existe plus d’endroit sur terre où il n’y ait pas internet. Même au milieu des guerres les plus atroces, heureusement ou malheureusement, on trouve une connexion. Même dans son monastère de Darjeeling, Sarah avait un web café à proximité. Impossible d’échapper à l’écran. Même dans la catastrophe.
À Téhéran, lorsque dès le lendemain de cette nuit si douce elle a sauté dans le premier avion pour Paris, le vol du soir d’Air France, tremblante de douleur et de culpabilité, après avoir passé la journée, sans fermer l’œil une minute, de bureau de police en bureau de police pour régler ces sordides histoires de visa dont les Iraniens ont le secret, armée d’un papier expédié en urgence par l’ambassade de France, qui attestait du gravissime état de santé de son frère et priait les autorités iraniennes de bien vouloir faciliter son départ, alors qu’elle avait la sensation intime, au son de la voix de sa mère, que Samuel était déjà décédé, quoi qu’on lui en dise, détruite par le choc, la distance, l’incompréhension, l’incrédulité face à cette annonce, le soir même, pendant qu’elle se retournait sans dormir dans son siège au milieu des étoiles impassibles, je me précipitai sur internet pour lui envoyer des lettres, des lettres et des lettres qu’elle lirait, espérai-je bêtement, à son arrivée. Je passai moi aussi la nuit sans fermer l’œil, dans une tristesse rageuse et incrédule.
Sa mère l’avait appelée sans succès toute la soirée et jusqu’au matin, désespérée, avait joint l’institut, le consulat, remué ciel et terre et enfin, alors que Sarah avait pudiquement, en me lançant un baiser de loin, fermé la porte de la salle de bains pour dissimuler sa présence à l’intrus, on était venu me trouver pour m’avertir — l’accident s’était produit dans l’après-midi précédent, l’accident, l’événement, la découverte, on n’en savait rien encore, il fallait que Sarah rappelle sa mère chez elle, et c’était les mots chez elle , pas à l’hôpital, pas Dieu sait où, mais chez elle qui lui avaient fait pressentir la tragédie. Elle s’était précipitée sur le téléphone, je revois le cadran et ses mains hésiter, se tromper, je me suis éclipsé, je suis sorti, moi aussi, autant par bienséance que par lâcheté.
Cette dernière journée, j’ai erré avec elle dans les bas-fonds de la justice iranienne, au bureau des passeports, royaume des pleurs et de l’iniquité, où des illégaux afghans aux vêtements maculés de ciment et de peinture, menottés, abattus, défilaient devant nous encadrés par des Pasdaran et cherchaient un peu de consolation dans les regards des présents ; nous avons attendu des heures sur ce banc de bois limé, sous les portraits du premier et du second Guide de la Révolution et toutes les dix minutes Sarah se levait pour aller au guichet, répéter toujours la même question et le même argument, “ bâyad emshab beravam , il me faut partir ce soir, il me faut partir ce soir”, et chaque fois le fonctionnaire lui répondait “demain”, “demain”, “vous partirez demain”, et dans l’égoïsme de la passion j’avais l’espoir qu’effectivement elle ne parte que le lendemain, que je puisse passer une soirée, une nuit de plus avec elle, la consoler, imaginais-je, de la catastrophe que nous ne faisions qu’entrevoir et le plus atroce, dans cette antichambre déglinguée, sous le regard courroucé de Khomeiny et les grosses lunettes de myope de Khamenei, était que je ne pouvais pas la prendre dans mes bras, pas même lui tenir la main ni essuyer les larmes de rage, d’angoisse et d’impuissance sur son visage, craignant que cette marque d’indécence et d’offense à la morale islamique ne diminue encore un peu plus ses chances d’obtenir son visa de sortie. Finalement, alors que tout espoir de décrocher le coup de tampon magique semblait perdu, un officier (la cinquantaine, courte barbe grise, un ventre plutôt débonnaire dans une veste d’uniforme impeccable) est passé devant nous pour rejoindre son bureau ; ce bon père de famille a écouté l’histoire de Sarah, l’a prise en pitié et, avec cette grandeur magnanime qui n’appartient qu’aux puissantes dictatures, après avoir paraphé un obscur document, il a appelé son subordonné pour lui enjoindre de bien vouloir apposer sur le passeport de la ci-devant le sceau théoriquement inaccessible, lequel subordonné, le même fonctionnaire inébranlable qui nous avait envoyés paître sans ménagements toute la matinée, s’est acquitté derechef de sa tâche, avec un léger sourire d’ironie ou de compassion, et Sarah s’est envolée vers Paris.
Si majeur — l’aube qui met fin à la scène d’amour ; la mort. Est-ce que le Chant de la nuit de Szymanowski, qui relie si bien les vers de Roumi le mystique à la longue nuit de Tristan et Isolde passe par le si majeur ? Je ne m’en souviens pas, mais c’est probable. Une des plus sublimes compositions symphoniques du siècle dernier, sans aucun doute. La nuit de l’Orient. L’Orient de la nuit. La mort et la séparation. Avec ces chœurs brillant comme des amas d’étoiles.
Szymanowski a aussi mis en musique des poèmes de Hafez, deux cycles de chansons composés à Vienne, peu avant la Première Guerre mondiale. Hafez. On a l’impression que le monde tourne autour de son mystère, comme l’Oiseau de Feu mystique autour de la montagne. “Hafez, chut ! Personne ne connaît les mystères divins, tais-toi ! À qui vas-tu demander ce qu’il est advenu du cycle des jours ?” Autour de son mystère et de ses traducteurs, depuis Hammer-Purgstall jusqu’à Hans Bethge, dont les adaptations de poésie “orientale” seront si souvent mises en musique. Szymanowski, Mahler, Schönberg ou Viktor Ullmann, tous utiliseront les versions de Bethge. Bethge, voyageur presque immobile qui ne savait ni l’arabe, ni le persan, ni le chinois. L’original, l’essence, se tiendrait entre le texte et ses traductions, dans un pays entre les langues, entre les mondes, quelque part dans le nâkodjââbad , le lieu-du-non-où, ce monde imaginal où la musique prend aussi sa source. Il n’y a pas d’original. Tout est en mouvement. Entre les langages. Entre les temps, le temps de Hafez et celui de Hans Bethge. La traduction comme pratique métaphysique. La traduction comme méditation. Il est bien tard pour penser à ces choses. C’est le souvenir de Sarah et de la musique qui me pousse vers ces mélancolies. Ces grands espaces de la vacuité du temps. Nous ignorions ce que la nuit recelait de douleur ; quelle longue et étrange séparation s’ouvrait là, après ces baisers — impossible d’aller me recoucher, pas encore d’oiseau ou de muezzin dans la ténèbre de Vienne, le cœur battant de souvenirs, de manque aussi puissant que celui de l’opium peut-être, manque de souffles et de caresses.
Читать дальше