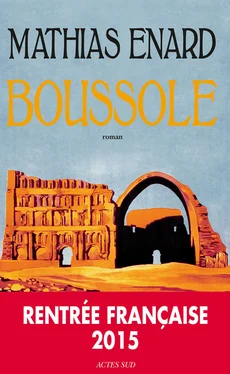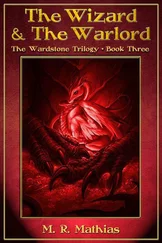Je crois que je suis en train de m’assoupir, que je m’endors doucement, la face caressée par une brise du désert, dans le 9 earrondissement de cette Nouvelle Vienne qu’aucun des deux Musil n’a connue, sous ma couette sur mon oreiller qui sont une tente de nomade intérieure, aussi profonde et spacieuse que celle qui nous accueillit cette nuit-là, la nuit au désert : ainsi les guides d’Alois Musil, un camion-benne bringuebalant s’était soudain arrêté près de nous, nous croyant en détresse ; ses occupants (figures hâlées et ridées enveloppées dans des keffiehs rouges, moustaches raides coupant en deux les visages) nous avaient expliqué que le château que nous cherchions se trouvait encore loin vers le nord-est, à trois bonnes heures de piste et que nous ne l’atteindrions jamais avant la nuit : ils nous avaient invités à dormir sous leur tente noire, dans la plus grande tradition bédouine. Nous n’étions pas les seuls invités : installé dans le “salon” se trouvait déjà un étrange colporteur, marchand ambulant du désert qui vendait, dans d’immenses sacs de nylon gris, comme des outres démesurées, des centaines d’objets en plastique moulé, timbales, passoires, seaux, claquettes, jouets d’enfants, ou en fer-blanc, théières, cafetières, plats, couverts : ses gigantesques besaces devant la tente ressemblaient à deux grosses larves avachies ou aux haricots dégénérés d’une plante infernale. Ce colporteur était originaire du Nord de la Syrie et n’avait pas de véhicule : il parcourait la badiyé au gré des camions et des tracteurs des nomades, de tente en tente, jusqu’à ce qu’il ait tout vendu, et s’en retournait alors à Alep refaire ses stocks dans le dédale des souks. Il reprenait sa tournée une fois son fourbi à nouveau rassemblé, descendait l’Euphrate en autobus, puis sillonnait tout le territoire compris entre le fleuve, Palmyre et la frontière irakienne, profitant (abusant, aurait pensé un Occidental) de l’hospitalité des nomades, qui étaient autant ses clients que ses logeurs. Ce T. E. Lawrence de la casserole devait sans doute être un peu espion et renseigner les autorités sur les faits et gestes de ces tribus qui entretenaient des liens étroits avec l’Irak, la Jordanie, l’Arabie Saoudite et même le Koweït : j’étais très surpris d’apprendre que je me trouvais dans une maison (ainsi nomme-t-on, en arabe, la tente) du clan des Mutayrs, fameuse tribu guerrière qui s’allia avec Ibn Séoud au début des années 1920 et permit son accession au pouvoir, avant de se rebeller contre lui. La tribu du mari-passeport de Marga. Muhammad Asad le Juif d’Arabie raconte comment il participa lui-même à une opération d’espionnage au Koweït pour le compte d’Ibn Séoud, contre les Mutayrs de Faysal Dawish. Ces grands guerriers paraissaient (du moins dans leur version syrienne) des plus pacifiques : ils étaient éleveurs de moutons et de chèvres, possédaient un camion et quelques poules. Par pudeur, Sarah s’était attaché les cheveux comme elle avait pu dans la voiture alors que nous suivions le camion des Bédouins jusqu’à leur tente : le soleil couchant, lorsqu’elle quitta le véhicule, embrasa sa chevelure juste avant qu’elle ne pénètre l’ombre portée de la toile noire ; pas de seconde nuit à la belle étoile, tout contre Sarah, quelle malchance, pensais-je, quelle foutue malchance que de ne pas avoir réussi à rejoindre ce château perdu. L’intérieur de la maison en peau était sombre et accueillant ; une paroi de roseaux entremêlés de tissages rouges et verts divisait la tente en deux, un côté pour les hommes, un autre pour les femmes. Le chef de cette demeure, le patriarche, était un très vieil homme au sourire doré par les prothèses, bavard comme une pie : il parlait trois mots de français, qu’il avait appris avec l’armée du Levant dans laquelle il avait servi aux temps du mandat français sur la Syrie : “Debout ! Couché ! Marchez !”, ordres qu’il criait deux par deux avec une joie intense, “deboutcouché ! couchémarchez !”, heureux non seulement du simple plaisir de la réminiscence, mais aussi de la présence d’un auditoire francophone censé goûter ces injonctions martiales — notre arabe était trop limité (surtout celui de Bilger, restreint à “creusez, pelle, pioche”, autre version du “deboutcouchémarchez”) pour bien comprendre les nombreux récits de ce chef de clan octogénaire, mais Sarah réussissait, autant par empathie que grâce à ses connaissances linguistiques, à suivre les histoires du vieil homme et, plus ou moins, à nous en traduire le sens général quand il nous échappait. Bien sûr, la première question de Sarah au Mathusalem local concerna Marga d’Andurain la comtesse de Palmyre — l’avait-il connue ? Le cheikh se gratta la barbe et secoua la tête, non, il en avait entendu parler, de cette comta palmyréenne, mais rien de plus — pas de contact avec la légende, Sarah devait être déçue. Nous buvions une décoction d’écorce de cannelle, douce et parfumée, assis en tailleur sur les tapis de laine posés à même la terre ; un chien noir avait hurlé à notre approche, le gardien du bétail, qui protégeait les bêtes des chacals, voire des hyènes : les histoires de hyènes que nous racontaient le grand-père, ses fils et le colporteur faisaient dresser les cheveux sur la tête. Sarah était aux anges, immédiatement remise de sa déception de ne pas avoir rencontré un des derniers témoins du règne de Marga d’Andurain l’empoisonneuse du désert ; elle se retournait souvent vers moi avec un sourire complice, et je savais qu’elle retrouvait dans ces récits magiques les contes de goules et autres animaux fantastiques qu’elle avait étudiés : la hyène, presque disparue de ces contrées, rassemblait sur elle les légendes les plus extraordinaires. Le vieux cheikh était un conteur de premier ordre, un grand comédien ; il faisait taire, d’un bref geste de la main, ses fils ou le colporteur pour avoir le plaisir de raconter lui-même une histoire qu’il connaissait — la hyène, disait-il, hypnotise les hommes qui ont le malheur de croiser son regard ; ils sont alors contraints à la suivre à travers le désert jusqu’à sa grotte, où elle les tourmente et finit par les dévorer. Elle poursuit dans leurs rêves ceux qui réussissent à lui échapper ; son contact fait naître d’horribles pustules — pas étonnant que ces pauvres bestioles aient été copieusement massacrées, pensai-je. Le chacal quant à lui était méprisable mais inoffensif ; son long cri perçait la nuit — je trouvais ces gémissements particulièrement sinistres, mais ils n’avaient rien à voir, soutenaient les Bédouins, avec l’atroce appel de la hyène, qui avait le pouvoir de vous figer sur place, de vous glacer de terreur : tous ceux qui avaient entendu ce feulement rauque s’en souvenaient leur vie entière.
Après ces considérations de zoologie surnaturelle nous essayâmes, Sarah et moi (comme Alois Musil, imaginais-je, avec ses propres nomades), d’obtenir des informations sur les sites archéologiques des environs, les temples, les châteaux, les villes oubliées que seuls les Bédouins pouvaient connaître — cette démarche énervait le roi Bilger, certain que des générations d’orientalistes avaient “épuisé le désert” ; les Grabar, Ettinghausen ou Hillenbrand s’étaient employés des années durant à décrire les ruines islamiques pendant que leurs confrères spécialistes de l’Antiquité relevaient les forts et villages romains ou byzantins : plus rien à découvrir, pensait-il — effectivement, nos hôtes nous parlèrent de Qasr el-Heyr et de Rasafé, non sans y ajouter des histoires de trésors cachés qui amusèrent moyennement Bilger, encore légèrement vexé par son erreur d’orientation. Il m’expliqua, en allemand, que les autochtones observaient les excavations des archéologues et creusaient à leur tour dès que ceux-ci avaient tourné casaque : ces corneilles de l’archéologie étaient une plaie bien connue des chantiers, dont les abords finissaient, exagérait Bilger, encombrés de trous et de monticules de terre, comme ravagés par des taupes démesurées.
Читать дальше