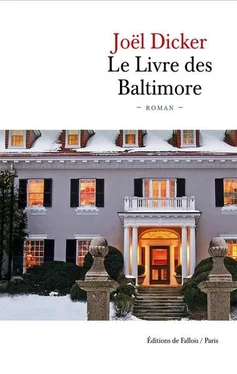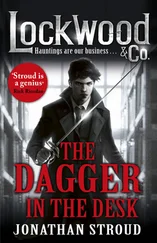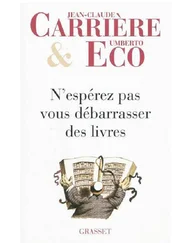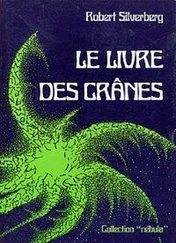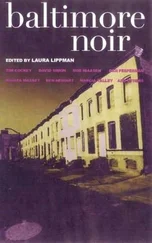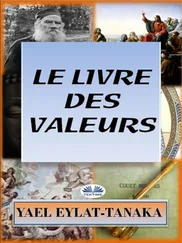Elle nous avait pris en affection et nous étions sans cesse fourrés chez les Neville. En principe, les grandes sœurs et les petits frères ne s'entendent pas. C'est du moins le constat que j'avais fait avec mes copains de Montclair. Ils se traitaient de tous les noms et se faisaient des crasses. Chez les Neville, c'était différent. Certainement à cause de la maladie de Scott.
Alexandra appréciait notre compagnie. Elle la recherchait même. Et Scott adorait la présence de sa sœur. Elle l'appelait « chou » et multipliait les gestes de tendresse à son égard.
Quand je la voyais le cajoler, l'enlacer, lui caresser la nuque, lui embrasser les joues, j'avais soudain très envie d'avoir moi aussi la mucoviscidose. Moi, à qui on avait toujours accordé un intérêt digne d'un Montclair, j'étais subjugué qu'un enfant puisse recevoir autant d'attention.
Je promis mille merveilles au Ciel en échange d'une belle mucoviscidose. Pour accélérer le processus divin, je léchais en cachette les fourchettes de Scott et je buvais dans son verre. Quand il avait des quintes de toux, je m'approchais de lui, la bouche grande ouverte, pour récolter des miasmes.
Je me rendis chez le médecin, qui me trouva malheureusement dans une forme éblouissante.
— J'ai la mucoviscidose, lui annonçai-je pour aider le diagnostic. Il éclata de rire.
— Hé ! m'insurgeai-je. Un peu de respect pour les malades.
— Tu n'as pas la mucoviscidose, Marcus.
— Qu'est-ce que vous en savez ?
— Je le sais parce que je suis ton médecin. Tu es en pleine forme.
Il n'y eut plus de week-end à Baltimore sans Alexandra. Elle était tout ce dont nous pouvions rêver : drôle, intelligente, belle, douce et rêveuse. Ce qui nous fascinait le plus chez elle était certainement son don pour la musique. Nous fûmes son premier véritable public : elle nous faisait venir chez elle, elle prenait sa guitare et elle jouait pour nous. Nous l'écoutions, envoûtés.
Elle pouvait jouer pendant des heures, et nous ne nous en lassions jamais. Elle partageait avec nous ses compositions, nous demandait notre avis. Il ne fallut pas plus de quelques mois pour que Tante Anita accepte d'inscrire Hillel et Woody à un cours de guitare, tandis qu'à Montclair ma mère me les refusait avec un argument redoutable : « Des cours de guitare ? Pour quoi faire ? » Je pense qu'elle n'aurait pas vu d'inconvénient à ce que je fasse du violon ou de la harpe. Elle m'aurait vu virtuose, chanteur d'opéra. Mais quand je lui parlais de devenir vedette de la pop music, elle me voyait saltimbanque aux cheveux longs et sales.
Alexandra devint le premier et unique membre féminin du Gang des Goldman. En une seconde elle fit partie de notre groupe, au point que nous nous demandions comment nous avions pu vivre si longtemps sans elle. Elle fut de nos soirées pizza à la table des Baltimore, elle fut de nos visites au père de Tante Anita à la « Maison des morts », où elle remporta même notre prestigieux trophée inter-Goldman de course en chaise roulante. Elle était capable de descendre d'une traite autant de Dr Pepper que nous trois, et de roter aussi fort.
La famille Neville dans son ensemble me plaisait énormément. C'était à croire qu'à Baltimore, toute la population avait été gratifiée de gènes supérieurs. J'en voulais pour preuve que les Neville au grand complet étaient une famille aussi belle et attirante que les Goldman. Patrick travaillait pour une banque et Gillian était trader. Ils étaient arrivés de Pennsylvanie quelques années plus tôt, mais étaient tous les deux originaires de New York. Ils se montraient profondément bons avec nous. Leur maison nous était grande ouverte.
La présence d'Alexandra à Baltimore — voire la découverte de la famille Neville — décupla à la fois mon excitation à l'idée de retourner là-bas, et le désarroi de devoir en repartir. Car aux sentiments de tristesse se mêla une sensation que jamais auparavant je n'avais éprouvée envers mes cousins : de la jalousie. Seul à Montclair, je me faisais des films absurdes : j'imaginais Woody et Hillel rentrer de l'école et passer chez elle. Je l'imaginais se frottant contre chacun d'eux et je devenais fou de rage. Je fulminais en me représentant Alexandra pendue aux lèvres d'Hillel le génie, ou reluquant les muscles saillants de Woody l'athlète. Et moi, qu'étais-je ? Ni vraiment athlète, ni vraiment génial, je n'étais qu'un Montclair. Dans un moment de désarroi profond, je lui écrivis même une lettre, pendant un cours de géographie, pour lui dire combien je regrettais de ne pas vivre à Baltimore moi aussi. J'avais recopié la lettre sur du beau papier, je l'avais réécrite trois fois pour que chaque mot soit parfait et je l'avais postée en express avec accusé de réception pour être certain qu'elle la recevrait. Mais elle ne me répondit jamais. Je téléphonai une quinzaine de fois à la poste pour donner mon numéro de référence et être certain que l'envoi avait été délivré à Alexandra Neville, Hanson Crescent, à Oak Park, Maryland. Elle l'avait bien reçue. Elle avait signé l'accusé de réception. Pourquoi ne me répondait-elle pas ? Était-ce sa mère qui avait intercepté la lettre ? Ou avait-elle des sentiments qu'elle n'osait pas m'avouer et qui, du coup, l'empêchaient de m'écrire en retour ? Lorsqu’enfin je retournai à Baltimore, la première chose que je lui demandai en la voyant fut de savoir si elle avait reçu ma lettre. Elle me répondit : « Oui, Markikette. Merci d'ailleurs. » Je lui avais envoyé une belle lettre, et elle me disait simplement Merci, Markikette. Hillel et Woody éclatèrent de rire en entendant le sobriquet qu'elle venait de m'inventer.
— Markikette ! s'esclaffa Woody.
— Une lettre à propos de quoi ? demanda Hillel, goguenard.
— Ça ne vous regarde pas, dis-je. Mais Alexandra répondit :
— Une très gentille lettre dans laquelle il me disait qu'il aurait aimé vivre à Baltimore, lui aussi.
Hillel et Woody se mirent à rire comme des imbéciles et moi je restais mortifié et cramoisi de honte. Je me mis à penser qu'il se passait réellement quelque chose entre Alexandra et l'un de mes deux cousins et, à des signes que je pouvais observer, tout portait à croire que c'était Woody, ce qui n'avait rien d'étonnant puisque toutes les filles et même toutes les femmes se pâmaient devant lui, beau, musclé, ténébreux et mystérieux. Moi aussi, j'aurais bien voulu que mes parents m'abandonnent si c'était pour finir beau et fort dans la maison des Goldman-de-Baltimore !
Quand le week-end touchait à sa fin, que j'entendais de sa bouche un dernier « au revoir, Markikette », je sentais mon cœur se serrer. Elle me demandait :
— Tu reviens le week-end prochain ?
— Non.
— Oh, c'est dommage ! Tu reviens quand ?
— Je ne sais pas encore.
Dans ces moments-là, j'avais presque l'impression de me sentir spécial à ses yeux, mais aussitôt mes deux cousins s'esclaffaient comme des macaques et disaient : « T'inquiète pas, Alexandra, tu recevras bientôt une lettre d' amouuuur. » Elle riait aussi et moi je m'en allais, penaud.
Tante Anita me raccompagnait à la gare. Sur le quai, un petit garçon sale et laid m'attendait. Je devais me dévêtir devant lui et lui remettre la toison magnifique des Baltimore tandis qu'il me tendait un sac-poubelle dans lequel était le costume crasseux et puant des Montclair. Je le revêtais, j'embrassais ma tante et je montais dans le train. Une fois à bord, je ne pouvais jamais m'empêcher de pleurer. Et malgré mes nombreuses prières, de tous les ouragans, les tornades, les tempêtes de neige et les cataclysmes qui balayèrent l'Amérique durant ces années, aucun n'eut la bonne idée de se produire lorsque j'étais à Baltimore et de prolonger mon séjour. Jusqu'au dernier instant, j'espérais une catastrophe naturelle soudaine, ou une panne du réseau ferroviaire qui empêcherait le départ du train. N'importe quoi pour retrouver ma tante et retourner à Oak Park où m'attendaient Oncle Saul, mes cousins et Alexandra. Mais le train s'ébranlait toujours et m'emmenait vers le New Jersey.
Читать дальше