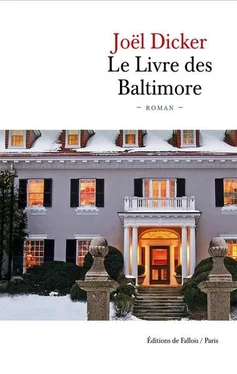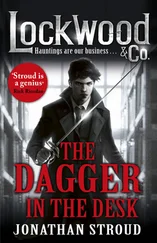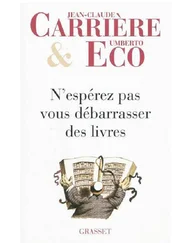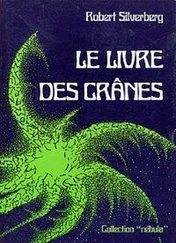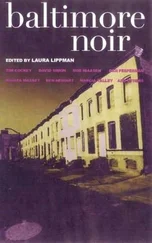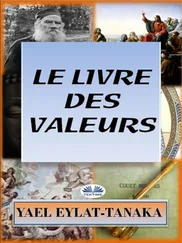Des années plus tard, l'hiver qui suivit le succès de mon premier roman, c'est-à-dire environ trois ans après le Drame, je m'offris le luxe de passer les fêtes dans un hôtel à la mode de South Beach. C'était la première fois que je revenais à Miami depuis la Buenavista. J'arrêtai ma voiture devant la grille. L'agent de sécurité sortit la tête de sa guérite.
— Bonjour, Monsieur, puis-je vous renseigner ?
— Oui, je voudrais entrer un moment si c'est possible.
— Êtes-vous résident ici ?
— Non, mais je connais bien cet endroit. J'ai connu des gens qui ont vécu ici.
— Désolé, Monsieur, si vous n'êtes ni un résident, ni un invité, je dois vous demander de partir.
— Ils habitaient au 26 eétage, appartement 2609. Famille Goldman.
— Je n'ai pas de « Goldman » sur mon registre, Monsieur.
— Qui habite aujourd'hui l'appartement 2609 ?
— Je ne suis pas autorisé à vous donner ce genre d'information.
— Je voudrais juste entrer dix minutes. Je voudrais juste aller voir la piscine. Voir si ça a changé.
— Monsieur, je crains de devoir vous demander de partir, maintenant. C'est une propriété privée. Sinon, j'appelle la police.
Par un chaud mardi matin à Boca Raton, Alexandra débarqua chez moi, utilisant le prétexte de son chien qui s'était enfui, comme tous les jours.
— Qu'est-ce que ton chien ferait chez moi ?
— Je ne sais pas.
— Si je l'avais vu, je te l'aurais ramené.
— C'est vrai. Excuse-moi de t'avoir dérangé.
Elle faisait mine de partir et moi je la retenais.
— Attends… Tu veux boire un café ?
Elle souriait.
— Oui, je veux bien…
Je la priai de patienter un instant.
— Donne-moi deux minutes, s'il te plaît. C'est très mal rangé à l'intérieur.
— C'est pas grave, Markie…
Je frémissais quand elle m'appelait comme ça. Je ne me laissai pas pour autant distraire.
— C'est une honte de recevoir les gens comme ça. Donne-moi un instant.
Je me précipitai sur la terrasse arrière. C'était le début des grosses chaleurs et Duke se prélassait dans une piscine gonflable pour enfant que je lui avais achetée.
Je la renversai pour la vider de son eau et Duke avec. Il prit un air malheureux. « Désolé, mon vieux, il faut que tu te tires d'ici. » Il s'assit et me regarda fixement. « Allez hop ! Tire-toi ! Il y a ta patronne à l'entrée. » Comme il ne bronchait pas, je lui lançai sa balle en caoutchouc aussi loin que je pus. Elle atterrit dans le lac et Duke se précipita vers elle.
Je me dépêchai de faire entrer Alexandra. Nous nous installâmes dans la cuisine, je mis du café à filtrer, et comme elle regardait par la fenêtre, elle remarqua son chien qui nageait dans le lac.
— Ça alors ! s'écria-t-elle. Duke est là-bas.
Je pris un air étonné et vins à côté d'elle pour constater cette extraordinaire coïncidence.
Nous sortîmes Duke de l'eau, sa balle dans la gueule. Elle la lui retira. « Les gens jettent n'importe quoi dans ce lac », dis-je.
Elle resta un bon moment chez moi. Lorsqu'il fut pour elle le moment de repartir, je la raccompagnai jusque sous mon porche. Je donnai une tape amicale à Duke. Elle me regarda longuement sans parler : je crois qu'elle était sur le point de m'embrasser. Soudain, elle tourna la tête et elle s'en alla.
Je la regardai descendre les marches de ma maison et rejoindre sa voiture. Elle partit. C'est à ce moment-là que je remarquai un van noir garé dans la rue avec, au volant, un homme qui m'observait. Au moment où il croisa mon regard, il enclencha son moteur. Je me précipitai dans sa direction. Il démarra en trombe. Je lui courus après en le sommant de s'arrêter. Il disparut avant que j'aie la présence d'esprit de relever le numéro de sa plaque.
Leo apparut sous son porche, alerté par le bruit.
— Est-ce que tout va bien, Marcus ? me cria-t-il.
— Il y avait un drôle de type dans un van, répondis-je hors d'haleine. Il avait l'air vraiment bizarre.
Leo me rejoignit sur la rue.
— Un van noir ? me demanda-t-il.
— Oui.
— Je l'ai vu à plusieurs reprises. Mais je pensais que c'était un voisin.
— C'était tout sauf un voisin.
— Vous pensez être menacé ?
— Je… Je n'en sais rien, Leo.
Je décidai d'appeler la police. Une patrouille se présenta une dizaine de minutes plus tard. Malheureusement, je n'avais pas la moindre piste à leur donner. Tout ce que j'avais vu, c'était un van noir. Les policiers me recommandèrent de les appeler si je remarquais quoi que ce soit d'étrange et promirent de faire quelques passages dans la rue pendant la nuit.
*
Baltimore.
Janvier 1994.
Le Gang des Goldman fut toujours une trinité. Mais je ne saurais pas dire si j'en fus un élément constitutif ou si, au fond, il existait par la seule union d'Hillel et Woody, auxquels se greffait un élément tiers. L'année de la Buenavista fut celle où Scott Neville prit davantage de place dans la vie de mes cousins, au point que j'eus l'impression qu'il s'était vu offrir la récompense de leur amitié et le troisième siège du Gang.
Scott était drôle, incollable au sujet du football, et il n'était pas rare, lorsque je leur téléphonais, que mes cousins me disent : « Tu ne devineras jamais ce que Scott a fait aujourd'hui à l'école… »
J'étais affreusement jaloux de lui : pour l'avoir rencontré, je savais qu'il dégageait quelque chose d'éminemment sympathique. De surcroît, sa maladie lui valait de tous une tendresse particulière. Le pire était quand je l'imaginais dans sa brouette, poussé par Woody et Hillel, paradant comme un roi africain sur une chaise à porteurs.
Au retour des vacances de Noël, il obtint même d'intégrer l'équipe des Goldman Jardiniers après un incident qui immobilisa Skunk pendant quelque temps.
Pendant l'hiver, Skunk se chargeait de déblayer la neige devant les garages et sur les allées des maisons de ses clients. C'était un travail physique et astreignant, et surtout un éternel recommencement les années où il neigeait passablement.
Un samedi matin, alors que Woody et Hillel pelletaient des monceaux de neige devant le garage d'une cliente, Skunk arriva, furieux :
— Dépêchez-vous, les sacs à merde ! Vous n'avez pas encore terminé ici ?
— On fait ce qu'on peut, Monsieur Skunk, se défendit Hillel.
— Eh bien, faites plus ! Et je m'appelle Bunk ! Bunk ! Pas Skunk !
Comme il le faisait souvent, il agita devant eux une pelle, comme s'il menaçait de les frapper.
— J'ai eu Madame Balding au téléphone. Elle dit que vous n'êtes pas passés chez elle la semaine dernière et qu'elle a failli ne pas pouvoir sortir de sa maison.
— On était en vacances, plaida Woody.
— Je m'en fous, les sacs à merde ! Dépêchez-vous !
— Vous inquiétez pas, M'sieur Skunk, le rassura Hillel, on va travailler dur.
Bunk devint pourpre.
— Bunk ! hurla-t-il. JE M'APPELLE BUNK ! BUNK ! Comment il faut vous le dire ? Bunk avec un B ! Un B comme… B comme…
— B comme Bunk peut-être ? suggéra Hillel.
— B comme Baffe-dans-ta-gueule-sacré-nom-de-Dieu ! explosa Skunk avant de subitement s'écrouler par terre.
Woody et Hillel se précipitèrent. Il se tordait comme un ver. « Mon dos ! souffla-t-il comme s'il était paralysé. Mon dos, bordel de merde ! » Le pauvre Skunk avait crié tellement fort qu'il s'était bloqué le dos. Hillel et Woody le traînèrent jusque chez eux. Tante Anita l'installa sur le canapé du salon et l'ausculta. Apparemment, c'était un nerf coincé. Rien de grave, un repos total s'imposait. Elle lui prescrivit des calmants et ramena Skunk chez lui. Oncle Saul, Woody et Hillel la suivirent avec la camionnette de jardinage récupérée dans la rue voisine. Après avoir installé Skunk dans son lit, Tante Anita et Oncle Saul allèrent chercher des médicaments et lui faire quelques courses, tandis que Woody et Hillel lui tenaient compagnie. Installés au bord de son lit, ils virent soudain une larme perler de son œil et rouler dans le sillon d'une ride qui creusait sa vieille peau tannée par les années passées dehors. Skunk pleurait.
Читать дальше