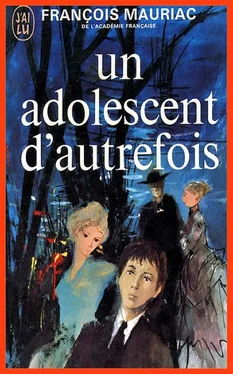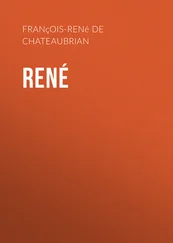— Il faut la prévenir puisque nous avons la chance de savoir par où elle attaquera… Mais d’abord, Alain, il faut que vous-même, de qui tout dépend, sachiez si vous êtes avec nous qui voulons vous délivrer. Simon Duberc m’assure que vous y êtes résolu. Peut-être l’étiez-vous le soir de votre rencontre et l’êtes-vous moins aujourd’hui ?
Elle cherchait mon regard, mais comme nous étions assis côte à côte, il m’était facile de le dérober. Je lui dis que j’étais résolu à tout et à rien, que je ne retournerais plus jamais sous un joug auquel j’avais déjà échappé en esprit, mais que je réservais mon jugement sur les moyens qui allaient m’être proposés.
Je ne sais trop comment à partir de là, ce fut surtout de Simon Duberc qu’il fut question entre nous. Elle me parla de lui avec abandon et je crois sans arrière-pensée, et ce qu’elle m’en rapporta donnait son sens à cette offre de Simon de tout quitter non pour me suivre « mais pour échapper à l’enfer de Talence ». Pauvre Simon. Son enfer était au-dedans de lui. Il avait été à Paris au bord du suicide. Il l’était toujours, retenu seulement par ce qui subsistait de foi en lui et qui l’avait gardé contre toutes les tentatives de ses nouveaux maîtres pour se servir de lui. Ils lui avaient suggéré d’écrire les confessions d’un petit paysan détourné de sa vraie voie par une dévote riche. Le plan du livre lui aurait été fourni, et il n’aurait eu qu’à en remplir en quelque sorte les casiers. Simon se cabra, on n’insista pas, et comme il donnait toute satisfaction au secrétariat, on le supporta… J’éclatai soudain :
— C’était donc pour parler de Simon que je vous aurai attendue plus de deux heures cet après-midi, que je me serai crevé dans le dédale de ces quartiers sinistres…
— Oui, c’est vrai que je vous parle de lui parce que je n’ose pas vous parler de nous, parce que je sais ce que vous allez croire… mais comment pourriez-vous le croire ? Vous savez de qui je suis la fille, les années que j’ai de plus que vous, ce que j’en ai fait, ou plutôt ce qu’on a fait de moi durant ces années-là — ce que de vieux hommes ont fait de moi. Ah ! Ce que j’étais à votre âge, Alain, ce que j’étais…
Non, elle ne jouait pas à ce moment-là, ou alors quelle comédienne ! Ce qui dut lui être horrible, ce fut mon silence. Je ne protestai pas, non par insensibilité mais parce que mes paroles de garçon bien élevé, les seules qui me venaient à l’esprit, eussent été pires que des injures.
Il fallait, me dit-elle, que je fusse assuré qu’en se mêlant de cette intrigue elle ne cherchait pas son intérêt, sinon cette sorte de plaisir que nous avons à délivrer une mouche avant que l’araignée l’ait dévorée. Enfin elle en vint à son plan de bataille : dès le prochain séjour de ma mère à Maltaverne, je lui annoncerais par lettre mes fiançailles avec « la libraire de chez Bard ». Marie consentait à ce que je me serve d’elle qui était bien en effet le genre de femme dont ma mère pouvait avoir le plus horreur : son milieu, son âge, ce que maman aurait vite fait de découvrir sur cette famille, sur le passé de Marie, il n’en fallait pas tant pour qu’elle me mît le marché en main ; et comme je lui tiendrais tête, pour qu’elle se retire sur sa terre de Noaillan et qu’elle emmène avec elle les Duberc.
Ici j’interrompis Marie : il me paraissait incroyable que les Duberc pussent être détachés de Maltaverne : ils y adhéraient comme l’huître à sa valve. Selon Marie, il n’y avait rien à redouter de ce côté-là : le vieux Duberc savait qu’il ne s’agissait que d’une ruse pour m’empêcher de tomber dans les filets d’une mauvaise femme de la ville. Lui aussi, comme « la mistresse », rêvait de régner un jour sur le domaine de Numa Séris, et il se croyait irremplaçable. Il ne doutait pas que dès la première semaine je le rappellerais.
Je demandai après un silence :
— Croyez-vous qu’elle ne parera pas le coup ? Vous ne connaissez pas ma mère.
— Je vous connais, vous, Alain. Sa force est faite de votre faiblesse. Vous êtes le maître de tout. Vous tenez tout, mais elle vous tient.
Je ne protestai pas. Marie se leva et sortit seule. Il ne fallait pas qu’on nous vît ensemble. Nous convînmes de nous retrouver jeudi avec Simon à la librairie.
Bien que je ne fusse pas en retard pour le dîner, maman, sur le palier, guettait mon retour. Je vis sa grande figure blême penchée sur la rampe : « Ah ! te voilà ! » Elle ne s’éloignerait plus, elle me garderait à vue, voilà ce que serait sa première défense. Or je n’imaginais réalisable le plan de Marie que durant un séjour de maman à Maltaverne. Il fallait que ce fût par lettre qu’elle apprît mes fiançailles. L’affronter à visage découvert, je n’oserais jamais. L’oserais-je, ce serait courir le risque d’être très vite démasqué. Je ne lui avais jamais menti sans qu’elle m’en fît honte aussitôt.
Durant tout l’hiver, sans me faire espionner, sans recourir à aucune filature, elle sut chaque jeudi que je sortais d’un conciliabule avec ses ennemis inconnus. Les soirs où Marie me guettait derrière sa porte, rue de l’Église-Saint-Seurin et m’introduisait dans le salon glacé, et qu’au retour j’allais donner à ma mère, si tard qu’il fût, le baiser rituel et obligatoire, j’avais beau d’abord m’arrêter au lavabo de l’office, me laver la figure et les mains, ma mère m’attirait à elle, me flairait, reconnaissait sur moi une odeur étrangère. Non qu’elle m’en ait jamais rien dit. Je savais qu’elle savait. Nous étions atrocement transparents l’un à l’autre.
Elle eut d’ailleurs cet hiver-là une preuve irrécusable que je la trompais. Moi qui détestais de danser, j’acceptais sans rechigner toutes les invitations, et presque chaque soir revêtais mon smoking ou mon habit. Ma mère qui, au départ, m’avait dit : « Tu me raconteras… » m’interrogeait à mon retour. Elle voulait tout savoir de la fête et avait vite fait de deviner que je ne savais rien parce que je n’y avais pas été ou que je n’y étais demeuré qu’un instant : ce qu’une facile enquête lui confirmait. Je ne faisais jamais que traverser les bals. Il y avait cette autre preuve, qu’elle ne me voyait plus communier, que je m’arrangeais pour n’assister jamais aux mêmes messes qu’elle. Même à Noël, je fus invité par un camarade à un réveillon à la campagne.
Louis Larpe remettait toujours à maman le courrier qu’elle triait elle-même. Il n’y eut jamais aucune lettre suspecte. Elle ne releva ni la piste de Marie, ni celle de Simon. Nous ne sortions plus jamais ensemble. Nous avions renoncé à nous rejoindre chez Prévost ou au café de Marie, au coin de la rue Esprit-des-Lois. Nous nous retrouvions soit à la librairie, après la fermeture, dans le « cagibi » de Marie, soit dans le salon de la rue de l’Église-Saint-Seurin. Comme il n’était pas question pour Simon de remettre les pieds rue de Cheverus, ce fut moi qui, à la belle saison, allai quelquefois le retrouver à Talence. Il y avait pris pension chez une veuve dans une de ces maisons sans étage que les Bordelais appellent échoppes. Il avait résisté longtemps à l’idée de m’y recevoir : incroyable distance qui s’établit entre les classes avec le consentement des pauvres et souvent contre la volonté des riches honteux de leur richesse, comme je l’étais.
C’était une chambre banale, meublée d’acajou, qui donnait sur un jardin de curé, et au-delà il y avait la route de Bayonne. Partout des revues, des livres, non des romans ni des poèmes, mais le Pascal de Boutroux, la Vie de sainte Thérèse par elle-même, le Saint François d’Assise de Joergensen, un saint Jean de la Croix… Il me dit à ma première visite, comme je m’étonnais de ces livres : « Je refais mon éducation religieuse, grâce à vous », et changea aussitôt de propos. Je me rendis compte, Ce jour-là, qu’il y allait de la vie pour lui que ce rêve s’accomplît : moi et lui à Maltaverne. C’était un rêve fou et pourtant réalisable.
Читать дальше