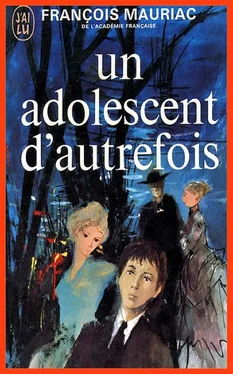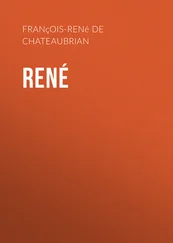De nous trois, Simon paraissait celui que l’ouverture des hostilités émouvait le plus. Il ne pouvait ignorer ce qu’avait dû être cette nuit pour Marie et pour moi, mais ne paraissait pas en souffrir.
Nous passâmes la matinée dans la cuisine des Duberc à peser chaque mot de la lettre qui allait porter le premier coup à ma mère et que Prudent devait lui remettre dès sa descente d’auto. Il y eut une première rédaction qui était toute de moi, éloquente et furieuse, où ma rancune se dégorgeait, dont Simon fut enchanté mais non Marie, et je me rendis à ses raisons. Nous nous décidâmes pour une lettre courte et correcte : « J’ai reçu ici en ton absence la visite d’une jeune femme qui est ma fiancée et que j’ai hâte de te présenter. Nous nous connaissons depuis plusieurs mois. Elle travaille chez Bard le libraire et elle est très cultivée. Sa jeunesse a connu de grandes épreuves… » Je rappelai la triste fin de son père que ma mère connaissait sans doute. Simon demanda : « Vous n’avez pas peur qu’elle ait un coup de sang ? » Je sentais qu’il était lui-même choqué de ces fiançailles (tout imaginaires qu’elles fussent, croyait-il). Une commise de chez Bard épouser le fils Gajac ! C’était tellement incroyable que Madame ne le croirait pas et flairerait le piège.
Il fallait aussi s’assurer que Prudent ne trahirait pas. Il avait toujours été ambitieux pour son frère. Voilà que Simon revenait à Maltaverne et que tous ses diplômes ne lui serviraient à rien ! Prudent, bien qu’il fût l’aîné, ne pouvait prétendre à la succession de son père, ne sachant ni lire ni écrire, s’il savait compter ; mais ce retour de Simon, quelle faillite ce devait être à ses yeux !
Pendant que les deux frères discutaient dans la cuisine, Marie me dit qu’elle voulait aller voir couler la Hure dont elle n’avait qu’entendu le ruissellement dans la nuit. Mais le Pou nous épiait, nous suivrait peut-être en se cachant derrière les pins. Je ne pouvais supporter la pensée de me trouver nez à nez avec cette petite fille hideuse. « Je serais capable de l’étrangler ! »
Marie me demanda si nous ne pouvions atteindre la Hure en évitant le parc. Oui, certes, les chemins de sable ne manquaient pas, où il n’y avait aucune chance que le Pou fût aux aguets. Nous sortîmes. Un reste de fraîcheur persistait avec des lambeaux de brume, mais déjà une cigale, puis deux, puis trois se répondaient, ne s’accordaient pas. Je dis à Marie : « Ne crois pas que je t’obligerai à vivre dans ce climat inhumain. Nous viendrons nous y replonger à certaines époques… » Elle ne me répondit pas. Elle marchait péniblement dans le sable. La rédaction de cette lettre avait dû lui être horrible. Elle me dit :
— Ce que ta mère va ressentir en la lisant, eh bien elle aura raison de le ressentir. Elle ne sait pas que je suis ton aînée de dix ans… Et ce que j’ai été durant ces années-là… Et toi ce que tu es…
— Ce que je suis ? Où est le mérite d’avoir eu cette enfance prolongée jusqu’à devenir ce monstre que tu appelles un ange ? Et toi, Marie, ceux qui auraient dû te garder étaient des loups dévorants…
Je vis qu’elle pleurait. Nous étions dans un pré au bord de la Hure. Nous nous assîmes sur un aulne abattu. Elle continua de pleurer contre moi. Je lui dis : « Fais attention aux orties. » Ces orties, autour de nous, deviendraient dans mon souvenir de la menthe dont je froisserais entre mes doigts les feuilles parfumées ; et ce maigre ruisseau sous ces aulnes dont plusieurs avaient été coupés, serait lié ainsi qu’il l’avait toujours été, à ce désespoir de l’écoulement éternel : il m’entraînait comme tout le reste et je ne comptais pas plus que les écorces de pin taillées en bateau que nous y faisions flotter, Laurent et moi. Et cette femme contre moi, et qui ne pleurait plus, ce pauvre corps qui avait servi à d’autres, dont j’avais consenti à me charger jusqu’à la fin de ma vie.
La brume ne se dissipait pas, mais le peu de soleil qu’elle laissait passer était accablant. Ce serait un jour d’orage. Peut-être pleuvrait-il enfin sur cette lande altérée où le feu prenait, ici ou là, chaque jour, allumé, disait-on, par les bergers, mais il suffisait d’un rayon de soleil sur un tesson de bouteille…
Quelle étrange alchimie au-dedans de moi transfigurait toutes ces choses de néant — comme si d’être passées leur donnait droit à la transfiguration !
Mieux valait attendre l’heure du train chez les Duberc où il faisait frais. Nous comptions le prendre à la gare du Nizan, à dix kilomètres de Maltaverne. Nous ferions le trajet dans la carriole de Prudent. J’avertis Marie qu’il faudrait partir, la dernière bouchée avalée, à une heure où la chaleur est telle que même le bétail ne sort pas. Marie murmura : « Pas même le Pou ! »
Sous le soleil de la deuxième heure, cette randonnée en carriole, dans un nuage de taons et de mouches, sur une route poussiéreuse et crevassée, ce fut le cauchemar auquel aboutissait pour nous le songe d’une nuit d’été. J’étais assis sur la banquette arrière à côté de Simon transpirant. J’avais mis la main entre le dossier et Marie pour lui amortir les cahots. Elle se tenait, raidie et muette, et moi, avec ce don que j’ai de ressentir ce que l’autre se retient d’exprimer, je savais qu’au-dedans d’elle le Maltaverne enchanté de la nuit s’était mué en une terre maudite et qu’il fallait la fuir sans tourner la tête. Nous entendîmes une trompe d’auto, puis ce fut le vacarme d’un moteur. Stella, la vieille jument, se cabra. Nous fûmes dépassés par une Serpollet qu’un monstre à lunettes pilotait. La poussière nous ensevelit au point que Prudent dut faire halte un instant au bord de la route.
Le train avait du retard. Nous attendîmes presque seuls sur le quai brûlant d’une gare perdue, au milieu de cages où des poules mouraient de soif.
Marie me supplia de ne pas venir rue de l’Église-Saint-Seurin, en l’absence de sa mère qui était à Soulac. Nous nous verrions à loisir dans son cagibi de la librairie. Rue de Cheverus, notre escalier, au sortir de la rue, paraissait un lieu de délices. Durant les trois jours que nous vécûmes ensemble Simon et moi, attendant la réponse de « Madame », nous quittâmes souvent le petit salon pour aller nous asseoir sur les marches de cet escalier glacé.
Les nuits, pires que les jours, voyaient surgir l’armée innombrable des moustiques les plus gros, les plus venimeux qui aient jamais existé sous nos latitudes. Comme j’avais une moustiquaire, il ne s’agissait pour moi que de bien m’assurer avant de m’endormir qu’aucune bête féroce n’était enfermée avec moi dans la cage. Mais le lit de Laurent ne comportait plus de moustiquaire. Je vis le lendemain que Simon était défiguré par une piqûre à la paupière. Il s’étonnait de ce que j’en paraissais affligé.
— Mais ce n’est rien, monsieur Alain. Hé bé, s’il fallait s’en faire pour des moustiques, pour une bouffiole à l’œil !
Il avait tout de même dormi et il était sorti à l’aube. Pour assister à la messe ? Je n’osai le lui demander, mais en vérité je n’en doutais pas. Après le déjeuner, nous nous retrouvâmes à la librairie obscure et fraîche et où les clients étaient rares. Bard séjournait à Arcachon et se reposait de tout sur Marie. Balège était malade, ou prétendait l’être. Je découvris dans la vitrine des nouveautés une Anthologie des poètes modernes, de Léautaud et Van Bever, et j’y avançai de découverte en découverte. Il y avait surtout un poème d’un certain Francis Jammes : Il va neiger dans quelques jours… qui m’enchantait, me « navrait de joie », mais je ne pus partager mon bonheur ni avec Marie, insensible à cette poésie-là, ni avec Simon, insensible à toute poésie, et qui, beaucoup plus que nous, attendait dans l’angoisse la réponse de « Madame ». Il me pressait de rentrer : « Ça va être l’heure du courrier… »
Читать дальше