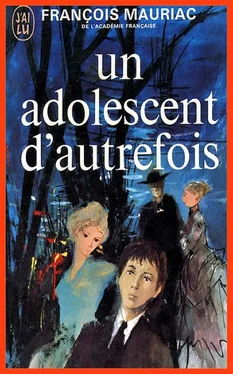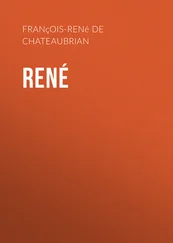— Que feras-tu pendant ces trois jours ?
— Je marcherai. J’irai une fois encore voir le vieux de Lassus pour observer ce que je serai dans soixante ans quand je serai le vieux de Maltaverne.
Je tremblais que maman ne se ravisât et trouvât un prétexte pour ne pas partir. Je ne respirai que lorsque j’entendis s’éloigner sur la route le bruit du moteur de la De Dion et que, seul sur le perron, je respirai avec délice la brume annonciatrice d’un jour torride, d’un jour interminable d’attente. Simon et Marie arriveraient par le train du soir. Prudent irait seul les accueillir à la gare et les amènerait à Maltaverne par un raccourci à travers bois, toujours désert le soir.
La femme de Prudent fit à fond la chambre de ses parents, mit au lit les plus beaux draps. Je lui dis de préparer à tout hasard au château (comme elle appelait la maison) la chambre à donner où la dame serait mieux à cause du cabinet de toilette. Elle obéit sans manifester d’étonnement.
Je ne voudrais rien écrire ici, concernant cette soirée et cette nuit, qui ressemblât à une de ces narrations dont André Donzac au collège était jaloux. Pourtant il faut que ce témoin de ma vie sache que ce fut l’instant qui l’éclaire, cette vie, qui lui donne sa signification parce que ce fut une nuit de péché et pourtant une nuit de grâce.
J’avais pris sa valise et l’avais précédée dans la chambre d’amis sans lui demander son avis ni celui de Simon. Dans sa robe claire d’été, sous son chapeau de paille, elle était une autre Marie que celle de chez Bard, la jeune fille que je n’avais pas connue, que d’autres avaient connue. Ce ne fut qu’une brève souffrance.
Nous nous retrouvâmes tous les trois à la salle à manger pour un repas rapide et silencieux. Ce fut elle qui me demanda de faire le tour du parc. Elle s’arrêta sur le perron. Je jetai sur ses épaules ma vieille pèlerine de collégien. Elle descendit les marches lentement. Elle me dit : « Tout m’était connu d’avance par vous. Tout est bien pareil à vous. » Je lui assurai que si elle avait été déçue, je ne le lui aurais pas pardonné.
Elle ne connaissait que les pins de Soulac, souffletés par la mer, auprès desquels ceux de Maltaverne ressemblaient à des géants. Je lui tenais le bras pour qu’elle ne s’écartât pas de l’allée. « C’est le gros chêne ? » Elle l’avait reconnu, bien que ce fût un chêne pareil à beaucoup d’autres ; j’y appuyai mes lèvres selon le rite, puis nous échangeâmes avec Marie notre premier baiser.
« Ce que j’aime tant à Maltaverne… » Sur ce thème j’étais inépuisable et Marie avait eu déjà les oreilles rebattues de mon hostilité aux beaux sites et que la nature ne me touchait que là où j’étais seul à pouvoir être atteint par elle, moi seul et les êtres qui l’aimaient par moi, en moi. Nous n’allâmes pas jusqu’au ruisseau parce que la prairie devait être mouillée, mais nous demeurâmes immobiles et sans parler, à l’écoute de ce ruissellement si furtif et qui dure et qui durera dans les siècles des siècles.
« Pourquoi, demandai-je à Marie, ce que je ne ressens pas au bord des grands fleuves ou même de l’océan, m’est-il donné par ce cours d’eau où enfant je lançais les bateaux que j’avais taillés dans une écorce de pin ? » Il y a loin de se connaître comme éphémère, à le sentir dans sa chair. C’est ce que le ruissellement de la Hure a appris à un petit garçon, dans ces nuits d’été d’autrefois où il s’arrêtait pour écouter le silence — ce silence tout vibrant de grillons et que traversait le sanglot d’un nocturne, l’appel des crapauds, où était perceptible le moindre froissement de branches.
Nous nous arrêtâmes au milieu de l’allée pour écouter le silence. Marie dit à voix basse : « Il me semble que quelqu’un marche, que j’entends craquer les aiguilles de pin. » Mais non c’était le vent, ou une belette : tant de bêtes s’entre-dévorent ou s’accouplent la nuit.
— Et nous aussi, que faisons-nous d’autre ? Et pourtant nous sommes autres.
Ce fut, cette nuit-là, l’heure de nos vies où peut-être nous approchâmes le plus de la vérité pressentie par nous deux (je le sais, parce que nous en parlâmes longtemps pieds nus sur le balcon, à l’heure du plus grand silence), que l’amour humain est la préfiguration de celui qui nous a créés — mais que quelquefois, comme cette nuit pour nous deux, et si coupable qu’il fût, il ressemblait à cet amour que le Créateur voue à sa créature, et la créature à son Créateur, et que le bonheur dont nous débordions Marie et moi était comme un pardon donné d’avance.
Je m’étais endormi. Je fus réveillé par un sanglot. Je la pris dans mes bras : pourquoi pleurait-elle ? Je ne compris pas d’abord ce qu’elle répétait à voix basse : « Plus jamais ! plus jamais ! »
— Mais non, Marie : pour toujours et à jamais. Elle protesta : « Tu ne sais pas ce que tu dis. »
Le plus étrange est qu’à ce moment-là rien ne subsistait de mes soupçons. Cette évidence qu’elle m’avait amené, non peut-être par ruse et assurément par amour, mais enfin qu’elle m’avait amené à cette promesse solennelle de me lier à elle pour toujours, ne tenait pas contre la révélation de cette nuit. Il n’y a pas de mensonge dans le bonheur que deux êtres se donnent. Cela du moins est vrai et l’était pour moi plus que pour un autre garçon de mon âge, puisque Marie m’avait guéri, m’avait délivré de je ne savais quel interdit. Peut-être pour un moment ? Mais non ! pour toujours ! pour toujours !
— Tu vois, lui disais-je, ce qui me déplaisait dans notre plan, et même m’était odieux, c’était de mentir encore à ma mère, de lui faire croire que je voulais t’épouser. Eh bien, ma chérie, je lui dirai les yeux dans les yeux : « Je vais t’amener ma fiancée »… Et ce sera vrai. Tu pleures ? Pourquoi pleures-tu ?
— Ta fiancée… Tu as raison : cela au moins aura été vrai. J’aurai été ta fiancée « pour de vrai » comme disent les enfants.
Je lui demandai si cette nuit elle n’avait pas été ma femme « pour de vrai ».
— Oui, cette nuit… Il y aura eu cette nuit.
Je lui dis : « Et toutes les nuits de nos deux vies… » Les coqs de métairie en métairie annonçaient l’aube. La femme de Prudent allait se lever. Marie avant de regagner sa chambre voulut revenir avec moi sur le balcon malgré le brouillard que les branches des pins semblaient arracher d’eux. Elle soupira :
— Maltaverne, je te regarde, je te regarde comme si je risquais de t’oublier jamais.
Je dis : « Quelqu’un marche dans l’allée. » Nous rentrâmes dans la chambre. Ce devait être Prudent ou sa femme. Le brouillard en tout cas nous rendait invisibles et nous ne parlions qu’à mi-voix. Notre dernière étreinte fut brève. Elle regagna sa chambre et je me laissai couler avec délices dans le sommeil dont me tira la femme de Prudent portant le plateau du petit déjeuner. Elle avait déjà servi son café à la dame. Je lui demandai si c’était elle ou son mari que vers six heures j’avais entendu marcher devant la maison. Non, ce n’était pas eux. Ça devait être… Elle hésita. Madame avait permis à Jeannette Séris de venir jouer dans le parc quand Monsieur n’était pas là. Elle y passait sa vie, elle y était comme chez elle. Ce matin, elle était sans doute venue lever les nasses qu’elle avait tendues hier soir dans la Hure.
— Elle était là hier soir ?
— Oh ! mais elle s’est bien cachée, elle n’a pas fait de bruit.
Je m’habillai en hâte et nous nous retrouvâmes tous les trois dans la cuisine des Duberc pour tenir conseil. Il n’y avait pas de doute que le Pou avait été chargé par ma mère de nous épier et qu’à peine débarquée, elle saurait tout. Nous n’avions plus le choix. Je résolus de partir avec eux pour Bordeaux et de confier à Prudent la lettre qui annoncerait à ma mère mes fiançailles. Simon viendrait habiter avec moi rue de Cheverus, il coucherait dans le lit de Laurent. C’est vrai que Bordeaux est inhabitable au mois d’août. « Mais notre hôtel de la rue de Cheverus est une glacière » selon maman. Si les opérations se déroulaient comme nous l’avions prévu, dès que ma mère et les Duberc auraient abandonné Maltaverne, nous nous y établirions pour ne plus le quitter.
Читать дальше