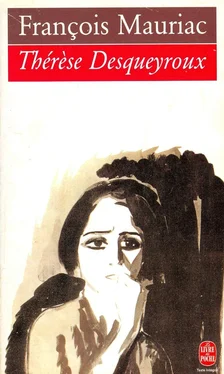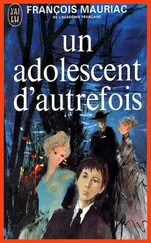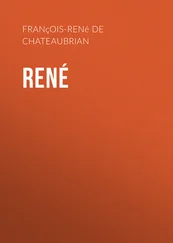François Mauriac
Thérèse Desqueyroux
Né à Bordeaux le 11 octobre 1885, François Mauriac perdit son père très tôt ; sa mère et les marianistes du collège de Grand-Lebrun à Caudéran l'élevèrent dans l'amour de Dieu. Cette éducation catholique, la fréquentation de la grande bourgeoisie bordelaise des Chartrons, l'attachement très vif qu'il portait au sol landais et aux vignes de sa jeunesse (sa famille possédait des vignobles : le Château Malagar) baignent, imprègnent une grande partie de son œuvre. Une œuvre lumineuse, consacrée aux mystères du péché et de la grâce, et à la défense de l'homme, ce fragment du divin.
Étudiant à la Faculté des Lettres de Bordeaux, il monta à Paris, envisagea un moment l'état de chartiste, puis, selon un schéma somme toute traditionnel, choisit la carrière d'écrivain. En 1952, le jury du Prix Nobel de littérature lui donna raison.
En 1909, son premier recueil de poèmes, les Mains jointes, est encensé par Barrès ; il sera suivi d'un autre, deux ans plus tard : Adieu à l'adolescence. La Première Guerre mondiale n'a pas encore éclaté que le jeune Mauriac compte déjà parmi les romanciers les plus prometteurs avec l'Enfant chargé de chaînes (1913) et la Robe prétexte (1914). Après une guerre effectuée en partie à Salonique (où il sera atteint d'une grave maladie), il revient au roman avec Préséances en 1921 et donne le fameux Baiser au lépreux un an plus tard. Suivront, comme autant de récits des combats de l'âme humaine, avec ses grandeurs, ses monstruosités, ses voluptés, Genitrix (1923), le Désert de l'amour (1925), Thérèse Desqueyroux (1927) — qu'il fera suivre en 1935 de la Fin de la nuit —, le Nœud de vipères (1932), la Pharisienne (1941) , le Sagouin (1951), Galigaï (1952), l'Agneau (1954). Auparavant, en 1933, l'année de parution du très autobiographique Mystère Frontenac, il avait été élu à l'Académie française.
Mauriac a également écrit plusieurs essais qui développent et complètent la réflexion religieuse poursuivie dans ses romans et qui permettent aussi de mieux comprendre comment chez lui l'écrivain et l'homme vivaient leur foi : la Vie de Jean Racine (1928), Souffrance et bonheur du chrétien (1930), la Vie de Jésus (1937), la Littérature et le péché (1938), Fils de l'homme (1958), Ce que je crois (1963), etc.
Il ne s'est pas satisfait d'écrire une œuvre superbe et tourmentée, il a aussi observé le monde autour de lui ; guettant et décryptant l'histoire de son siècle, il s'y est engagé. Antifasciste, soutenant les républicains espagnols (contre l'alibi catholique que se donnait Franco), intellectuel résistant, auteur d'un livre publié clandestinement par les Éditions de Minuit sous l'Occupation (le Cahier noir, pseudonyme : Forez), il a critiqué les excès de l'épuration et la condamnation à mort de Robert Brasillach. Pourfendeur des violences des guerres coloniales (Indochine, Algérie), il a par la suite défendu la V e République et rédigé un ouvrage sur le Général.
Le Journal (1934–1951), ses Blocs-Notes (chroniques de l'Express et du Figaro littéraire), Mémoires intérieurs et Mémoires politiques témoignent de la vigueur de ses combats éthiques, idéologiques, et de ses dons de polémiste. François Mauriac est sans doute le dernier grand chroniqueur politique du siècle.
Poète (Orages et le Sang d'Atys), romancier (à quatre-vingt-quatre ans il publiait encore Un adolescent d'autrefois), essayiste, journaliste, Mauriac a complété sa formidable panoplie avec du théâtre, martelant les planches de son obsession du péché (Asmodée, les Mal-Aimés, le Feu sur la terre).
Il est mort à Paris le 1 er septembre 1970.
« Seigneur, ayez pitié, ayez pitié des fous et des folles ! O Créateur ! peut-il exister des monstres aux yeux de celui-là seul qui sait pourquoi ils existent, comment ils se sont faits, et comment ils auraient pu ne pas se faire… »
Charles BAUDELAIRE.
Thérèse, beaucoup diront que tu n'existes pas. Mais je sais que tu existes, moi qui, depuis des années, t'épie et souvent t'arrête au passage, te démasque.
Adolescent, je me souviens d'avoir aperçu, dans une salle étouffante d'assises, livrée aux avocats moins féroces que les dames empanachées, ta petite figure blanche et sans lèvres.
Plus tard, dans un salon de campagne, tu m'apparus sous les traits d'une jeune femme hagarde qu'irritaient les soins de ses vieilles parentes, d'un époux naïf : « Mais qu'a-t-elle donc ? disaient-ils. Pourtant nous la comblons de tout. »
Depuis lors, que de fois ai-je admiré, sur ton front vaste et beau, ta main un peu trop grande ! Que de fois, à travers les barreaux vivants d'une famille, t'ai-je vue tourner en rond, à pas de louve ; et de ton œil méchant et triste tu me dévisageais.
Beaucoup s'étonneront que j'aie pu imaginer une créature plus odieuse encore que tous mes autres héros. Saurai-je jamais rien dire des êtres ruisselants de vertu et qui ont le cœur sur la main ? Les « cœurs sur la main » n'ont pas d'histoire ; mais je connais celle des cœurs enfouis et tout mêlés à un corps de boue.
J'aurais voulu que la douleur, Thérèse, te livre à Dieu ; et j'ai longtemps désiré que tu fusses digne du nom de sainte Locuste. Mais plusieurs, qui pourtant croient à la chute et au rachat de nos âmes tourmentées, eussent crié au sacrilège.
Du moins, sur ce trottoir où je t'abandonne, j'ai l'espérance que tu n'es pas seule.
L'avocat ouvrit une porte. Thérèse Desqueyroux, dans ce couloir dérobé du palais de justice, sentit sur sa face la brume et, profondément, l'aspira. Elle avait peur d'être attendue, hésitait à sortir. Un homme, dont le col était relevé, se détacha d'un platane ; elle reconnut son père. L'avocat cria : « Non-lieu » et, se retournant vers Thérèse :
— Vous pouvez sortir : il n'y a personne.
Elle descendit des marches mouillées. Oui, la petite place semblait déserte. Son père ne l'embrassa pas, ne lui donna pas même un regard ; il interrogeait l'avocat Duros qui répondait à mi-voix, comme s'ils eussent été épiés. Elle entendait confusément leurs propos :
— Je recevrai demain l'avis officiel du non-lieu.
— Il ne peut plus y avoir de surprise ?
— Non : les carottes sont cuites, comme on dit.
— Après la déposition de mon gendre, c'était couru.
— Couru… couru… On ne sait jamais.
— Du moment que, de son propre aveu, il ne comptait jamais les gouttes…
— Vous savez, Larroque, dans ces sortes d'affaires, le témoignage de la victime…
La voix de Thérèse s'éleva :
— Il n'y a pas eu de victime.
— J'ai voulu dire : victime de son imprudence, madame.
Les deux hommes, un instant, observèrent la jeune femme immobile, serrée dans son manteau, et ce blême visage qui n'exprimait rien. Elle demanda où était la voiture ; son père l'avait fait attendre sur la route de Budos, en dehors de la ville, pour ne pas attirer l'attention.
Ils traversèrent la place : des feuilles de platane étaient collées aux bancs trempés de pluie. Heureusement, les jours avaient bien diminué. D'ailleurs, pour rejoindre la route de Budos, on peut suivre les rues les plus désertes de la sous-préfecture. Thérèse marchait entre les deux hommes qu'elle dominait du front et qui de nouveau discutaient comme si elle n'eût pas été présente ; mais, gênés par ce corps de femme qui les séparait, ils le poussaient du coude. Alors elle demeura un peu en arrière, déganta sa main gauche pour arracher de la mousse aux vieilles pierres qu'elle longeait. Parfois un ouvrier à bicyclette la dépassait, ou une carriole ; la boue jaillie l'obligeait à se tapir contre le mur. Mais le crépuscule recouvrait Thérèse, empêchait que les hommes la reconnussent. L'odeur de fournil et de brouillard n'était plus seulement pour elle l'odeur du soir dans une petite ville : elle y retrouvait le parfum de la vie qui lui était rendue enfin ; elle fermait les yeux au souffle de la terre endormie, herbeuse et mouillée ; s'efforçait de ne pas entendre les propos du petit homme aux courtes jambes arquées qui, pas une fois, ne se retourna vers sa fille ; elle aurait pu choir au bord de ce chemin : ni lui, ni Duros ne s'en fussent aperçus. Ils n'avaient plus peur d'élever la voix.
Читать дальше