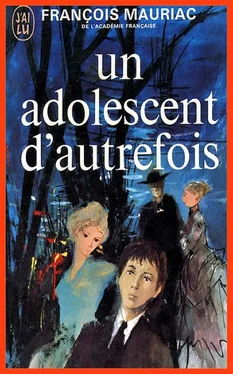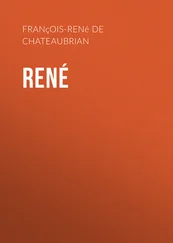— Non, Simon : ce qui résiste au contraire à ces formules, à ces mécaniques verbales, à ce dressage, et qui ne relève pas de l’automate en nous… Mais vous me comprenez. Vous êtes le seul à pouvoir me comprendre !
Il me demanda à mi-voix avec une ardeur contenue : « Qu’est-ce qui vous le fait croire ? »
Mais à quoi bon servir à Donzac une conversation arrangée et retouchée et dont l’essentiel d’ailleurs me venait de lui ? Ce qui a compté dans la rencontre de ce soir-là, ce qui a peut-être changé ma vie, ce qui l’a rendue à jamais différente de ce qu’elle eût été si ce spectre, Simon, n’y avait pas reparu, je voudrais le cerner, l’isoler du contexte… ou plutôt non ! Il faudrait écrire : ce qui a empêché ma vie de changer au moment où Marie allait en dévier le cours, ce qui a fait rentrer dans son lit le ruisseau landais entre ses aulnes pareils à des gardiens incorruptibles… Je suis sûr que c’est ce soir-là, et non plus tard, que Simon m’a rendu capable de traiter ma mère en ennemie, car c’est bien dans ce petit salon de la rue de Cheverus qu’il m’a ouvert les yeux ; or il n’en a jamais plus passé le seuil, ma mère étant revenue de Maltaverne, le surlendemain, après l’achat de la Tolose.
Désormais, j’allai chaque jeudi, vers quatre heures, chez Bard où Simon m’attendait. Marie en proie aux clients me souriait de loin. Nous sortions, Simon et moi. Je l’amenais chez Prévost. Je ne m’asseyais pas en face de lui pour ne pas le voir tremper son croissant beurré dans le chocolat. Nous retrouvions Marie après la fermeture de la librairie, non plus dans son café du coin de la rue Esprit-des-Lois (depuis le retour de ma mère nous étions devenus prudents) mais dans le salon glacé de la rue de l’Église-Saint-Seurin.
Mais il faut d’abord que Donzac sache ce que Simon m’avait livré, ce soir où il vint rue de Cheverus. Ce secret, lui-même le tenait de Prudent, son frère, qui le lui avait raconté lors de son unique visite à Talence. Ma mère n’était point si persuadée que je l’avais cru de ma soumission et de sa victoire finale. À vingt et un ans, je pouvais être la proie du premier venu, de la première venue. Le risque était que quelqu’un, attiré par ma fortune, me mît le grappin. Mon hostilité au mariage ne la rassurait plus parce qu’elle comprenait que le mariage était pour moi l’unique défense sûre contre le Pou. Les années dangereuses, croyait-elle, c’étaient celles de ma vie d’étudiant à Bordeaux. Que je ne fusse pas une proie facile, elle le savait. Elle connaissait cette force d’inertie que j’opposais à toute tentative de séduction. Mais il suffirait d’une rencontre pour éveiller en moi un homme pareil aux autres, pire que les autres. Tant que je ne serais pas revenu à Maltaverne, que je n’y serais pas revenu pour toujours, rien ne serait gagné. Quand elle m’y aurait ramené enfin, que j’y aurais jeté l’ancre à jamais, alors tout s’accomplirait de ce qu’elle avait résolu.
L’important, comme elle l’expliqua au vieux Duberc (c’est de lui que Prudent tenait tout ce qu’il rapporta à son frère), était de ne pas se laisser surprendre. « Je ne l’ai plus en main, répétait-elle, je sens qu’il m’échappe. » Si je décidais de me marier, selon maman, le pire serait que je fisse un choix convenable qui ne soulèverait aucune critique. Mais même alors, elle saurait bien découvrir des impossibilités : il y a toujours des impossibilités. Je devrais me soumettre à son veto qui serait absolu. Elle tirait toute sa force de mon incapacité à mener mes affaires, à y arrêter seulement ma pensée. En dépit de mes succès scolaires dont elle s’enorgueillissait le jour de la distribution des prix, elle me jugeait selon l’échelle de valeurs qui avait cours chez les siens : la même que celle du Père Grandet. Rien n’a changé en France depuis Balzac. « Un pauvre être », voilà ce que j’étais pour maman en dépit de toutes mes lectures.
Si donc je m’obstinais, elle se retirerait sur ses terres de Noaillan, et me laisserait seul avec mes deux mille hectares sur les bras. Ce ne serait pas le pire : pour que je n’aie aucun recours, elle avait obtenu la promesse des Duberc qu’ils la suivraient à Noaillan, de sorte que je n’aurais rien d’autre à faire que de me soumettre, ne pouvant me passer à la fois de ma mère et de mon régisseur. Ce serait pour mon bien, elle me sauverait malgré moi. Je croyais l’entendre : « Je t’ai porté et je te porterai jusqu’à la fin de ma vie. »
Simon avait d’abord parlé d’un ton détaché et comme par devoir : « Il faut que vous sachiez, monsieur Alain… » Mais une rancune accumulée depuis sa petite enfance contre « madame » sourdait peu à peu à travers chaque mot. Quant à ce que je ressentais moi-même… Maman n’avait pas besoin d’être là pour me frapper d’une sorte de stupeur. Elle me tenait, elle avait raison de n’en pas douter. Je soupirai : « Il n’y a pas de remède ! »
— Mais si ! monsieur Alain, il y a un remède. C’est Marie qui en a eu l’idée. Elle vous délivrera si vous y consentez.
Il s’entêta à ne rien vouloir m’en dire : c’était à elle, et non à lui de m’exposer le plan qu’elle avait conçu. Tout à coup, après un silence, il me dit avec une brusque passion, comme assourdie : « Pour moi je vous jure, monsieur Alain, que si jamais vous vous trouviez sans régisseur, sans personne, eh bien, vous savez je connais les limites aussi bien que mon père. Faites-moi signe, j’accourrai. Oh ! ne croyez surtout pas que je quitterais tout pour vous. Non, mais je renoncerais à l’enfer qu’est ma vie à Talence pour retrouver Maltaverne… »
— Et Maltaverne, c’est moi.
Il détourna la tête, se leva : « À jeudi, à la librairie. »
J’écoutai décroître le bruit des pas de Simon dans l’escalier, puis se refermer la lourde porte. J’émergeai de ma stupeur qui était à demi jouée, ou enfin qui était celle que je laissais paraître dès que maman entrait en scène. Mais ce soir-là, quand je fus seul, je cédai à une sorte de rage froide non pas contre elle seule, mais contre Marie qui se permettait d’avoir un plan : c’était l’irritation de celui qui passe pour le plus faible et qui inspire de la pitié aux femmes, alors qu’il déborde au-dedans de lui d’une force infinie. « Elles verront ! elles verront ! » Que verraient-elles ? L’important serait de garder ma tête froide. Ce que j’avais appris d’heureux ce soir-là c’était que Simon quitterait tout à mon premier appel. « Pour échapper à son enfer », m’avait-il dit. Peut-être… Mais il ne le ferait pour personne d’autre. Quoi qu’il pût advenir, je ne serais pas seul.
Ma mère revint de Maltaverne le surlendemain, encore toute fumante du combat soutenu pour l’achat de la Tolose : cent hectares de pins et de chênes centenaires à cinq kilomètres du village. Numa Séris en avait jugé le prix excessif. Elle ne doutait pas quant à elle d’avoir fait un excellent placement. Après le dîner, nous nous assîmes au coin de son feu dans le petit salon. Je lui demandai, du ton distrait que je prends quand il s’agit de questions de cet ordre, d’où venait l’argent qui lui avait permis d’acquérir la Tolose.
— Oh ! j’ai pris dans les réserves que j’ai toujours.
— Oui : les poteaux de mine, la récolte de gemme de cette année. Sans compter cette coupe de pins au Brousse…
Elle me regarda. J’avais ce visage absent qui lui était familier et qui sans doute la rassura.
— L’important, dit-elle, c’est d’avoir l’argent, non de savoir d’où il vient…
— C’est important pour moi. Si tu as payé la Tolose sur tes revenus personnels de Noaillan, la Tolose est à toi. Si c’est sur les revenus de Maltaverne…
Читать дальше