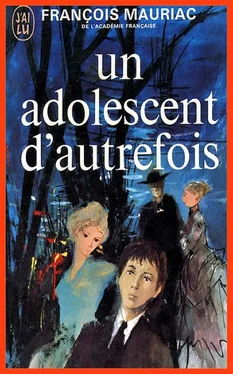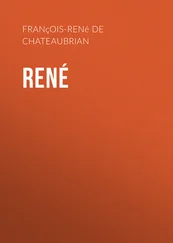Ce fut M. le Doyen qui me résuma ce que M me Duport venait de leur rapporter : Simon ferait sa licence en un an si possible à Paris, où il aurait une place au secrétariat du Parti radical, rue de Valois ; mais derrière cette façade se développait un plan que M me Duport avait surpris et qui consistait à exploiter à fond tous les souvenirs du petit et du grand séminaire de Simon. Il n’y en avait aucun, selon M. Duport, dont il n’y eût beaucoup à tirer. Il s’était fait prêter les cahiers de cours de Simon, il faisait passer au crible les manuels d’Histoire et de Philosophie.
— Comment Simon y a-t-il consenti ?
— On lui a fait croire que l’examen de ses cahiers de premier élève de sa classe aiderait beaucoup à sa nomination.
M me Duport intervint alors : « Simon était trop fin pour ne pas avoir compris qu’il trahissait. » Je protestai :
— Simon n’a pas cru que ses cahiers de classe pussent tirer à conséquence.
En fait, que pouvait-on en tirer ? Des manuels, oui peut-être. Ceux de mon collège, à l’usage des maisons d’éducation chrétienne, étaient truffés de cocasseries dont nous avions dressé le répertoire, Donzac et moi. En tout cas ce n’était pas trahir que de communiquer ce qui était déjà à portée de tout le monde. Simon voulait tâter du fruit défendu. Le Doyen me demanda s’il me l’avait dit.
— Je l’ai compris : les jeux sont faits.
Le Doyen protesta : « Non ! Il nous reviendra ! » Je secouai la tête. Je murmurai : « Il est perdu. »
— Perdu pour nous, peut-être, dit ardemment le Doyen, mais pas perdu, le pauvre enfant, non ! non ! Pas perdu.
Je l’ai aimé, ce pauvre prêtre, à ce moment-là. Je l’assurai que je le croyais comme lui. Quant à maman, elle se tairait tant que M me Duport serait là ; mais M me Duport paraissait faire corps avec le fauteuil qu’elle emplissait de sa masse. Elle me regardait non pas furtivement : je sentais ses yeux sur moi. Alors maman, qui, en toutes circonstances, savait ce qui se fait et ce qui ne se fait pas, se leva et nous obligea tous à nous lever, sauf M me Duport qui dut sentir le congé que lui signifiait maman, adouci d’une formule de gratitude pour les renseignements qu’elle nous avait donnés. M me Duport se leva enfin, vint vers moi et me dit : « Vous viendrez me voir avant la rentrée. Nous parlerons de lui. »
Je m’excusai, la rentrée des classes était dans quinze jours.
— Mais non, pas pour vous cette année : vous êtes bachelier. Simon m’a dit que vous resteriez à Maltaverne pour la chasse à la palombe.
Ils parlaient donc de moi ! C’étaient ces êtres-là que j’intéressais. M lle Martineau ne parlait de moi avec personne.
— Oh ! La chasse et moi !
— Alors justement vous aurez le temps.
Elle avait le sourire hermétique des personnes qui ont des dents à cacher. Le Curé, outré, dit sur un ton d’autorité : « Je vous accompagne, madame ! » et l’entraîna jusqu’au perron. Comme je descendais derrière M me Duport et le Doyen, maman m’ordonna : « Non, reste ! » Nous rentrâmes au salon. Elle se laissa tomber sur un fauteuil, mit sa tête dans ses mains. Pour prier ou pour rager ? Je crois qu’elle essayait de prier et qu’elle luttait contre la rage qui enfin éclata.
Pauvre maman, tout ce que je redoutais qu’elle dît sortait d’elle à flots pressés. Elle fit le compte de ce qu’elle avait payé pour Simon depuis dix ans. Plus on en fait, plus ils vous volent. Ah ! Nous aurons été bien roulés.
— Non, j’exagère, je n’ai pas été roulée puisque je n’avais aucune illusion. Comme dit M. le Doyen, il faut se donner et se donner en sachant qu’on ne recevra rien en échange.
— C’est peut-être vrai pour M. le Doyen, dis-je, mais pas pour nous. Rassure-toi, tu te seras bien payé sur la bête.
Maman interloquée me demanda : « Sur quelle bête ? »
— Sur cette vieille bête de somme de Duberc, qui gère tes dix métairies, pour trois cents francs par an, seul à connaître les limites des propriétés, de sorte que s’il nous quittait aujourd’hui nous serions à la merci de tous nos voisins…
— À qui la faute si ton frère et toi, vous êtes des propres-à-rien, si vous n’êtes pas capables de connaître les limites…
— Tu sais bien que ça ne s’apprend pas, qu’il faut être du pays et y avoir toujours vécu. Tu as vu souvent Duberc battre les fourrés, creuser la terre à un endroit que rien ne signale, et la borne apparaît entre les ronces tout à coup. Tu ne pourrais pas te passer de lui. Il pourrait te faire chanter, exiger le triple de ce que tu lui donnes, ce serait encore incroyablement peu.
— C’est trop fort ! Il est logé, éclairé, chauffé, il a le lait, la moitié du cochon.
— Oui, il ne saurait que faire de l’argent que tu ne lui donnes pas. Alors lui te donne son travail pour rien.
Elle gémit : « Tu es toujours de leur côté contre moi… » A ce moment, le Doyen reparut. Il avait ramené M me Duport chez elle et avait fait semblant de continuer jusqu’à la cure.
— Mais me revoilà, il faut que nous parlions.
— Pas en tout cas avec ce petit nigaud qui se vantait de faire changer d’avis Simon et qui maintenant l’approuve, me donne tort.
— Je n’avais rien promis. Je croyais savoir ce qu’il fallait dire à Simon. Je ne me trompais pas, mais c’était trop tard.
— En tout cas, nous aurons fait ce que nous pouvions, vous et moi.
Maman s’adressait au Curé. Elle exigeait son approbation, un satisfecit. Il se taisait, pareil à Simon par la forte ossature paysanne et par la maigreur : une grande charpente décharnée — et cette face pétrie et repétrie ressemblait à de la terre glaise, avec les deux yeux comme des gouttes vitrifiées. Il se taisait, elle insista : « Oui ou non, n’avaient-ils pas fait l’impossible ? » Le Curé répondit à mi-voix par un mot de patois de chez nous que je ne sais comment orthographier : Beleou (le « ou » terminal à peine appuyé et qui signifie « peut-être »). Ce Beleou, aucun paysan ne le comprendrait au-delà de vingt kilomètres autour de Maltaverne.
— Nous avons voulu donner un prêtre à l’Église.
— C’est mal poser la question, dit le Curé. Nous ne disposons pas de la vie d’un autre, fût-ce pour la donner à Dieu, surtout s’il dépend matériellement de nous. Ce que nous pouvions faire, enfin c’est ce que je croyais vouloir faire pour Simon, c’était de déceler la volonté de Dieu sur cet enfant, c’était l’aider lui-même à y voir clair en lui.
Je fus frappé de ce que le Curé disait : « Ce que je croyais vouloir faire. » Je ne pus me contenir et murmurai : « Oui, mais voilà, vous aviez d’autres motifs ! » Maman eut de nouveau une « bouffée » :
— Fais des excuses à M. le Doyen, tout de suite !
Le Curé secoua la tête : Pourquoi des excuses ? Je ne l’avais pas offensé.
Je le regardai, j’hésitai, je lui dis enfin :
— Vous, M. le Doyen, vous paraissez vous agiter comme nous tous dans cette comédie dérisoire, mais il y a ce presbytère lépreux, salpêtré, où vous êtes seul le soir, il y a cet autel où vous officiez le matin dans une église presque vide. Vous, vous savez.
— Quel rapport cela a-t-il avec Simon ? demanda maman.
— Il y a cet échec, ce monotone échec qui frappe moins avec les adversaires qu’avec les prétendus fidèles. Les ennemis, eux du moins, témoignent par leur haine que l’Église est encore capable de susciter une passion.
Le Curé m’interrompit :
— Il vaut mieux que je m’en aille, tu vas déparler, comme dit Madame.
Il se leva. Laurent entra à ce moment. Je détestai son odeur à la fin d’un jour d’été, mais j’étais content qu’il fût là. Il créait, par sa seule présence, une zone où tout se désamorçait. Rien n’avait plus d’importance que les collets qu’il avait tendus, que le petit de Diane qu’il dressait en s’aidant d’un collier de force, comme une brute qu’il était. Cette opinion bonne pour les goujats : qu’il y a au monde quelque chose d’important… C’est un mot de Barrès que Donzac aime à répéter. Je dis :
Читать дальше