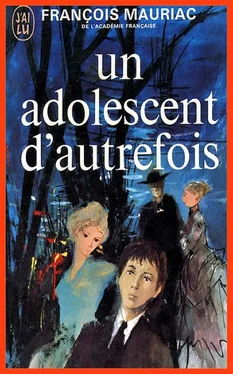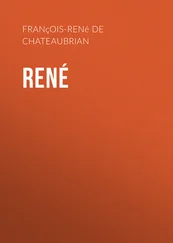Ah ! Le brouillard de ce matin de septembre, son odeur… Moi je ne mourrai pas, moi je vivrai. Maman avait fait parvenir aux demoiselles une lettre qui leur annonçait mon arrivée et notre malheur. Mademoiselle Louise et Mademoiselle Adila m’attendaient dans le désarroi du plaisir inespéré que leur causait ma venue, de la commisération et du chagrin. Mais la joie dominait, surtout chez M lle Adila, condamnée à vivre avec une sourde « qui comprenait tout au mouvement des lèvres », à sept kilomètres du bourg, dans ce quartier perdu où l’unique route venait mourir et au-delà, c’était la grande lande déserte jusqu’à l’océan. L’une de ces antiques métairies au bord d’un immense champ de millade, j’aime à penser que nous sommes issus de l’une d’elles. Ce matin-là, les alouettes chantaient au-dessus du champ, ces alouettes que Laurent ne tirerait plus. On avait ouvert pour moi au soleil levant une vaste chambre qui sentait le moisi, où je savais que le père des demoiselles s’était suicidé après sa ruine, mais on ne savait pas que je le savais. Je déposai sur la table le Pascal de Brunschvicg, une copie dactylographiée de l’ Action de Maurice Blondel que m’avait prêtée Donzac et Matière et Mémoire de Bergson ; et j’allai aussitôt fouiller dans la bibliothèque du « salon de compagnie » qui m’avait dispensé, quand j’étais enfant, un bonheur tel qu’il me semble que ceux qui ne l’ont pas connu ne savent pas ce qu’est le miracle de la lecture, quand rien du dehors ne vient rider la surface d’un jour de grandes vacances, quand le paysage réel s’accorde au paysage rêvé et que l’odeur même de la maison est déjà telle en nous qu’elle sera à jamais quand, depuis bien des années, la maison n’existera plus.
Ce n’était pas Bergson que je lisais, ni Pascal ni les Annales de Philosophie chrétienne, mais Les Enfants du capitaine Grant, l’Île mystérieuse, Sans famille. La chambre de Laurent, telle que je l’avais entrevue par la porte entrebâillée, à la lueur tragique de la veilleuse, demeurait pourtant en moi. Je n’en perdais jamais conscience, j’en nourrissais mon angoisse et mon chagrin, mais peut-être aussi le bonheur d’avoir dix-neuf ans et de déborder de vie.
J’entendis M lle Adila qui avait pris l’habitude avec sa sœur de crier à tue-tête, dire à la cuisinière : « Si un malheur arrive, quel parti sera M. Alain avec ses trois mille hectares… »
— Eh ! bé ! oui, mais tant que sa maman vivra, elle sera maîtresse…
— Tais-toi, Pecque ! cria M lle Adila. Sa maman a son bien à elle, près de mille hectares, une maison toute montée à Roaillan et de l’argent liquide, Dieu sait !
— Oui mais…
Je suis sorti pour ne plus entendre. Laurent était vivant, il vivait. Maman nous aimait tous les deux. Le Doyen vint m’apporter des nouvelles dans l’après-midi : « Ta mère est comme toujours admirable. Elle ne quitte pas Laurent une partie de la nuit pour que la sœur du Bon Secours puisse dormir. Elle est résolue à ne pas te voir, même de loin. Elle consent à ce sacrifice. Hélas, il n’y aura pas longtemps à attendre. » Pour la première fois ce jour-là j’entendis le nom fatal : « phtisie galopante ». J’entendis ce galop retentir en moi, qui emportait mon frère aîné à jamais dans une ténèbre où je le suivrais moi aussi, non peut-être au galop, mais au pas ; et si lentement que j’avance, je finirais par devenir pareil au vieux de Lassus avec mes trois mille hectares et une meute d’héritiers qui me harcèleraient, que je haïrais, que je tiendrais comme lui à distance. Horreur de la possession. La possession, mal absolu. Comment faire pour s’en dégager ? Je renoncerais volontiers aux biens de ce monde, non au monde lui-même, non à cette joie panique dont je débordais ce jour-là, sous les chênes de Jouanhaut, pendant que mon frère était emporté au galop dans la nuit qui ne finira pas.
Dès le lendemain, je crus voir à l’œil nu chez les demoiselles, comme tombé du ciel, le microbe de la propriété : une affreuse petite fille de dix ans, Jeannette Séris, leur héritière, qui à ce titre venait faire des séjours chez les demoiselles et recevoir les adorations des métayers. Le plus étrange est que, fille unique, ce monstre posséderait un jour l’un des plus vastes domaines de la lande et que la propriété des demoiselles s’y perdrait comme une goutte d’eau. Mais chaque hectare comptait pour ces boulimiques de la terre. Jeannette me faisait horreur. Petite fille blafarde et tavelée, on eût dit que deux de ses taches de rousseur étaient devenues phosphorescentes pour tenir la place des yeux, sans sourcils ni cils. Un peigne rond maintenait en arrière du front ses quelques cheveux. On faisait venir les enfants des métayers pour jouer avec elle. « Qué diz à mamizelle ? » Ils lui étaient soumis comme les petits moujiks aux petits boyards du temps du servage. Le lendemain matin, au réveil, j’entendis M lle Louise crier à M lle Adila : « … Mais il n’a même pas dix ans de plus qu’elle. Il attendra ! » M lle Adila dut répondre par le seul mouvement des lèvres, car je n’entendis rien. La sourde insista : « Il ne se mariera pas sans la permission de sa mère. Il attendra le temps qu’il faudra… » Oh ! Dieu ! C’était de moi qu’il s’agissait et de Jeannette. On en parlait dans le pays, comme autrefois des fiançailles du dauphin de France et de l’infante d’Espagne. Mais cette fois j’étais seul désigné, Laurent ne partageait plus le risque horrible. Que ce fût déjà résolu dans l’esprit de maman, je n’en doutais pas. Pour comble, la petite me recherchait, cette horreur, elle me faisait des grâces. Elle y pensait elle aussi. Ce fut cette semaine-là que j’eus honte de mon ignorance, de mon indifférence pour tout ce qui touchait à la question sociale. Je résolus de lire Jaurès, Guesde, Proudhon, Marx… Ce n’étaient que des noms pour moi. En tout cas, je savais mieux qu’eux ce qu’est la propriété. Qu’elle soit le vol, je m’en moquerais, mais elle est ce qui avilit, ce qui dégrade.
Après deux ans, je commence à Bordeaux un nouveau cahier. Le premier, Donzac m’a supplié de l’emporter à Paris où il est entré au Séminaire des Carmes. C’est pour lui que je me décide à reprendre ce journal. Un journal ? Non : Le récit composé, ordonné, de ce qui m’a été fourni au jour le jour par notre histoire, à maman et à moi, durant ces deux années — mais d’abord pour essayer d’y voir clair dans ce que je suis devenu depuis la mort de Laurent.
Ce que je suis devenu ? Suis-je devenu un autre ? Le garçon de vingt et un ans qui prépare sa licence de lettres à Bordeaux est-il différent de l’adolescent que j’étais ? Le même, condamné à rester le même, si je ne meurs comme Laurent. Le vieux de Maltaverne que je porte en moi succédera dans l’histoire secrète de la grande lande au vieux de Lassus et sera, octogénaire, ce même être que je suis, et quelque enfant poète de 1970 le regardera de loin, assis immobile sur le seuil et devenu minéral.
Ce n’est pas moi que la mort de Laurent a changé, ce sont les conditions de ma vie. J’ai été comme stupéfait pendant des mois. Maman prenait tout sur elle, n’ayant en ce qui me concernait d’autre souci que ma santé physique. J’avais « un voile sur le poumon gauche ». Elle n’a eu de cesse que je n’aie été réformé. Je m’en suis réjoui et j’en mourais de honte. Cela m’a rendu plus sauvage et je lui en ai voulu. Libérée de son inquiétude, elle a été prise chaque jour un peu plus par Maltaverne où, comme nous avons acheté cette année une automobile, une Dion-Bouton, elle se rend à chaque instant pour de brefs séjours. Il n’y a plus de distance. L’an dernier encore, il fallait changer deux fois de train pour atteindre Maltaverne. Le dépaysement commençait dès le hall de la gare du Midi. La grande lande, mon unique patrie, était aussi éloignée qu’une étoile. Aujourd’hui, je sais qu’elle commence aux portes mêmes de Bordeaux et que, par la route, s’il n’y a pas de panne de carburateur, ou si nous ne crevons pas, nous pouvons faire en moins de trois heures les cent kilomètres qui séparent Bordeaux de Maltaverne.
Читать дальше