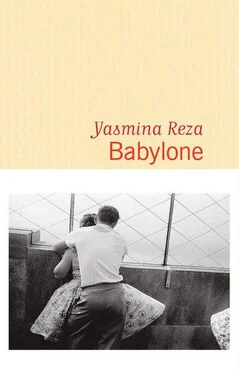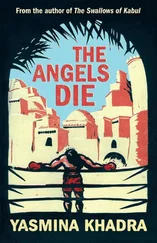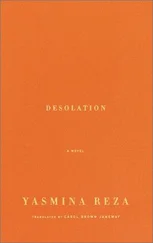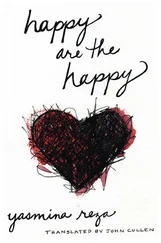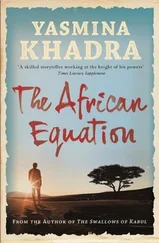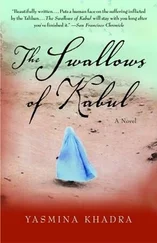— Ma théorie, a dit Ginette, c’est que ça lui est tombé dessus en s’occupant des cadeaux. C’est la fatigue de la vie qui lui est tombée dessus.
— C’est possible…
Elle a récupéré son manteau en feutre.
— Madame Anicé, ça vous ferait plaisir une housse de coussin au crochet ?
— Ah ce sont les housses que faisait votre maman… C’est gentil mais je n’ai pas de coussins chez moi.
— Ou un napperon repose-tête ?
— Le napperon en souvenir, allez !… Et ça c’est la photo qu’il y avait dans la chambre de votre maman !
Ça m’a exaspérée qu’elle dise votre maman . Je n’aime pas ces infantilisations soporifiques. Elle parlait d’une photo d’Emmanuel à La Seyne-sur-Mer. Ma mère avait cette photo dans un cadre sur sa table de nuit. Une photo de son petit-fils âgé d’une douzaine d’années, en maillot de bain avec un chapeau. Elle avait aussi une ancienne photo d’anniversaire des enfants de Jeanne. Je me suis toujours demandé ce que ces images signifiaient pour elle, je veux dire émotionnellement. À mon avis, elle ne les voyait pas, ces cadres étaient posés à côté de son lit par convention. On vit sous le régime de la convention. On est sur des rails. Avant de partir, Ginette Anicé m’a annoncé qu’elle avait quitté le dispensaire et ne voulait plus faire que des domiciles. En fait elle était au chômage. J’ai dit que je demanderais autour de moi, alors que jamais je ne la recommanderais à qui que soit. J’ai refermé la porte et j’ai regardé la photo. J’ai regardé le petit corps d’Emmanuel. Ses bras maigrichons. Il était l’enfant le plus affairé de la plage. Toujours un seau à la main, le transportant vide ou plein, allant de l’eau aux fourrés qui bordaient le sable pour fabriquer on ne sait quel monde miniature, revenant des dizaines de fois, cherchant des pierres, des bouts de bois, des coquillages, des bêtes diverses dans l’écume. Quand il se baignait, ce n’était jamais pour nager. Debout dans l’eau jusqu’à la taille, il me disait, maman, dis-moi qui tu veux voir mourir ? Je disais le nom d’un de ses profs du collège (c’était le jeu).
— Monsieur Vivaret !
— Monsieur Vivaret d’accord !… Mais que faites-vous Emmanuel ?!… Pcch ! Pchh ! Pchh !!
Il explosait dans les vagues avec d’effroyables rebonds.
— Madame Pellouze !
— Emmanuel, veuillez poser ce kalachnikov !!!… Pchhh ! Pch !!! Pchhhhh !!
— Madame Farrugia !
On les tuait tous un par un.
Aujourd’hui tu es Content Champion pour une agence de com. Quand on te demande ce que tu fais, tu dis Chef de projet-Consultant éditorial (le titre anglais est tellement mieux !). La photo me redonne ton corps d’avant. Je n’y pensais plus. Je n’ouvre jamais les albums que je faisais autrefois. Ces bras maigres, je voudrais encore les sentir en collier. Moi aussi je me fous du global, elle a raison cette Anicé.
Un jour, sans que rien ne l’annonce, Rémi avait mis ses bras autour du cou de Jean-Lino Manoscrivi. Ça s’est passé un dimanche à l’Hippopotamus. Ils déjeunaient tous les trois et un couple d’amis de l’atelier de jazz de Lydie. Rémi qui s’embêtait comme tous les enfants à table avait eu la permission d’aller faire des bulles sous la véranda ouverte. Jean-Lino le surveillait d’un œil quand tout à coup plus de Rémi. Jean-Lino va voir. Pas de Rémi. Il descend les marches, regarde de tous les côtés de l’avenue du Général-Leclerc. Rien. Il retourne à l’intérieur, monte à l’étage. Personne. Mamie Lydie s’affole. Jean-Lino et elle ressortent. Ils partent à droite, à gauche, tourbillonnent, retournent dans l’Hippopotamus, interrogent les serveurs, ressortent. Ils crient le nom de l’enfant, le paysage urbain est vide, ouvert à tous les vents. Les amis chanteurs sont restés à table, pétrifiés, ne touchant plus leur assiette. Non loin d’eux un couple, discrètement, leur désigne du menton une desserte à laquelle est accolé un genre de palmier en pot. La copine de Lydie finit par comprendre les signes, se lève et trouve Rémi accroupi, réjoui de sa blague, planqué derrière le bac à fleurs. Les Manoscrivi hagards reviennent. Lydie se jette pour serrer l’enfant. C’est à peine s’il n’est pas félicité pour sa réapparition. Tout rentre dans l’ordre. Jean-Lino n’a pas dit un mot. Il s’est rassis, blême et sombre. Rémi lui aussi a repris sa place. On lui propose une île flottante. Il se balance sur sa chaise en garçon satisfait et puis on ne sait pourquoi il se lève et vient entourer Jean-Lino de ses bras et poser sa tête sur ses épaules. Le cœur de Jean-Lino s’est gonflé de façon déraisonnable. Il a cru à la victoire secrète de l’amour, comme tous les amoureux éconduits que le moindre geste inopiné suffit à enfiévrer. Les mêmes gestes ne valent pas un clou, accomplis par des personnes acquises. Je pourrais en écrire là-dessus. Le type qui n’en a rien à foutre et qui un matin, par inadvertance ou perversité, t’envoie un signal imprévu, je sais ce que ça provoque.
Je dois savoir ce que devient la tante de Jean-Lino. La visite de Ginette Anicé m’y a fait penser. Jean-Lino avait ramené en France la sœur de son père et lui avait trouvé une place dans une maison de retraite juive. Je l’y avais accompagné un après-midi. Nous étions allés à la cafétéria , un grand hall reconfiguré entièrement fonctionnel, sol en petit marbre piqueté, murs lisses, tables où étaient assis des gens en chaises roulantes avec des visiteurs. On aurait dit que tous les matériaux avaient été choisis en raison de leur qualité d’écho et de résonance. La tante avançait vite avec son déambulateur. Esprit vif. Jambes vivaces. Le corps, et surtout la tête agités de mouvements perpétuels incontrôlés qui ne semblaient pas la gêner mais qui rendaient sa parole sourde et saccadée. Elle parlait, en même temps, trois langues, un français châtié et semi-oublié d’autrefois, l’italien et le ladin, un patois des Dolomites. Jean-Lino nous avait installés à la table du fond, devant une télé murale, son au maximum, branchée sur une chaîne de clips. Durant la conversation (si on peut dire), Jean-Lino, par à-coups, lui arrachait avec ses doigts des poils du visage. Sait-elle ce qui est arrivé à son neveu ? À qui parle-t-elle, avec sa tête branlante dans le désert du hall ? Un rien peut me faire douter de la cohérence du monde. Les lois semblent indépendantes les unes des autres et se heurtent. Dans le réduit de mon bureau, à Pasteur, une mouche m’exaspère. Je n’aime pas quand une mouche est conne. J’ouvre grand la fenêtre et au lieu de s’enfuir vers les arbres qui bordent notre pavillon, elle revient dans la pièce zigzaguant vers le mur du fond. Deux secondes avant elle se cognait à la vitre, frappait à droite, à gauche, en tous sens, maintenant que l’air entre, que le ciel lui tend les bras, elle erre dans l’ombre absurdement. Elle mérite que je l’enferme en m’en foutant. Mais elle a pour elle son odieux bourdonnement. Je me demande même si ce bourdonnement n’a pas été créé comme garde-fou à l’emprisonnement. Je n’aurais aucune pitié sans cette parade. Je saisis ma CBE, je renvoie la mouche vers la fenêtre, enfin j’essaie, car au lieu de s’abandonner à la raquette charitable, elle l’esquive, se met hors de portée et va se coller en lisière de plafond. Pourquoi faut-il supporter une telle perte de temps ? La tante vivait dans les montagnes. Elle parlait encore de ses poules, les poules rentraient dans la maison et se mettaient partout. Elle voulait retourner dans son village pour voir la transhumance des vaches, elle voulait réentendre le vacarme des cloches. Je vais appeler la maison de retraite.
Quand l’avocat m’a demandé qui était Jean-Lino pour moi, j’ai dit un ami. Il a fait mine de ne pas comprendre le mot. Il voulait savoir comment je l’entendais. Un soir, au début de notre amitié — le mot est d’une parfaite exactitude —, je rentrais du bureau un peu tard. Il était dehors avec sa Chesterfield, cou nu dans le vent. Et à chaque fois ce sourire quand il m’apercevait, avec des dents jaunies, complètement chevauchantes, éclatant à sa manière. Il était sanglé dans un perfecto en cuir artificiel d’allure juvénile que je ne lui connaissais pas. J’ai dit, c’est nouveau ? Où est la Harley ?
Читать дальше