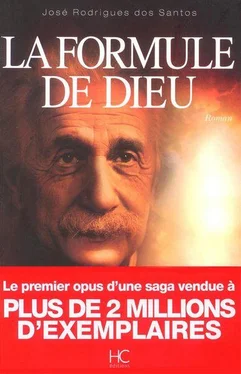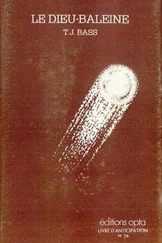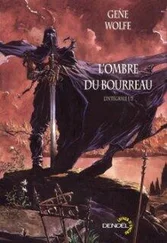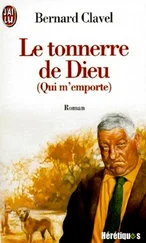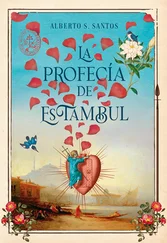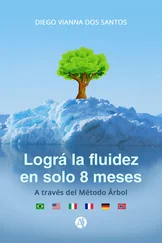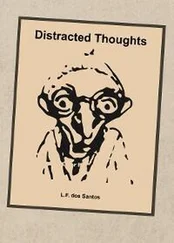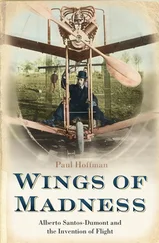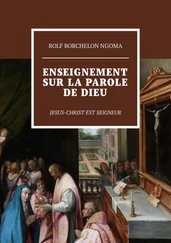Les paroles résonnèrent dans la bibliothèque Joanina, s’évanouissant dans le silence comme un nuage dans le ciel.
— Je vois, murmura Tomás. C’est inouï ce que cette seconde voie révèle est…. prodigieux.
— Oui, concéda Luís Rocha. La découverte du principe anthropique constitue la seconde voie qui confirme l’existence de Dieu. Il reprit le paquet de feuilles, repérant une page déjà consultée. Vous souvenez-vous de la piste indiquée par Einstein ?
— Oui.
Le physicien lut les notes sur cette page.
— Einstein disait : « Ce qui m’intéresse réellement, c’est de savoir si Dieu aurait pu faire le monde d’une autre manière », autrement dit, si la nécessité d’une simplicité logique laisse quelque liberté. Il regarda Tomás. Connaissez-vous la réponse à cette question ?
— À la lumière de ce que vous venez de me dire, la réponse ne peut être que négative.
— Vous avez tout à fait raison. La réponse est bel et bien négative. Luís Rocha secoua la tête. Non, Dieu n’aurait pas pu faire le monde d’une manière différente. Il fronça le sourcil et esquissa un sourire presque malicieux. Mais il y a une chose que vous ignorez encore.
— Encore une ? Laquelle ?
— Évidemment, le principe anthropique constitue un indice très important de l’existence de Dieu. Puisque tout est aussi méticuleusement réglé pour rendre la vie possible, c’est parce que l’univers a été, de fait, conçu pour la créer. Mais un léger doute demeure. Il est infime, mais il existe, comme une écharde plantée dans le pied, un pénible obstacle qui nous empêche d’en avoir la certitude absolue. Il baissa la voix, chuchotant presque. Et si tout n’était qu’un monumental hasard ? Et si toutes ces circonstances résultaient d’un incroyable concours d’étonnantes coïncidences ? Nous avons gagné à plusieurs loteries cosmiques, c’est certain et incontestable, mais aussi improbable que cela puisse paraître, il reste toujours la minuscule possibilité que tout n’ait été qu’un gigantesque accident.
— Oui, bien sûr, acquiesça Tomás. Cette possibilité existe.
— Et tant que cette vague possibilité demeure, on ne peut pas dire avec certitude que le principe anthropique soit la preuve finale. C’est un puissant indice, c’est vrai, mais ce n’est pas encore la preuve.
— En effet, ce n’est pas encore la preuve.
— Cette lointaine possibilité que tout soit un monumental accident préoccupa longtemps le professeur Siza. Il pensait que cette situation inconfortable, cette ennuyeuse incertitude périphérique, faisait partie des habituelles subtilités de Dieu, déjà évoquées par Einstein. Ainsi, de même que les théorèmes de l’incomplétude montrent qu’on ne peut prouver la cohérence d’un système mathématique bien que ces affirmations non démontrables soient vraies, cette lointaine possibilité empêche de prouver, sans le moindre doute possible, l’existence d’une force intelligente et consciente derrière l’architecture de l’univers. Il semblait au professeur Siza que Dieu continuait de se cacher derrière un jeu de miroirs d’une extrême subtilité, en dérobant la preuve de son existence au moment précis où nous allions l’atteindre.
— Je comprends.
— Jusqu’à ce que le professeur Siza, au début de cette année, connaisse une épiphanie.
— Pardon ?
— Il a eu une illumination.
— Comment ça une illumination ?
— Le professeur Siza se trouvait un jour dans son bureau où il calculait le comportement chaotique des électrons dans un champ magnétique quand, soudain, il a eu l’intuition qu’il pourrait lever la dernière incertitude et transformer le principe anthropique non pas seulement en un puissant indice de l’existence de Dieu, mais aussi en preuve finale.
Tomás remua de nouveau sur sa chaise. Il se pencha et plissa les yeux.
— La preuve finale ? Il est parvenu à la preuve finale ?
Luís Rocha garda son doux sourire.
— La preuve finale repose sur le problème du déterminisme.
— Je ne comprends pas.
— Comme je vous l’ai déjà dit, Kant a écrit un jour qu’il y a trois questions qui ne seront jamais résolues : l’existence de Dieu, l’immortalité et le libre arbitre. Cependant, le professeur Siza pensait que ces questions étaient non seulement résolubles, mais également liées entre elles. Il s’éclaircit la voix. Le problème du libre arbitre est celui de savoir jusqu’à quel point nous sommes libre dans nos décisions. Durant longtemps on a pensé que nous l’étions, mais les découvertes scientifiques ont graduellement limité les champs de notre liberté. On a découvert que nos décisions, bien qu’elles nous paraissent libres, sont en réalité conditionnées par d’innombrables facteurs. Par exemple, quand je décide de manger, cette décision est-elle vraiment prise par ma conscience ou par une nécessité biologique de mon corps ? Peu à peu, on s’est aperçu que nos décisions n’étaient pas vraiment les nôtres. Tout ce que nous faisons correspond à ce que nous imposent nos caractéristiques intrinsèques, comme l’ADN, la biologie et la chimie de notre corps, sans compter les autres facteurs en interaction dynamique et complexe avec le monde extérieur, comme la culture, l’idéologie et tous les divers événements qui jalonnent notre vie. Par exemple, on a découvert qu’il y a des gens tristes, non pas parce que leur vie est triste, mais pour la simple raison que leur corps ne produit pas de sérotonine, une substance qui régule l’humeur. Si bien que la plupart des actions de ces gens déprimés sont déterminées par cette insuffisance chimique et non par leur libre arbitre. Vous comprenez ?
— Oui, je comprends, dit Tomás hésitant. Mon père m’en a déjà parlé et j’avoue que cela continue à me gêner.
— Quoi donc ?
— Cette idée que nous ne disposons d’aucun libre arbitre, que la libre volonté n’est qu’une illusion. On dirait que nous ne sommes que de simples robots…
— Peut-être, j’admets que oui, concéda Luís Rocha. Mais c’est pourtant ce que la science conclut d’une certaine manière. Les mathématiques, par exemple, sont déterministes. 2 et 2 font toujours 4. La physique est l’application des mathématiques à l’univers, dont la matière et l’énergie obéissent à des lois et à des forces universelles. Quand une planète tourne autour du soleil ou qu’un électron gravite autour du noyau d’un atome, cela ne se produit pas parce qu’ils le veulent, mais parce que ce sont les lois de la physique qui les y obligent. Suis-je suffisamment clair ?
— Oui, tout ça me semble évident.
— Donc, la matière tente de s’organiser spontanément, en obéissant aux lois de l’univers. Cette organisation implique une complexification. Or, à partir d’un certain point où les atomes s’organisent en élément, son étude cesse de relever du domaine de la physique pour rejoindre celui de la chimie. Autrement dit, la chimie est la physique complexifiée. Quand les éléments chimiques se complexifient à leur tour, naissent les êtres vivants qui se caractérisent par leur capacité à se reproduire et par leur comportement téléologique, à savoir qu’ils agissent en fonction d’un objectif : la survie. Ce que je veux dire, c’est que la biologie est la chimie complexifiée. Quand la biologie devient elle-même complexe, émerge alors l’intelligence et la conscience dont les comportements, parfois, semblent étranges, n’obéissant apparemment à aucune loi. Mais les psychologues et les psychiatres ont déjà démontré que tous les comportements ont une raison d’être, ils ne se produisent ni spontanément ni par la grâce du Saint-Esprit. Leurs causes peuvent nous échapper, mais elles existent. Il y a même des expériences documentées qui montrent que le cerveau prend la décision d’agir avant que la conscience ne s’en aperçoive. Le cerveau prend la décision et en informe ensuite la conscience, mais cela s’effectue avec une telle subtilité que la conscience croit que la décision vient d’elle. Cela signifie que la psychologie est la biologie complexifiée. Vous suivez mon raisonnement ?
Читать дальше