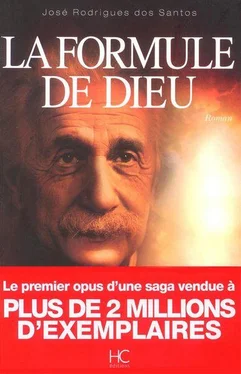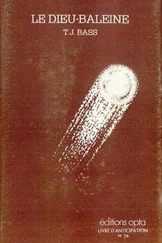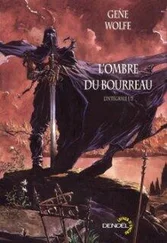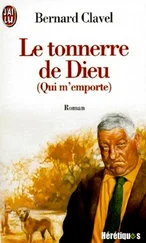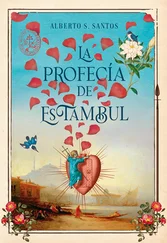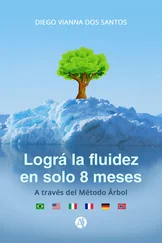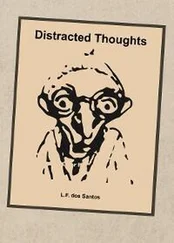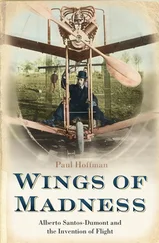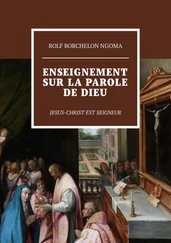— En tout cas, c’est vraiment… surprenant.
— Ce qu’Einstein a constaté, c’est que les textes sacrés contiennent des vérités scientifiques profondes, qu’on ne pouvait pas connaître à leur époque. Et pas seulement la Bible. Les textes hindous, les textes bouddhistes, les textes taoïstes, tous renferment des vérités éternelles, un type de vérités que la science commence à découvrir seulement aujourd’hui. La question est : comment les sages de l’Antiquité ont pu accéder à ces connaissances ?
Il fit une pause.
— Et quelle est la réponse ? demanda Tomás.
— Je ne sais pas. Personne ne le sait. Ce n’est peut-être qu’une coïncidence. Après tout, l’être humain est porté à voir des similitudes dans tout. Mais, tout comme les microparticules de l’expérience Aspect ne sont que les rémanences d’un unique réel, il est aussi possible que les vérités scientifiques contenues dans les écritures sacrées constituent des rémanences de ce même et unique réel. C’est comme si les sages anciens avait été inspirés par quelque chose de profond, éternel, omniprésent mais invisible.
— Je vois…
— Tout ça pour vous dire que, même si Einstein et le professeur Siza ne croyaient pas au Dieu de la Bible, ils pensaient tous les deux que par certains aspects et sous certaines formes, les écritures sacrées dissimulaient des vérités profondes.
Ils burent une autre gorgée de café.
— Quoi qu’il en soit, et malgré ces étranges coïncidences, le Dieu recherché par le professeur Siza n’était pas celui de la Bible, reprit Tomás.
— En effet. Ce n’était pas le Dieu de la Bible. C’était quelque chose de différent. Le professeur Siza recherchait une force créatrice, intelligente et consciente, mais pas nécessairement morale, ni bonne, ni mauvaise. Il soupira. Après avoir ainsi délimité le champ de la recherche et redéfini l’objet de l’étude, il fallait considérer une autre question : qu’est-ce que signifie prouver l’existence de Dieu ?
Le physicien semblait attendre une réponse.
— C’est à moi que vous posez la question ? s’enquit Tomás, hésitant, sans savoir si la question était purement rhétorique ou si elle appelait une réponse.
— Oui, bien entendu. Qu’est-ce que signifie prouver l’existence de Dieu ?
— Eh bien… je ne sais pas, je l’avoue.
— S’agit-il de concevoir un télescope assez puissant pour nous permettre de voir Dieu, avec sa grande barbe, jouant avec les étoiles ? S’agit-il de développer une équation mathématique contenant l’ADN de Dieu ? Mais que signifie donc prouver l’existence de Dieu ?
— C’est une bonne question, sans aucun doute, considéra Tomás. Quelle est la réponse ?
Luís Rocha leva trois doigts.
— La réponse repose sur trois points. Premier point, Dieu est subtil. À travers la théorie du chaos, des théorèmes de l’incomplétude et du principe d’incertitude, on s’aperçoit que le Créateur a masqué Sa signature, qu’Il s’est caché sous un voile ingénieusement conçu pour Le rendre invisible. Ce qui, bien entendu, complique sérieusement la tâche pour prouver Son existence. Il replia un deuxième doigt. Deuxième point, Dieu n’est pas intelligible à travers l’observation. Autrement dit, on ne peut pas prouver Son existence par le biais d’un télescope ou d’un microscope.
— Et pourquoi pas ? interrompit Tomás.
— Pour diverses raisons, rétorqua le physicien. Supposons que l’univers soit Dieu, comme le soutenait Einstein. Comment L’observer dans sa totalité ? Le professeur Siza était arrivé à la conclusion que les physiciens et les mathématiciens observaient l’univers un peu comme un ingénieur regarde une télévision. Imaginez que l’on demande à un ingénieur ce qu’est une télévision. L’ingénieur va observer l’appareil, le démonter entièrement et dira qu’une télévision est un ensemble de fils et de circuits électriques structurés d’une certaine manière. Il pointa Tomás du doigt. Mais, je vous le demande : pensez-vous que cela apporte une réponse complète et adaptée à la question de savoir ce qu’est une télévision ?
— Je pense qu’il donne une réponse d’ingénieur.
— Exactement, il donne une réponse d’ingénieur. Car naturellement une télévision est bien davantage que des fils et des circuits électriques. Une télévision diffuse des programmes d’informations et de divertissements, elle produit un impact psychologique sur chaque individu, elle permet de transmettre des messages, elle engendre d’importants effets sociologiques, elle a une dimension politique et culturelle, bref… C’est quelque chose de bien plus vaste qu’une simple description de ses composants technologiques.
— Vous faites allusion à ce problème dont vous m’avez déjà parlé, le hardware et le software ?
— Tout à fait. La perspective réductionniste, centrée sur le hardware, et la perspective sémantique, insérée dans le programme. Les physiciens et les mathématiciens regardent l’univers comme un ingénieur regarde une télévision ou un ordinateur. Ils ne voient que la matière et les atomes, les forces et les lois qui les régissent, mais tout cela, en y regardant bien, n’est que le hardware. Car quel est le message de cette énorme télévision ? Quel est le software de ce gigantesque ordinateur ? Le professeur Siza en a conclu que l’univers dispose d’un programme et possède une dimension qui dépasse de loin la somme de ses composants. Autrement dit, l’univers est bien plus que le hardware qui le constitue. C’est un immense programme.
— Comme un être humain, remarqua Tomás.
— Absolument. Un être humain est fait de cellules, de tissus, d’organes, de sang et de nerfs. C’est son hardware. Mais un être humain est bien davantage que cela. C’est une structure complexe qui possède une conscience, qui rit, qui pleure, qui pense, qui souffre, qui chante, qui rêve et désire. En réalité, nous sommes plus, beaucoup plus que la simple somme des parties qui nous composent. Notre corps est le hardware par où passe le programme de notre conscience. Il fit un large geste des bras. Il en va de même pour la réalité la plus profonde de l’existence. L’univers est le hardware par lequel passe le programme de Dieu.
— C’est une idée audacieuse, observa Tomás. Mais elle a sa logique.
— Ce qui nous renvoie au problème de l’infini, s’exclama le physicien. Car si l’univers est le hardware de Dieu, cela soulève de curieuses questions. Par exemple, si nous autres, êtres humains, faisons partie de l’univers, cela signifie que nous faisons partie du hardware, n’est-ce pas ? Mais est-ce que nous sommes, nous-mêmes, l’univers ? Est-ce que l’univers est quelqu’un de si immensément grand que nous ne le voyons pas, si grand qu’il en devient invisible ? Quelqu’un d’aussi grand à nos yeux que nous le sommes pour nos cellules ? Sommes-nous pour l’univers ce que nos neurones sont pour nous ? Sommes-nous les neurones d’un être beaucoup plus grand ? L’univers est-il une entité organique dont nous ne sommes que les minuscules cellules ? Sommes-nous le Dieu de nos cellules et nous les cellules de Dieu ?
Ils restèrent un long moment à considérer ces interrogations.
— Qu’en pensez-vous ? s’enquit Tomás.
— Je pense que le problème de l’infini est redoutable, répondit Luís Rocha. Vous savez, nous, les physiciens, nous recherchons les particules fondamentales, mais dès que nous en trouvons une, nous finissons par nous apercevoir que celle-ci est elle-même composée de particules encore plus petites. Au début, on croyait que l’atome était la particule fondamentale. Puis on a découvert que l’atome était constitué de particules plus petites, les protons, les neutrons et les électrons. On a cru alors qu’il s’agissait là des particules fondamentales. Mais on a finalement découvert que les protons et les neutrons sont formés par d’autres particules encore plus petites, les quarks. Et d’aucuns pensent que ces quarks sont eux-mêmes formés par des particules encore plus infimes qui, à leur tour, en contiennent d’autres encore plus petites. Le microcosme est infiniment petit.
Читать дальше