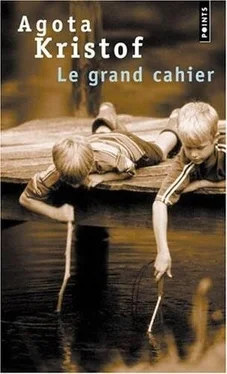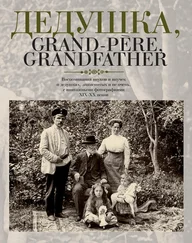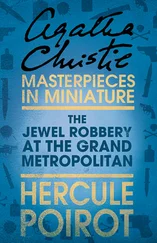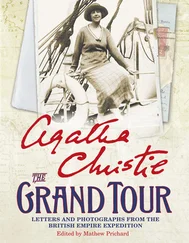Souvent, on nous offre à boire et, peu à peu, nous nous habituons à l'alcool. Nous fumons aussi les cigarettes qu'on nous donne.
Partout nous avons beaucoup de succès. On nous trouve une belle voix; on nous applaudit et on nous rappelle plusieurs fois.
Parfois, si les gens sont attentifs, pas trop ivres et pas trop bruyants, nous leur présentons une de nos petites pièces de théâtre, par exemple l'Histoire du pauvre et du riche.
L'un de nous fait le pauvre, l'autre le riche.
Le riche est assis à une table, il fume. Entre le pauvre:
– J'ai fini de débiter votre bois, monsieur.
– C'est bon. L'exercice fait beaucoup de bien. Vous avez très bonne mine. Vos joues sont toutes rouges.
– J'ai les mains gelées, monsieur.
– Approchez! Montrez! C'est dégoûtant! Vos mains sont pleines de crevasses et de furoncles.
– Ce sont des engelures, monsieur.
– Vous, les pauvres, vous avez tout le temps des maladies répugnantes. Vous êtes sales, voilà l'ennui avec vous. Tenez, voilà pour votre travail.
Il lance un paquet de cigarettes au pauvre qui en allume une et commence à fumer. Mais il n'y a pas de cendrier là où il se trouve, près de la porte, et il n'ose pas s'approcher de la table. Il secoue donc les cendre de sa cigarette dans la paume de sa main. Le riche, qui aimerait que le pauvre s'en aille, feint de ne pas voir que l'homme a besoin d'un cendrier. Mais le pauvre ne veut pas quitter aussitôt les lieux parce qu'il a faim. Il dit:
– Ça sent bon chez vous, monsieur.
– Ça sent la propreté.
– Ça sent aussi la soupe chaude. Je n'ai encore rien mangé aujourd'hui.
– Vous auriez dû. Quant à moi, je vais aller dîner au restaurant car j'ai donné congé à mon cuisinier.
Le pauvre renifle:
– Pourtant, ça sent la bonne soupe bien chaude ici. Le riche crie:
– Ça ne peut pas sentir la soupe chez moi; personne ne prépare de la soupe chez moi; ça doit venir de chez les voisins, ou bien ça sent la soupe dans votre imagination! Vous, les pauvres, vous ne pensez qu'à votre estomac; c'est pour ça que vous n'avez jamais d'argent; vous dépensez tout ce que vous gagnez en soupe et en saucisson. Vous êtes des porcs, voilà ce que vous êtes, et, maintenant, vous salissez mon parquet avec les cendres de votre cigarette! Sortez d'ici, et que je ne vous revoie plus!
Le riche ouvre la porte, donne un coup de pied au pauvre qui s'étale sur le trottoir.
Le riche referme la porte, s'assied devant une assiette de soupe, et dit en joignant les mains:
– Merci, Seigneur Jésus, pour tous tes bienfaits.
Quand nous sommes arrivés chez Grand-Mère, il n'y avait que très peu d'alertes dans la Petite Ville. Maintenant il y en a de plus en plus. Les sirènes se mettent à hurler à n'importe quel moment du jour et de la nuit, exactement commè dans la Grande Ville. Les gens courent se mettre à l'abri, se réfugient dans les caves. Pendant ce temps, les rues sont désertes. Parfois les portes des maisons et des magasins restent ouvertes. Nous en profitons pour entrer et prendre tranquillement ce qui nous plaît.
Nous ne nous réfugions jamais dans notre cave. Grand-Mère non plus. Le jour, nous poursuivons nos occupations, la nuit, nous continuons de dorrilir.
La plupart du temps, les avions ne font que traverser notre ville pour aller bombarder de l’autre côté de la frontière. Il arrive qu'une bombe tombe tout de même sur une maison. Dans ce cas, nous repérons l'endroit d'après la direction de la fumée et nous allons voir ce qui a été détruit. S'il reste quelque chose à prendre, nous le prenons.
Nous avons remarqué que les gens qui se trouvent dans la cave d'une maison bombardée sont toujours morts. Par contre, la cheminée de la maison reste presque toujours debout.
Il arrive aussi qu'un avion fasse une attaque en piqué pour mitrailler des gens dans les champs ou dans la rue.
L'ordonnance nous a appris qu'il fallait faire attention quand l'avion avançait vers nous, mais que, dès qu'il se trouvait au-dessus de notre tête, le danger était passé.
A cause des alertes, il est interdit d'allumer des lampes le soir avant d'avoir obscurci parfaitement les fenêtres. Grand-Mère pense qu'il est plus pratique de ne pas allumer du tout. Des patrouilles font la ronde toute la nuit pour faire respecter le règlement.
Au cours d'un repas, nous parlons d'un avion que nous avons vu tomber en flammes. Nous avons vu aussi le pilote sauter en parachute.
– Nous ne savons pas ce qu'il est devenu, le pilote ennemi.
Grand-Mère dit:
– Ennemi? Ce sont des amis, des frères à nous. Ils arrivent bientôt
Un jour, nous nous promenons pendant une alerte.
Un homme affolé se précipite sur nous:
– Vous ne devez pas rester dehors pendant les bombardements.
Il nous tire par le bras vers une porte.
– Entrez, entrez là-dedans.
– Nous ne voulons pas.
– C'est un abri. Vous y serez en sécurité.
Il ouvre la porte et nous pousse devant lui. La cave est pleine de monde. Il y règne un silence total. Les femmes serrent leurs enfants contre elles.
Tout à coup, quelque part, des bombes explosent. Les explosions se rapprochent. L'homme qui nous a emmenés à la cave se jette sur le tas de charbon qui se trouve dans un coin et essaie de s'y enfouir.
Quelques femmes ricanent avec mépris. Une femme âgée dit:
– Ses nerfs sont détraqués. Il est en permission à cause de ça.
Brusquement, nous avons de la peine à respirer. Nous ouvrons la porte de la cave; une grande et grosse femme nous repousse, referme la porte. Elle crie:
– Vous êtes fous? Vous ne pouvez pas sortir maintenant.
Nous disons:
– Les gens meurent toujours dans les caves. Nous voulons sortir.
La grosse femme s'appuie contre la porte. Elle nous montre son brassard de la Protection civile.
– C'est moi qui commande ici! Vous resterez là!
Nous enfonçons nos dents dans ses avant-bras charnus; nous lui donnons des coups de pied dans les tibias. Elle pousse des cris, essaie de nous frapper. Les gens rigolent. Enfin, elle dit, toute rouge de colère et de honte:
– Allez! Foutez le camp! Allez crever dehors! Ce ne sera pas un grand dommage.
Dehors, nous respirons. C'est la première fois que nous avons eu peur.
Les bombes continuent à pleuvoir.
Nous sommes venus chercher notre linge propre à la cure. Nous mangeons des tartines avec la servante dans la cuisine. Nous entendons des cris venant de la rue. Nous posons nos tartines et nous sortons. Les gens se tiennent devant leurs portes; ils regardent dans la direction de la gare. Des enfants excités courent en criant:
– Ils arrivent! Ils arrivent!
Au tournant de la rue débouche une Jeep militaire avec des officiers étrangers. La Jeep roule lentement, suivie par des militaires portant leur fusil en bandoulière. Derrière eux, une sorte de troupeau humain. Des enfants comme nous. Des femmes comme notre mère. Des vieillards comme le cordonnier.
Ils sont deux cents ou trois cents qui avancent, encadrés par des soldats. Quelques femmes portent leurs petits enfants sur le dos, sur l'épaule, ou serrés contre leur poitrine. L'une d'entre elles tombe; des mains se saisissent de l'enfant et de la mère; l’on les porte car un soldat a déjà pointé son fusil.
Personne ne parle, personne ne pleure; les yeux sont fixés sur le sol. On entend seulement le bruit des souliers cloutés des soldats.
Juste devant nous, un bras maigre sort de la foule, une màin sale se tend, une voix demande:
– Du pain.
La servante, souriante, fait le geste d'offrir le reste de sa tartine; elle l'approche de la main tendue puis, avec un grand rire, elle ramène le morceau de pain à sa bouche, mord dedans et dit:
Читать дальше