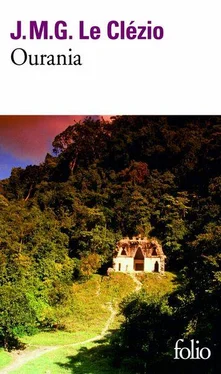J'ai voulu parler de Lili, de la lagune d'Orandino, des camions qui emmènent chaque matin les enfants des Parachutistes pour les faire travailler aux champs, des femmes qui besognent chaque jour à l'usine de congélation et d'empaquetage, pour enrichir la Mac Cormick, la Strawberry Lake.
J'ai dit à Hector : « Est-ce que tu es venu porter ici la lame de la révolution ? » Hector a souri de la solennité de la question. Il a paru réfléchir en aspirant une bouffée : « Ami, tu dois savoir que la révolution ne se fait pas avec des sentiments, même si ce sont de bons sentiments. »
Don Chivas a cru bon venir à son aide. Il a ajouté à mon intention : « Tu sais, ici, nous avons l'expérience, la révolution, la lutte armée, la réforme agraire, les nationalisations, et même le soulèvement indigène au Chiapas, nous avons tout fait. Nous avons largement un siècle d'avance. »
Hector a grimacé, la fumée de son cigare lui piquait les yeux. « Un siècle, c'est vite passé. Un jour on se réveille et on a un siècle de retard. »
L'alcool circulait, de petits verres de tequila, ceux qui portent une croix au cul, hasta no verte Jesus. Après cet échange, Hector était fatigué. Il a changé de style. Don Chivas a apporté sa guitare, et ils se sont mis à jouer à tour de rôle, des rondos, des airs espagnols. Hector jouait bien, les filles de Bertha se sont assises sur des coussins pour l'écouter, serrées l'une contre l'autre. La lumière de la fin d'après-midi était chaude et jaune comme le tequila dans les verres, elle filtrait à travers les vitraux des fenêtres. Hector a commencé à chanter, des ritournelles mélancoliques, amoureuses, ses yeux bruns luisaient d'émotion sous l'ombre de ses sourcils épais.
Tout cela était bien romantique. Je pouvais imaginer que c'était avec ces chansons qu'il avait séduit Dahlia, qu'il l'avait prise au piège, tour à tour dur et cassant quand il exposait ses théories sur la guérilla, et tendre et nostalgique quand il interprétait les romances d'Agustín Lara, ou La Sandunga chère à Frida Kahlo.
J'en ai conclu qu'un géographe français ne pouvait rien comprendre à l'histoire récente de l'Amérique latine, ce mélange de comédiens et de tragédiens, et sans doute encore moins à l'histoire d'amour entre Hector et Dahlia— quand de la chambre adjacente est sorti Fabio, pareil à un petit prince doré. Je ne le connaissais que par ses photos. Il semblait vraiment né d'un livre d'images, les cheveux emmêlés de sommeil et les yeux encore embués de rêves.
Il s'est blotti dans le giron de Dahlia, pour écouter la musique. Il avait la grâce, la couleur de peau et les cheveux de sa mère, et les grands yeux humides et sombres de son père.
Il nous a observés l'un après l'autre avec la gravité des enfants, et chacun lui a souri. Angel n'a pas semblé ému. Il était pareil à Fabio, avec un regard à la fois intimidé et insistant.
J'ai ressenti un frisson que j'ai du mal à expliquer, comme si tout ce que nous avions dit, toutes ces belles phrases à propos de la révolution et de la religion, cette évocation des accords passés entre Mitterrand et Portillo, les atermoiements précautionneux de Reagan qui ne voulait pas désavouer les militaires de la répression en Amérique latine, de peur de voir s'étendre la maladie contagieuse de la rébellion, tout cela était balayé par le regard de ce petit garçon et celui de l'Indien de Chala-tenango, par la force juvénile de ceux qui n'avaient pas besoin de mots. Une force qui débordait de l'histoire comme la lave d'un cratère, avançait avec lenteur, avec majesté, une force pareille à la vie.
J'ai laissé Don Chivas et Hector à leurs chansons. J'ai embrassé Dahlia, et Fabio. Je n'étais pas sûr de les revoir un jour. J'avais l'impression d'être sur une sorte de radeau qui dérivait le long d'une côte brumeuse.
Si j'avais pu, si j'avais osé, j'aurais traversé le canal sur un des ponts de planches pour entrer dans le quartier des Parachutistes, jusqu'à la lagune d'Orandino. Pour chercher Lili, pour me plonger dans son regard, entendre sa voix. Pour l'observer en train de préparer le souper de la vieille qu'elle appelait sa grand-mère, avant de monter dans la voiture du Terrible, qui l'emmenait gagner sa vie dans les Jardins.
Mais je suis retourné à l'appartement vide. Quand je me suis allongé sur le matelas, les autos reprenaient leur ronde du soir à travers les rues étroites et embouteillées, lançant à coups de klaxon les premières notes de La Cucaracha, de La Raspa, de La Bamba.
Raphaël est venu à l'Emporio. Quand il est entré dans la bibliothèque, je ne l'ai pas reconnu. Il m'a paru plus grand, plus fort. Ses cheveux avaient poussé très dru sur son crâne rond, il avait l'air d'un esquimau.
Il a regardé mes cartes, mes notes. « À quoi ça sert ? »
J'ai tenté de me justifier : « Je prépare un voyage d'étude dans la vallée du Tepalcatepec, ai-je dit. Je dois choisir ma route. » Il a pris une des feuilles pour l'examiner, un peu de travers. « C'est le chemin que tu vas suivre ? » Il montrait la ligne du fleuve, les affluents, les courbes de niveau.
« Je dois essayer d'aller en ligne droite, pour faire une coupe. »
Il ne comprenait toujours pas : « À quoi ça sert d'aller tout droit ? »
J'ai dit : « C'est une reconnaissance. »
Raphaël n'a pas relevé le mot, même si ça ne devait pas signifier grand-chose pour lui. Il a remarqué : « Mais si tu vas tout droit, tu ne pourras pas rencontrer des gens ? »
J'ai secoué la tête : « Non, je ne rencontrerai personne. C'est une étude de la terre, je n'ai pas besoin de rencontrer des gens. » Il m'a regardé avec étonnement : « Mais comment tu peux étudier la terre si tu ne rencontres pas ceux qui habitent dessus ? » C'était plutôt logique, mais j'ai préféré changer de conversation.
Il était trois heures après midi, l'heure creuse. Il n'y avait personne dans la bibliothèque, à part Tina, une étudiante chargée de surveiller, et qui semblait plongée dans la lecture d'un roman-photo.
J'ai emmené Raphaël dans l'orangeraie. Il examinait tout avec la même curiosité : le bassin d'azulejos, la fontaine arrêtée. Les arbres dans leurs pots, les tables en fer décorées de réclames pour une marque de bière, les parasols. Il a voulu voir les cubicules qui ressemblent à des alvéoles (Don Thomas aime à comparer les chercheurs à des abeilles).
Je lui ai fait visiter les bureaux désertés à l'heure du déjeuner. Ce qui l'a le plus impressionné, ce ne sont ni les ordinateurs ni les photocopieuses, ni même le projecteur avec son écran. C'est un cadran solaire du siècle passé, scellé dans le mur de briques au fond du patio. Il a lu la formule en latin gravée sur un écusson en plâtre : In horas non mutatur. Il m'a demandé ce que cela signifiait, et quand je le lui ai dit, il s'est exclamé : « Mais ça n'a pas de sens ! Pourquoi avoir écrit un tel mensonge ? » J'allais lui expliquer la vanité des anciens propriétaires de la demeure, les hacendados Verdolaga, qui se piquaient de connaître leurs humanités comme Pickwick, mais Raphaël a continué sur son idée : « Tu connais deux heures qui sont identiques ? Tu as déjà vécu des jours qui ont duré des mois, d'autres qui passaient en un instant ? » Je lui ai fait observer qu'il portait sa belle montre à son poignet, depuis son voyage au Pacifique. Il m'a dit : « Mais ce n'est pas pour moi, c'est pour mon travail, mon patron veut que je sois à l'heure. » J'étais surpris de la nouvelle : « Tu travailles maintenant ? Qu'est-ce que tu fais ? » Il a été un peu évasif. « Je travaille au marché, dans un magasin qui vend des grains. » Il s'est un peu reculé pour admirer le cadran solaire. « Ta phrase est idiote, a-t-il conclu, mais l'objet est utile, je pourrai en fabriquer un pour Campos, et le placer sur la grande tour d'observation des étoiles. »
Читать дальше