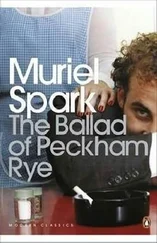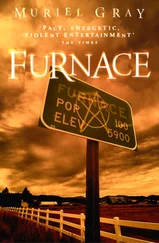Thy hand, lovest soul, darkness shades me,
On thy bosom let me rest.
When I am laid in earth
May my wrongs create
No trouble in thy breast.
Remember me, remember me,
But ah ! forget my fate.
C’est la mort de Didon, dans le Didon et Énée de Purcell. Si vous voulez mon avis : la plus belle œuvre de chant au monde. Ce n’est pas seulement beau, c’est sublime et ça tient à l’enchaînement incroyablement dense des sons, comme s’ils étaient liés par une force invisible et comme si, tout en se distinguant, ils se fondaient les uns dans les autres, à la frontière de la voix humaine, presque dans le territoire de la plainte animale — mais avec une beauté que des cris des bêtes n’atteindront jamais, une beauté née de la subversion de l’articulation phonétique et de la transgression du soin que le langage verbal met d’ordinaire à distinguer les sons.
Briser les pas, fondre les sons.
L’Art, c’est la vie, mais sur un autre rythme
— Allons-y ! dit Kakuro qui a disposé tasses, théière, sucre et petites serviettes en papier sur un grand plateau noir.
Je le précède dans le couloir et, sur ses indications, ouvre la troisième porte sur la gauche.
— Vous avez un magnétoscope ? avais-je demandé à Kakuro Ozu.
— Oui, avait-il répondu avec un sourire sibyllin.
La troisième porte sur la gauche ouvre sur une salle de cinéma miniature. Il y a un grand écran blanc, un tas d’appareils brillants et énigmatiques, trois rangées de cinq vrais fauteuils de cinéma recouverts de velours bleu nuit, une longue table basse devant la première et des murs et un plafond tendus de soie sombre.
— En fait, c’était mon métier, dit Kakuro.
— Votre métier ?
— Pendant plus de trente ans, j’ai importé en Europe de la hi-fi de pointe, pour des grandes enseignes de luxe. C’est un commerce très lucratif — mais surtout merveilleusement ludique pour moi que tout gadget électronique passionne.
Je prends place sur un siège délicieusement rembourré et la séance commence.
Comment décrire ce moment de grande joie ? Nous regardons Les Sœurs Munakata sur un écran géant, dans une douce pénombre, le dos calé contre un dossier bien mou, en grignotant du gloutof et en buvant du thé brûlant à petites gorgées heureuses. De temps à autre, Kakuro arrête le film et nous commentons ensemble, à bâtons rompus, les camélias sur la mousse du temple et le destin des hommes quand la vie est trop dure. À deux reprises, je m’en vais saluer mon ami le Confutatis et je reviens dans la salle comme dans un lit chaud et douillet.
C’est un hors-temps dans le temps... Quand ai-je pour la première fois ressenti cet abandon exquis qui n’est possible qu’à deux ? La quiétude que nous éprouvons lorsque nous sommes seuls, cette certitude de nous-mêmes dans la sérénité de la solitude ne sont rien en comparaison du laisser-aller, laisser-venir et laisser-parler qui se vit avec l’autre, en compagnie complice... Quand ai-je pour la première fois ressenti ce délassement heureux en présence d’un homme ?
Aujourd’hui, c’est la première fois.
Lorsque, à dix-neuf heures, après avoir encore bien conversé en buvant du thé et alors que je m’apprête à prendre congé, nous repassons par le grand salon, je remarque, sur une table basse à côté d’un canapé, la photographie encadrée d’une très belle femme.
— C’était ma femme, dit doucement Kakuro en voyant que je l’observe. Elle est morte il y a dix ans, d’un cancer. Elle s’appelait Sanae.
— Je suis désolée, dis-je. C’était une... très belle femme.
— Oui, dit-il, très belle.
Un bref silence se fait.
— J’ai une fille, qui vit à Hong Kong, ajoute-t-il, et déjà deux petits-enfants.
— Ils doivent vous manquer, dis-je.
— J’y vais assez souvent. Je les aime beaucoup. Mon petit-fils, qui s’appelle Jack (son papa est anglais) et qui a sept ans, m’a dit au téléphone ce matin qu’il avait péché hier son premier poisson. C’est l’événement de la semaine, vous pensez !
Un nouveau silence.
— Vous êtes veuve vous-même, je crois, dit Kakuro en m’escortant dans le vestibule.
— Oui, dis je, je suis veuve depuis plus de quinze ans.
J’ai la gorge qui se serre.
— Mon mari s’appelait Lucien. Le cancer, aussi... Nous sommes devant la porte, nous nous regardons avec tristesse.
— Bonne nuit, Renée, dit Kakuro.
Et, un semblant de gaieté retrouvé :
— C’était une fantastique journée.
Un immense cafard fond sur moi à vitesse supersonique.
— Tu es une pauvre idiote, je me dis en enlevant la robe prune et en découvrant du glaçage au whisky sur une boutonnière. Qu’est-ce que tu croyais ? Tu n’es qu’une pauvre concierge. Il n’est pas d’amitié possible entre les classes. Et puis, que croyais-tu, pauvre folle ?
— Que croyais-tu, pauvre folle ? je ne cesse de me répéter en procédant aux ablutions du soir et en me glissant entre mes draps après une courte bataille avec Léon, qui ne souhaite pas céder de terrain.
Le beau visage de Sanae Ozu danse devant mes yeux fermés et je me fais l’impression d’une vieille chose soudain rappelée à une réalité sans joie.
Je m’endors le cœur inquiet.
Le lendemain matin, j’éprouve une sensation proche de la gueule de bois.
Pourtant, la semaine se passe comme un charme. Kakuro fait quelques primesautières apparitions en sollicitant mes dons d’arbitrage (glace ou sorbet ? Atlantique ou Méditerranée ?) et je retrouve le même plaisir à sa rafraîchissante compagnie, malgré les sombres nuages qui croisent silencieusement au-dessus de mon cœur. Manuela rigole bien en découvrant la robe prune et Paloma s’incruste dans le fauteuil de Léon.
— Plus tard, je serai concierge, déclare-t-elle à sa mère, qui me regarde avec un œil nouveau mâtiné de prudence lorsqu’elle s’en vient déposer sa progéniture à ma loge.
— Dieu t’en préserve, réponds-je avec un aimable sourire à Madame. Tu seras princesse.
Elle exhibe conjointement un tee-shirt rose bonbon assorti à ses nouvelles lunettes et un air pugnace de fille-qui-sera-concierge-envers-et-contre-tout-surtout-ma-mère.
— Qu’est-ce que ça sent ? demande Paloma.
Il y a un problème de canalisation dans ma salle de bains et ça pue comme dans une chambrée de bidasses. J’ai appelé le plombier il y a six jours mais il ne semblait pas plus enthousiaste que ça à l’idée de venir.
— Les égouts, dis je, peu disposée à développer la question.
— Échec du libéralisme, dit-elle comme si je n’avais nen répondu.
— Non, dis-je, c’est une canalisation bouchée.
— C’est bien ce que je vous dis, dit Paloma. Pourquoi le plombier n’est-il pas encore venu ?
— Parce qu’il a d’autres clients ?
— Pas du tout, rétorque-t-elle. La bonne réponse, c’est : parce qu’il n’y est pas obligé. Et pourquoi n’y est-il pas obligé ?
— Parce qu’il n’a pas assez de concurrents, dis-je.
— Et voilà, dit Paloma d’un air triomphant, il n’y a pas assez de régulation. Trop de cheminots, pas assez de plombiers. Personnellement, je préférerais le kolkhoze.
Hélas, interrompant ce passionnant dialogue, on frappe au carreau.
C’est Kakuro, avec un petit je-ne-sais-quoi de solennel.
Il entre et aperçoit Paloma.
— Oh, bonjour jeune fille, dit-il. Eh bien, Renée, je repasserai peut-être plus tard ?
— Si vous voulez, dis-je. Vous allez bien ?
Читать дальше