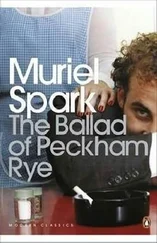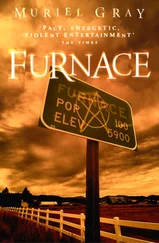— Eh bien, dis-je, j’aurais aimé parler à Kakuro.
— Il est absent, me dit-il, voulez-vous qu’il vous rappelle dès qu’il rentre ?
— Non, non, dis-je, soulagée de pouvoir opérer avec un intermédiaire. Pourriez-vous lui dire que, s’il n’a pas changé d’avis, je serais heureuse de dîner avec lui demain soir ?
— Avec plaisir, dit Paul N’Guyen.
Le téléphone raccroché, je me laisse de nouveau tomber dans mon fauteuil et m’absorbe pendant une petite heure dans des pensées incohérentes mais plaisantes.
— Ça ne sent pas très bon, chez vous, dites donc, dit une douce voix masculine dans mon dos. Est-ce que quelqu’un vous a réparé ça ?
Il a ouvert la porte si doucement que je ne l’ai pas entendu. C’est un beau jeune homme brun, avec les cheveux un peu en vrac, une veste de jean toute neuve et des grands yeux de cocker pacifique.
— Jean ? Jean Arthens ? je demande, sans croire à ce que je vois.
— Voui, dit-il en penchant la tête de côté, comme autrefois.
Mais c’est bien tout ce qui reste de l’épave, de la jeune âme brûlée au corps décharné ; Jean Arthens, naguère si proche de la chute, a visiblement opté pour la renaissance.
— Vous avez une mine sensationnelle ! dis-je en lui faisant mon plus beau sourire.
Il me le rend gentiment.
— Eh bien bonjour, madame Michel, dit-il, ça me fait plaisir de vous voir. Ça vous va bien, ajoute-t-il en montrant mes cheveux.
— Merci, dis-je. Mais qu’est-ce qui vous amène ici ? Voulez-vous une tasse de thé ?
— Ah..., dit-il avec un zeste de l’hésitation d’antan, mais voui, bien volontiers.
Je prépare le thé tandis qu’il prend place sur une chaise en regardant Léon avec des yeux ahuris.
— Il était déjà aussi gros, ce chat ? s’enquiert-il sans la moindre perfidie.
— Oui, dis-je, ce n’est pas un grand sportif.
— Ce n’est pas lui qui sent mauvais, par hasard ? demande-t-il en le reniflant, l’air navré.
— Non, non, dis-je, c’est un problème de plomberie.
— Ça doit vous paraître bizarre que je débarque ici comme ça, dit-il, surtout qu’on ne s’est jamais beaucoup parlé, hein, je n’étais pas bien bavard du temps... eh bien du temps de mon père.
— Je suis contente de vous voir et, surtout, vous avez l’air d’aller bien, dis-je avec sincérité.
— Voui, dit-il,... je reviens de très loin.
Nous aspirons simultanément deux petites gorgées de thé brûlant.
— Je suis guéri, enfin, je crois que je suis guéri, dit-il, si on guérit vraiment un jour. Mais je ne touche plus à la dope, j’ai rencontré une fille bien, enfin, une fille fantastique, plutôt, je dois dire (ses yeux s’éclairent et il renifle légèrement en me regardant) et j’ai trouvé un petit boulot bien sympa.
— Que faites-vous ? je demande.
— Je travaille dans un magasin d’accastillage.
— De pièces de bateau ?
— Voui et c’est bien sympa. J’ai un peu l’impression d’être en vacances, là-bas. Les gars viennent et ils me parlent de leur bateau, des mers où ils vont, des mers d’où ils viennent, j’aime bien ça, et puis je suis content de travailler, vous savez.
— Votre travail, il consiste en quoi, exactement ?
— Je suis un peu l’homme à tout faire, le magasinier, le coursier, mais avec le temps j’apprends bien, alors maintenant, des fois, on me confie des tâches plus intéressantes : réparer des voiles, des haubans, dresser des inventaires pour un avitaillement.
Etes-vous sensibles à la poésie de ce terme ? On avitaille un bateau, on ravitaille une ville. A qui n’a pas compris que l’enchantement de la langue naît de telles subtilités, j’adresse la prière suivante : méfiez-vous des virgules.
— Mais vous aussi vous avez l’air très en forme, dit-il en me regardant gentiment.
— Ah oui ? dis-je. Eh bien, il y a quelques changements qui me sont bénéfiques.
— Vous savez, dit-il, je ne suis pas revenu voir l’appartement ou bien des gens, ici. Je ne suis même pas sûr qu’ils me reconnaîtraient ; d’ailleurs, j’avais pris ma carte d’identité, si des fois vous-même ne me reconnaissiez pas. Non, poursuit-il, je suis venu parce que je n’arrive pas à me souvenir de quelque chose qui m’a beaucoup aidé, déjà quand j’étais malade et puis après, pendant ma guérison.
— Et je peux vous être utile ?
— Oui, parce que c’est vous qui m’avez dit le nom de ces fleurs, un jour. Dans cette plate-bande, là-bas (il montre du doigt le fond de la cour), il y a des jolies petites fleurs blanches et rouges, c’est vous qui les avez mises, non ? Et un jour, je vous ai demandé ce que c’était mais je n’ai pas été capable de retenir le nom. Pourtant, je pensais tout le temps à ces fleurs, je ne sais pas pourquoi. Elles sont bien jolies, quand j’étais si mal, je pensais aux fleurs et ça me faisait du bien. Alors je suis passé près d’ici, tout à l’heure et je me suis dit : je vais aller demander à Mme Michel si elle peut me dire.
Il guette ma réaction, un peu embarrassé.
— Ça doit vous paraître bizarre, hein ? J’espère que je ne vous fais pas peur, avec mes histoires de fleurs.
— Non, dis-je, pas du tout. Si j’avais su à quel point elles vous faisaient du bien... J’en aurais mis partout !
Il rit comme un gamin heureux.
— Ah, madame Michel, mais vous savez, ça m’a pratiquement sauvé la vie. C’est déjà un miracle ! Alors, vous pouvez me dire ce que c’est ?
Oui, mon ange, je le peux. Dans les allées de l’enfer, sous le déluge, souffle coupé et cœur au bord des lèvres, une mince lueur : ce sont des camélias.
— Oui, dis-je. Ce sont des camélias.
Il me regarde fixement, les yeux écarquillés. Puis une petite larme glisse le long de sa joue d’enfant rescapé.
— Des camélias..., dit-il, perdu dans un souvenir qui n’appartient qu’à lui. Des camélias, oui, répète-t-il en me regardant à nouveau. C’est ça. Des camélias.
Je sens une larme qui coule sur ma propre joue. Je lui prends la main.
— Jean, vous ne pouvez pas savoir à quel point je suis heureuse que vous soyiez venu aujourd’hui, dis-je.
— Ah bon ? dit-il, l’air étonné. Mais pourquoi ?
Pourquoi ?
Parce qu’un camélia peut changer le destin.
14
D’un couloir aux allées
Quelle est cette guerre que nous menons, dans l’évidence de notre défaite ? Matin après matin, harassés déjà de toutes ces batailles qui viennent, nous reconduisons l’effroi du quotidien, ce couloir sans fin qui, aux heures dernières, vaudra destin d’avoir été si longuement arpenté. Oui, mon ange, voici le quotidien : maussade, vide et submergé de peine. Les allées de l’enfer n’y sont point étrangères ; on y verse un jour d’être resté là trop longtemps. D’un couloir aux allées : alors la chute se fait, sans heurt ni surprise. Chaque jour, nous renouons avec la tristesse du couloir et, pas après pas, exécutons le chemin de notre morne damnation.
Vit-il les allées ? Comment naît-on après avoir chu ? Quels pupilles neuves sur des yeux calcinés ? Où commence la guerre et où cesse le combat ?
Alors, un camélia.
15
Sur ses épaules en nage
À vingt heures, Paul N’Guyen se présente à ma loge les bras surchargés de paquets.
— M. Ozu n’est pas encore rentré — un problème à l’ambassade avec son visa — alors il m’a prié de vous remettre tout ceci, dit-il avec un joli sourire.
Il dépose les paquets sur la table et me tend une petite carte.
— Merci, dis-je. Mais vous prendrez bien quelque chose ?
— Merci, dit-il, mais j’ai encore fort à faire. Je garde votre invitation en réserve pour une autre occasion.
Читать дальше