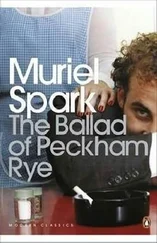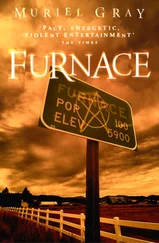— Oui, oui, répond-il.
Puis, prenant une résolution soudaine, il se jette à l’eau :
— Voulez-vous dîner avec moi demain soir ?
— Euh, dis-je, en sentant un grand sentiment d’affolement s’emparer de moi, c’est que...
C’est comme si les intuitions diffuses de ces derniers jours prenaient soudain corps.
— Je voudrais vous emmener dans un restaurant que j’aime beaucoup, poursuit-il avec la mine du chien qui espère son os.
— Au restaurant ? dis-je, de plus en plus affolée.
Sur ma gauche, Paloma fait un bruit de souris.
— Écoutez, dit Kakuro qui semble un peu gêné, je vous en prie sincèrement. C’est... c’est mon anniversaire demain et je serais heureux de vous avoir pour cavalière.
— Oh, dis-je, incapable d’en dire plus.
— Je pars chez ma fille lundi, je le fêterai là-bas en famille, bien sûr, mais... demain soir... si vous vouliez bien...
Il marque une petite pause, me regarde avec espoir. Est-ce une impression ? Il me paraît que Paloma s’essaie à l’apnée.
Un bref silence s’installe.
— Écoutez, dis-je, vraiment, je regrette. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée.
— Mais pourquoi ça ? demande Kakuro, visiblement déconcerté.
— C’est très gentil, dis-je en raffermissant une voix qui a tendance au relâchement, je vous en suis très reconnaissante, mais je ne préfère pas, merci. Je suis sûre que vous avez des amis avec lesquels vous pourrez fêter l’occasion.
Kakuro me regarde, interdit.
— Je..., finit-il par dire, je... oui bien sûr mais... enfin... réellement, j’aimerais beaucoup... je ne vois pas
Il fronce les sourcils.
— Enfin, dit-il, je ne comprends pas.
— C’est mieux comme ça, dis-je, croyez-moi.
Et, le refoulant doucement vers la porte en marchant vers lui, j’ajoute :
— Nous aurons d’autres occasions de bavarder, j’en suis sûre.
Il bat en retraite de l’air du piéton qui a perdu son trottoir.
— Eh bien dommage, dit-il, moi qui m’en faisais une joie. Tout de même...
— Au revoir, dis-je, et je lui ferme en douceur la porte au nez.
Le pire est passé, me dis-je.
C’est sans compter avec un destin couleur rose bonbon : je me retourne et me retrouve nez à nez avec Paloma.
Qui n’a pas l’air content du tout
— On peut savoir à quoi vous jouez ? me demande-t-elle d’un ton qui me rappelle Mme Billot, ma toute dernière institutrice.
— Je ne joue à rien du tout, dis-je faiblement, consciente de la puérilité de ma conduite.
— Vous avez prévu quelque chose de spécial demain soir ? demande-t-elle.
— Eh bien non, dis-je, mais ce n’est pas pour ça...
— Et peut-on savoir pourquoi, au juste ?
— Je pense que ce n’est pas une bonne chose, dis-je.
— Et pourquoi donc ? insiste mon commissaire politique.
Pourquoi ?
Est-ce que je le sais, au reste ?
C’est alors, sans crier gare, que la pluie se met à tomber.
Toute cette pluie..
Dans mon pays, l’hiver, il pleuvait. Je n’ai pas de souvenir de journées de soleil : seulement la pluie, le joug de la boue et du froid, l’humidité qui collait à nos vêtements, nos cheveux et, même au coin du feu, ne se dissipait jamais vraiment. Combien de fois ai-je pensé, depuis, à ce soir de pluie, combien de remémorations, en plus de quarante ans, d’un événement qui resurgit aujourd’hui, sous cette pluie battante ?
Toute cette pluie...
À ma sœur, on avait donné le prénom d’une aînée mort-née, qui portait déjà celui d’une tante défunte. Lisette était belle et, quoique enfant encore, je le connaissais déjà, bien que mes yeux ne sachent point encore déterminer la forme de la beauté mais seulement en pressentir l’esquisse. Comme on ne parlait guère chez moi, cela n’était même jamais dit ; mais dans le voisinage, on jasait et quand ma sœur passait, on commentait sa beauté. « Si belle et si pauvre, un bien vilain destin », glosait la mercière sur le chemin de l’école. Moi, laide et infirme de corps comme d’esprit, je tenais la main de ma sœur et Lisette marchait, tête haute, pas léger, laissant dire, sur son passage, toutes ces destinées funestes auxquelles chacun s’évertuait à la vendre.
À seize ans, elle partit à la ville garder des enfants de riches. Nous ne la revîmes plus de toute une année. Elle revint passer Noël chez nous, avec des cadeaux étranges (du pain d’épice, des rubans de couleur vive, des petits sachets de lavande) et une mine de reine. Se pouvait-il trouver figure plus rose, plus animée, plus parfaite que la sienne ? Pour la première fois, quelqu’un nous racontait une histoire et nous étions pendus à ses lèvres, avides de l’éveil mystérieux que provoquaient en nous les mots sortis de la bouche de cette fille de ferme devenue bonne des puissants et qui parlait d’un monde inconnu, chamarré et scintillant où des femmes conduisaient des voitures et rentraient le soir dans des maisons équipées d’appareils qui faisaient le travail à la place des hommes ou bien donnaient des nouvelles du monde quand on en actionnait la manette...
Quand je repense à tout cela, je mesure le dénuement dans lequel nous vivions. Nous n’habitions qu’à une cinquantaine de kilomètres de la ville et il y avait un gros bourg à douze, mais nous demeurions comme au temps des châteaux forts, sans confort ni espoir tant que perdurait notre intime certitude que nous serions toujours des manants. Sans doute existe-t-il encore aujourd’hui, en quelque campagne reculée, une poignée de vieux à la dérive qui ignore la vie moderne mais il s’agissait là de toute une famille encore jeune et active qui, lorsque Lisette décrivait les rues des villes illuminées pour Noël, découvrait qu’il existait un monde qu’elle n’avait même jamais soupçonné.
Lisette repartit. Pendant quelques jours, comme par une mécanique inertie, on continua à parler un peu. Quelques soirs durant, à table, le père commenta les histoires de sa fille. « Ben dur, ben drôle, tout ça. » Puis le silence et les cris s’abattirent de nouveau sur nous comme peste sur les malheureux.
Quand j’y repense... Toute cette pluie, tous ces morts... Lisette portait le nom de deux défuntes ; on ne m’en avait accordé qu’une, ma grand-mère maternelle, morte peu avant ma naissance. Mes frères portaient le prénom de cousins tués à la guerre et ma mère elle-même tenait le sien d’une cousine morte en couches, qu’elle n’avait pas connue. Ainsi vivions-nous sans mots dans cet univers de morts où, un soir de novembre, Lisette revint de la ville.
Je me souviens de toute cette pluie... Le bruit de l’eau martelant le toit, les chemins ruisselants, la mer de boue aux portes de notre ferme, le ciel noir, le vent, le sentiment atroce d’une humidité sans fin, qui nous pesait autant que nous pesait notre vie : sans conscience ni révolte. Nous étions serrés les uns contre les autres près du feu lorsque, soudain, ma mère se leva, déséquilibrant toute la meute ; surpris, nous la regardâmes se diriger vers la porte et, mue par une obscure impulsion, l’ouvrir à la volée.
Toute cette pluie, oh, toute cette pluie... Dans l’encadrement de la porte, immobile, les cheveux collés au visage, la robe détrempée, les chaussures mangées de boue, le regard fixe, se tenait Lisette. Comment ma mère avait-elle su ? Comment cette femme qui, pour ne nous point maltraiter, n’avait jamais laissé comprendre qu’elle nous aimait, ni du geste ni de la parole, comment cette femme fruste qui mettait ses enfants au monde de la même manière qu’elle retournait la terre ou nourrissait les poules, comment cette femme analphabète, abrutie au point de ne même jamais nous appeler par les prénoms qu’elle nous avait donnés et dont je doute qu’elle se souvenait toujours, avait-elle su que sa fille à demi-morte, qui ne bougeait ni ne parlait et fixait la porte sous l’averse battante sans même songer à frapper, attendait que quelqu’un l’ouvrît et la fît entrer au chaud ?
Читать дальше