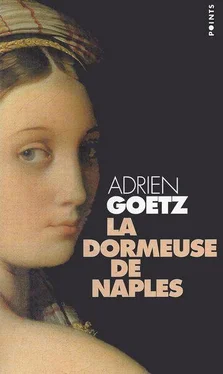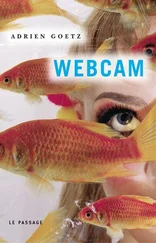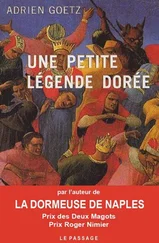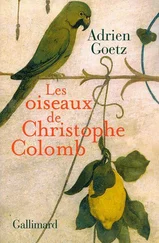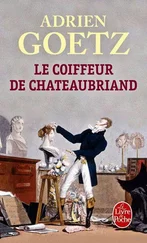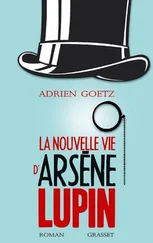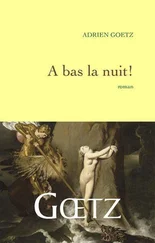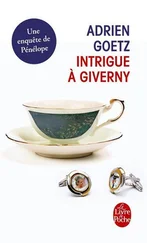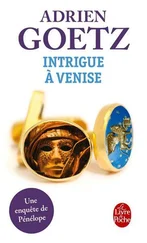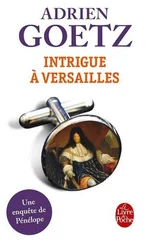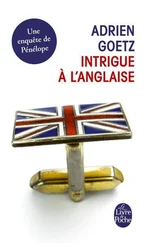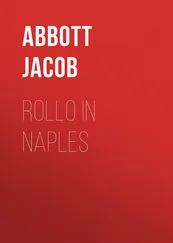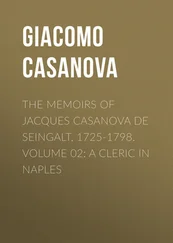Je partais dans la campagne, avec mon vieil ami Baehr en compagnie duquel j’avais voyagé depuis Paris en passant par Genève, avec Edouard Bertin ou Caruelle, qui se faisait appeler Caruelle d’Aligny, autres amoureux de l’art du paysage. Fidèle à mon vœu, jamais de chapeau, le soleil me tapait sur la caboche, ce qui peut expliquer la suite de cette histoire.
Nous apprenions à connaître ces noms de Terni, Civita Castellana, Papigno, des villes et des villages qui devenaient nos œuvres. On les avait construits exprès pour nous. Les auberges grouillaient d’artistes et de puces. Nous montions des expéditions de conquête qui duraient parfois un mois ou deux. Quand nous n’avions plus de couleurs, nous retournions en acheter à Rome avant de repartir. Je voulais saisir par l’étude tout ce qu’il y a de fugitif, les nuages, les ombres qui tournent sur les murs ; et la perspective aérienne, le sommet de l’art du paysage, car elle ne tient à rien. Faire voir que le ciel s’éloigne quand on regarde l’horizon. C’est simple à dire, mais prenez un pinceau et essayez donc. Puis, vous verrez si vous pouvez donner du relief à des nuages sans qu’ils aient l’air d’être sculptés dans le marbre de Carrare.
Je n’étais donc pas intéressé par la figure. J’étais comme un artiste mahométan à qui sa religion interdit les visages. Je m’y exerçais en secret — j’ai toujours, contrairement à Ingres et à Delacroix, été parfaitement incohérent —, comme il se doit, mais sans goût et sans exceller. Dès que j’avais raté un portrait, je m’empressais de réussir au moins sept études de paysage. Je choisissais dans la campagne des morceaux qui ne disaient rien au voyageur, aux perfides Anglais collectionneurs de « vues » pour mettre de la couleur dans leurs manoirs où même les fantômes sont gris ; on en avait assez de ces « Cascatelles de Tivoli », de ces « Temple de la Minerve » et autres « Grottes du Pausilippe » ; depuis cinquante ans, on ne sortait pas de là. Il y avait même une maison au bord du Tibre que l’on appelait « la fabrique du Poussin » parce que déjà le grand maître la mettait souvent dans les paysages qu’il composait. Tous s’y exerçaient, l’Italie recueillait les médiocrités de l’Europe, depuis les plus simplets des Danois et des Russes jusqu’à ce bellâtre aquarelliste de Granet qui se prenait pour un maître. Les peintres se mettaient aux mêmes endroits que leurs devanciers, sans même espérer faire mieux qu’eux. C’est que cela se vendait. Le sommet, c’était bien sûr le « paysage historique » : on faisait semblant de raconter une histoire, « Didon laissant interrompue la construction de Carthage » ou « Psyché, Pan et l’Amour », « la continence de Scipion », « le testament d’Eudamidas », repris vaille que vaille du Poussin, petites silhouettes en papier mâché qui occupaient le premier plan, et derrière, on assemblait une montagne prise là, des rochers copiés ailleurs, deux ou trois ciels au choix selon les heures du jour. On pouvait s’aider de manuels : cent pages d’arbres, dix pages de sources, cinquante de fabriques et de petits temples, une falaise ou un chaos de rochers pour varier un peu. Toute la science du paysage consistait à combiner au mieux ces modèles, comme on construit un décor de théâtre ; au premier plan un portant plus sombre, un plan moyen en pleine lumière, le fond dans une brume de bon aloi. Comme dans les mauvais théâtres, on n’avait pas tant de décors en magasin ; la même fontaine resservait de « Théagène et Chariclée » à « Orphée poursuivi par les femmes de Thrace ». Autant se mettre au point de croix ou à la dentelle. J’avais envie d’autre chose. Peu m’importaient les sujets. J’ai commencé par peindre la vue de ma fenêtre : des toits, des cheminées et la coupole de Saint-Pierre qui avait l’air de s’y trouver perchée par hasard.
Je n’étais pas le premier. Mais pour les autres, c’étaient les gammes, et des tableautins indignes d’être montrés. Cette vue de ma fenêtre, j’y tenais comme à la prunelle de mes yeux. Je l’ai toujours avec moi.
La vie des peintres de paysage, à Rome en ces années, me parut heureuse. On ne retrouvera pas ailleurs ce mélange d’Anglais, d’Allemands, de Russes, de Français, de Nordiques et d’Américains. Nous faisions un Congrès de Vienne du paysage. Caruelle d’Aligny jouait le rôle de Talleyrand et demandait à chacun de se faire envoyer un fromage. Ernst Fries voulait m’apprendre l’allemand et dessiner mon portrait. Je lui laissais faire la seconde chose. J’ai oublié le nom du Russe qui parlait latin avec l’accent de Pétersbourg. Les Espagnols peignaient pendant la nuit. Un Anglais illuminé voulait des paysages « cosmiques ». Nous nous amusions bien, même si je me mêlais assez peu.
Je ne demandais rien à personne. J’avais la paix. Ma mère restait rue du Bac à vendre ses rubans, mon père chassait tous les dimanches, ils m’envoyaient un peu d’argent. Ils étaient loin. Je les avais déçus. J’en prenais mon parti. J’ai toujours été un propre à rien. Ils m’ont toute leur vie eu à leur charge. Même quand on a commencé à acheter mes barbouillages, ils m’ont continué leur pension. Mon père l’a même augmentée en cachette de ma mère quand j’ai eu la Légion d’Honneur. Le pauvre homme, il avait d’abord cru que c’était pour lui, le plus honnête des commerçants de Paris. Comme le ruban aurait bien fait sur sa redingote. La garde nationale aurait présenté les armes à son passage. Il a cru que le gouvernement devenait fou de donner la croix au grand fils imbécile de cinquante ans qu’il était encore obligé de nourrir. Pourquoi pas le faire amiral. Puis, il a été fier, sans trop comprendre de quoi. En attendant, j’avais vécu comme je voulais. Je n’en avais fait qu’à ma tête. C’est cela qui compte. Je m’étais organisé la petite nullité de mon existence. Mon seul bonheur, c’est un rectangle de papier sur lequel je peux écraser un pinceau bien gras, le nez sur la couleur, et la regarder se répandre. Attaquer par le centre, estomper, ajouter des taches blanches, minuscules, prendre du recul, laisser, retravailler ailleurs, le carnet sous le bras. Voici la petite surface du monde que je contrôle, le domaine sur lequel j’ai pouvoir, le rectangle de carton qui échappe aux parents Corot. Je sais exactement où je dois placer une touche de pâte blanche sur une balustrade pour que le soleil l’illumine. Je sais dans quel sens doivent naviguer les nuages pour donner du relief à la colline au-dessous d’eux. Je sais à quelle heure l’ombre verte de la colonne de Phocas touche l’architrave dorée du temple de Saturne. À Rome, je n’aurais rien souhaité d’autre que rester dans mon coin avec ma palette et ma boîte, à laquelle j’avais fixé une sangle pour la prendre en bandoulière, partir à pied dans la campagne et trouver un sujet par jour. Ouvrir mes carnets, tailler mes crayons. Sortir mes pinceaux de leur carquois. Le soir à l’auberge, retravailler tout cela, le lendemain à la même heure se replacer au même endroit, attendre que la lumière soit identique, et retravailler encore jusqu’à ce que le sentiment soit juste. J’étais si tranquille. Mais il fallait bien fréquenter les autres, participer aux concours de fromages ; je ne pouvais pas rester comme un ours. Le brie de Meaux gagnait à chaque fois.
Baehr s’était intégré à la société de Rome et rendait des visites en ville. Il m’entraînait au caffè Greco, je finis par connaître du monde. Pour lui faire plaisir, je traînais de plus en plus souvent dans les ruelles autour du Panthéon, mais j’aurais préféré être chez moi à peindre.
Rome se partageait alors entre plusieurs sociétés secrètes. C’était la ville la plus dissimulatrice qui se pouvait voir. Tous les Romains s’habillaient couleur de muraille. On complotait universellement. Les artistes ne faisaient pas exception, l’esprit rapin en plus. Ce n’étaient ni la maçonnerie ni la charbonnerie, qui étaient choses sérieuses, dont on avait peur, mais des sociétés pour rire et pour boire qui se donnaient des airs de conspiration. Il y avait l’Académie chocolatine et la confrérie des porteurs d’eau chaude. Je fus initié, parrainé par Caruelle d’Aligny, à la plus muséophilique de toutes, la « Société antonine », qui comptait déjà, me dit Caruelle, bon nombre de peintres dont il m’énuméra les noms. Edouard Bertin avait été initié à son précédent voyage et faisait figure d’ancien. Je fus fier de l’honneur, grisé par la cérémonie qui me parut calquée sur celle qui fait de monsieur Jourdain le Mamamouchi que l’on sait. Mais le but de l’association était sérieux, un peu païen, quoique sans grand danger pour l’âme. La Société antonine prescrivait à ses membres la lecture du Manuel d’Epictète. Imaginez avec quelle peine je m’attelais à la tâche — avec deux traductions différentes. Une fois l’ouvrage digéré, ce n’était rien. Essayez un peu de vivre selon le Manuel d’Epictète. Je voulus m’y mettre, je trébuchais au bout de cinq jours, à moitié mort de faim, perdant le sommeil, harcelé de désirs insoupçonnés qu’avaient fait naître dans mon pauvre corps mille privations saugrenues. Je n’ai pas recommencé. Pourtant, cette farce en forme de turquerie fut l’origine du bonheur de ma vie. Ce fut mon sacre de Napoléon.
Читать дальше