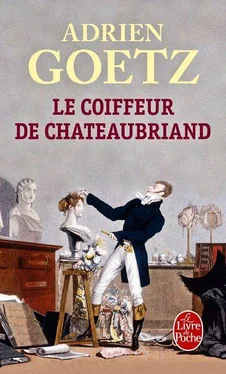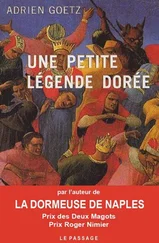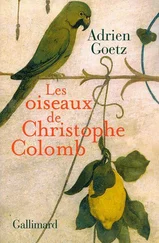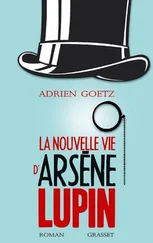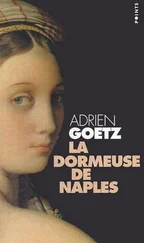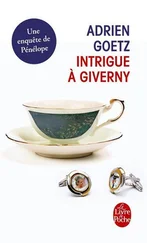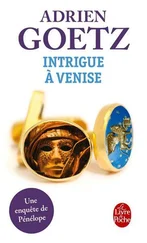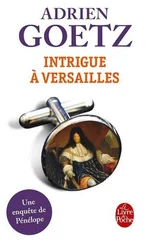Il intervint, avec une amabilité de diplomate : « Vous savez, cher Adolphe, que je ne suis jamais encore venu chez vous, faites-moi tout voir. »
Je tremblais qu'il ne trouvât mon placard.
Je le fis entrer. La première réflexion qu'il fit fut celle-ci :
« Vous avez là une fort jolie maison et des mieux tenues, si ce n'est que je m'étonne, chez vous qui aimez tant les livres, de n'en voir aucun. Chez nous, dans notre palais trop petit, nous en avons trop, il faudra que vous en preniez quelques-uns à chacune de vos visites. »
Je lui expliquai que des soucis d'économie m'avaient amené à devenir client d'un cabinet de lecture du boulevard Saint-Germain. Je rendais les livres aussitôt lus. Ce que je n'osais lui dire c'est que pour les plus beaux, je n'avais pas besoin de les garder chez moi. Je les savais. J'avais ma bibliothèque avec ses rayonnages bien organisés à l'intérieur de la cavité de mon crâne.
Il ne dit rien, mais dès le lendemain, un commis me fit porter l'édition Ladvocat de ses œuvres, qui n'étaient pas encore complètes, puisque le plus beau manquait, qu'il voulait peaufiner encore, ses Mémoires. Le coursier apporta aussi les romans de M mede Duras et un choix de poésies. Je n'eus pas la naïveté de croire que ces beaux volumes reliés de cuir vert étaient uniquement pour moi. Sur la tranche, délicatesse extrême, il avait fait dorer mon chiffre, les lettres A.P., car il avait un relieur personnel qui avait dû travailler dans l'heure. Il fallait songer à distraire et à occuper la belle Ourika — elle ne s'appelait ni Velléda ni Cymodocée, mais bien Sophie — durant ce séjour à Paris dont je n'osais demander la durée. J'installai moi-même les livres dans sa chambre. Chateaubriand y avait ajouté des partitions rares. Elle choisit tout de suite la transcription de cette suite de ballet de Beethoven que peu de gens connaissent. En l'écoutant, j'imaginais Prométhée enchaîné à son rocher, le foie dévoré chaque jour par l'aigle de Jupiter.
Ces volumes de chez Ladvocat sont pour moi une relique de ces journées, de ces années. Le premier porte sur la page de garde d'une haute écriture à peine tremblée : « Pour mon cher Adolphe Pâques, son ami, Chateaubriand. » Je sus par un des neveux de M. Joseph Joubert, qui avait été son plus vieil ami et lui avait trouvé le surnom de l'Enchanteur, qu'il n'avait pas eu mieux sur l'édition originale du Génie du christianisme, qu'il conservait pieusement dans la salle de billard-bibliothèque de leur belle maison de Villeneuve, sur les bords de l'Yonne, là où Les Martyrs avaient été composés.
Ce que le grand homme attendait de moi était clair : nous entreprendrions, M lleOurika-Atala et moi, des séances de lecture admirative suivies de conversations littéraires, qui la mettraient au fait de tout ce qui concernait notre illustre voisin et la feraient patienter jusqu'à l'heure de la visite, qu'il promit de lui faire chaque jour, en fin d'après-midi, « pour éclaircir quelques détails de la vie malouine, nécessaires à la relecture des premiers livres de mes mémoires, avant de les faire déposer à la société éditoriale, ces forbans qui sont propriétaires de ma postérité ».
Chateaubriand poursuivait : « J'ai vendu mes Mémoires, je vous l'ai dit déjà. J'avais besoin de subsides, j'avais le pied sur la gorge, toujours à court d'argent, depuis ce nouveau souverain, abject usurpateur qui nous met à la rue. Les charités de M mede Chateaubriand aussi achèveront ma ruine ! Je finirai au milieu de ses pauvres ! Je n'écris plus que pour eux, mes pages servent à secourir des misères que seule la sainte femme connaît. Une femme qui aime les bijoux, c'est terrible, mais une femme qui aime les pauvres, c'est sans fond. En plus, elle ne lit rien. Je ne sais pas ce qu'elles valent, mes pages, je vous en lirai encore si vous voulez, mais je puis dire, déjà, que c'est une bonne œuvre ! J'ai hypothéqué ma tombe. »
La vérité était, bien entendu, un peu différente. Dit comme cela, c'était si beau — il nous avait sorti au passage trois phrases de sa préface, avec en plus la drôlerie de sa conversation, que ses lecteurs ne devinent pas toujours. Il me prit à part pour m'obliger à accepter quelques louis pour les frais de notre pensionnaire, mais surtout pour me demander si ces séances de lecture avec elle ne me gêneraient pas. Je lui répondis que je me sentais le jeune homme de compagnie de quelque princesse orientale. « Jeune homme, cher Adolphe, tu l'es assurément, et il est des moments où j'aimerais avoir ton âge. Je suis terriblement jaloux de ta jolie tête à l'antique ! »
« À l'antique », il me mettait au musée ! Nous ferions donc, elle et moi, des progrès en littérature. Je me décidai à lire tout ce que je ne connaissais pas encore : l 'Essai sur les révolutions et De la liberté de la presse, les autres livres politiques, pour me mettre un peu de plomb dans la cervelle. Je me réjouissais d'avance de ces découvertes. Je cherchais surtout les lectures les plus sérieuses possible. Je regardais les yeux noirs de la jeune Malouine, Sophie. Je tremblais de peur devant cette mosaïque de bonnes intentions. À son pavement, je venais de reconnaître l'Enfer.
Elle m'avait apporté le brouillard, les brumes et le vent salé. Comme je les imaginais à Saint-Malo, une ville que j'allais découvrir bien plus tard, à cause d'elle. Le brouillard, pour moi qui n'aimais que les lignes nettes et qui haïssais l'imprévu. Elle me raconta ce qu'avait été sa vie. Elle me dit comment elle s'appelait. Elle me laissa deviner son vrai caractère. Elle avait une fermeté qui me faisait peur, un caractère trempé, un sérieux qui la rendait quelquefois glaciale, puis elle s'animait. Un regard tranchant comme une lame. Elle avait dû souffrir de son isolement. Elle était d'une solidité de navire qui survit à toutes les tempêtes. Elle donnait aussi, à d'autres moments, envie de la réconforter et de lui dire qu'elle était ici en sécurité, que la vie n'obligeait pas toujours à se battre et qu'elle n'avait pas à avoir peur de l'avenir. Je me trompe peut-être, je n'ai pas eu assez de temps pour la connaître ; je ne l'ai pas assez fait parler. Elle ne s'épanchait guère. Elle était arrivée déguisée en soldat de Mozart, elle sortit de jolies robes de sa malle. J'imaginais qu'à Saint-Malo, voir des jeunes filles à la peau sombre était moins rare qu'à Paris.
Autant aller au fait, dire tout de suite ce qui m'est arrivé ce premier jour.
Il faut ici une brève interruption, une coupure. Je reprendrai le récit dans quelques lignes.
Il y avait deux hommes en moi, et je ne l'avais pas compris. Le bon M. Pâques, le coiffeur bien coiffé, le bonhomme dont on se moque et que ses amis imitent au dîner mensuel des grands coiffeurs. Et un autre, qui existait aussi et que je ne voyais pas quand je me regardais dans la glace. Un Adolphe Pâques qui n'avait pas mon visage, pas ma stature, qui ne me ressemblait pas, mais qui était moi, aussi : celui qui lisait à haute voix les pages de M. de Chateaubriand. Celui qui aurait voulu aller aux Amériques, à Jérusalem et aux Indes, celui qui aurait aimé écrire.
Ce second Adolphe s'éveilla au premier des regards de la jeune Malouine. Si j'étais si bien avec Zélie, ma femme, si je ne concevais pas de la quitter, c'est parce qu'elle ne s'adressait qu'au premier de ces deux hommes. Elle ne s'était même jamais aperçue que l'autre existât. Elle avait des excuses. L'autre ne sortait que rarement de sa torpeur, enfermé depuis des années, depuis mes solitudes de Boulogne au pied de la colonne de la Grande Armée. Il sortait de sa cachette de bronze, l'autre, quand j'étais seul, à lire, quand je rêvais. Quand j'ai eu trente ans, peu après ces événements, j'ai même pensé qu'il était mort. Que je ne le reverrais plus, que je ne serais bon qu'à rire, à vivre bien, et à entendre mes amis se moquer de mon accent du Nord. Dès que je parlai avec elle, je compris qu'il existait vraiment, ce frère intérieur, ce héros que j'avais cherché à étouffer parce qu'il était moi et ne me ressemblait en rien. Avec elle, si sérieuse, je n'aurais pas envie de rire, de déjeuner au jardin ou de complimenter la cuisinière. Elle avait le même ton que les phrases de Chateaubriand. Elle me faisait lever la tête. Mieux que la meilleure des interprètes, des comédiennes, des lectrices. Un don naturel, une voix, que j'entendis aux premiers mots. C'est ce que j'aimai, tout de suite, en elle.
Читать дальше