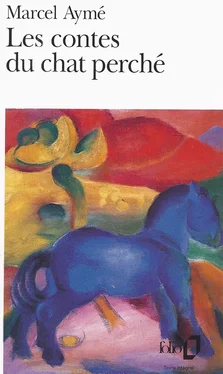Un jour, Delphine et Marinette dirent à leurs parents qu’elles ne voulaient plus mettre de sabots.
Voilà ce qui s’était passé. Leur grande cousine Flora, qui avait presque quatorze ans et qui habitait le chef-lieu, venait de faire un séjour d’une semaine à la ferme.
Comme elle avait été reçue un mois plus tôt à son certificat d’études, son père et sa mère lui avaient acheté un bracelet-montre, une bague en argent et une paire de souliers à talons hauts. Enfin, elle n’avait pas moins de trois robes rien que pour le dimanche. La première était rose avec une ceinture dorée, la deuxième verte avec un bouillon de crêpe sur l’épaule, et la troisième en organdi. Flora ne sortait jamais sans mettre de gants. Elle regardait l’heure avec des ronds de bras et parlait beaucoup de toilettes, de chapeaux, de fer à friser.
Un jour donc, après le départ de Flora, les petites se poussèrent du coude pour s’encourager et Delphine dit aux parents :
— Les sabots, ce n’est pas si commode qu’on croit. On se fait surtout mal aux pieds et, ce qui arrive aussi, c’est que l’eau entre par-dessus, tandis qu’avec des souliers, il y a moins de risque, surtout si le talon est un peu haut. Et les souliers, c’est tout de même plus joli.
— C’est comme les robes, dit Marinette. Au lieu de rester toute la semaine en tablier avec une robe de rien en dessous, il vaudrait mieux sortir de l’armoire un peu plus souvent nos robes du dimanche.
— C’est comme les cheveux, dit Delphine. Au lieu d’avoir les cheveux sur les épaules, ce serait bien plus commode de les relever. Et plus joli aussi.
Les parents respirèrent un grand coup et, après avoir un moment regardé leurs filles en fronçant les sourcils, répondirent avec une voix terrible :
— Voilà des façons de parler qui ne nous plaisent pas. Ne plus mettre vos sabots ! sortir de l’armoire vos robes du dimanche ! Est-ce que vous avez perdu la tête ? Vous pensez, oui, vous pensez comme on va vous donner vos souliers et vos bonnes robes pour tous les jours. Ce serait bientôt dévoré et il ne vous resterait plus rien de propre pour quand vous iriez voir l’oncle Alfred. Mais le plus fort, c’est les cheveux relevés. Des gamines de votre âge ! Ah ! si jamais vous parlez encore de cheveux relevés…
Les petites n’osèrent plus parler aux parents de cheveux, de robes, ni de souliers. Mais quand elles étaient seules, en allant à l’école ou au retour, ou sur les prés à garder les vaches, ou aux bois à cueillir les fraises, elles mettaient des pierres dans leurs sabots pour avoir le talon plus haut, elles mettaient leur robe à l’envers pour se donner ainsi l’illusion d’en changer, elles nouaient leurs cheveux sur la tête avec une ficelle.
Et à chaque instant, elles se demandaient :
— Est-ce que j’ai la taille assez mince ? Est-ce que je fais d’assez petits pas ? Et mon nez, tu ne trouves pas que ces jours-ci il est un peu long ? Et ma bouche ? Et mes dents ? Est-ce que tu crois que le rose m’irait mieux que le bleu ?
Et dans leur chambre, elles n’avaient jamais fini de se regarder dans la glace, ne rêvant plus que d’être belles et d’avoir de beaux habits. Même, il y avait à la ferme un lapin blanc qu’elles aimaient beaucoup et il leur arrivait de rougir en pensant que le jour où on le mangerait, sa peau ferait une bien jolie fourrure.
Un après-midi, devant la ferme, assises à l’ombre d’une haie, Delphine et Marinette ourlaient des torchons. A côté d’elles et les regardant travailler il y avait une grosse oie blanche. C’était une bête tranquille, qui aimait la conversation et les plaisirs raisonnables. Elle se faisait expliquer à quoi sert d’ourler les torchons et comment s’y prendre.
— Il me semble que j’aimerais bien coudre, disait-elle aux petites. Ourler des torchons surtout.
— Merci, répondant Marinette, moi j’aimerais mieux coudre dans des robes. Ah ! si j’avais du tissu… par exemple, trois mètres de soie lilas… je me ferais une robe décolletée en rond avec un froncé de chaque côté.
— Moi, disait Delphine, je vois une robe rouge décolletée en pointe, avec trois rangs de boutons blancs jusqu’à la ceinture.
Tandis qu’elles parlaient ainsi, l’oie secouant la tête en murmurant :
— Tout ce que vous voudrez, mais moi j’aimerais mieux ourler des torchons.
Dans la cour, il y avait un cochon bien gras qui se promenait à petits pas. En sortant de la maison pour aller aux champs, les parents s’arrêtèrent devant lui et dirent :
— Il devient gras. Il est de plus en plus beau, ma foi.
— Vous trouvez ? dit le cochon. Je suis bien content de vous entendre dire que je suis beau. C’est ce que je pensais aussi.
Un peu gênés, les parents s’éloignèrent. En passant auprès des petites, ils leur firent compliment de leur application. Penchées sur leurs torchons, Delphine et Marinette tiraient l’aiguille sans échanger une parole, comme si rien n’eût compté pour elles que de faire des ourlets. Mais à peine les parents eurent-ils tourné le dos qu’elles se remirent à parler robes, chapeaux, souliers vernis, ondulations, montres en or, et l’aiguille courait moins vite dans la toile. Elles jouaient aux dames en visite, et Marinette en pinçant la bouche, demandait à Delphine :
— Chère Madame, où donc avez-vous fait faire ce joli tailleur ?
L’oie ne comprenait pas bien. Un peu étourdie par ces bavardages, elle commençait à sommeiller quand arriva du fond de la cour un coq désœuvré qui se planta devant elle et dit en la regardant d’un air apitoyé :
— Je ne voudrais pas te faire de peine, mais tu as quand même un drôle de cou.
— Un drôle de cou ? dit l’oie. Pourquoi, un drôle de cou !
— Cette question ! mais parce qu’il est trop long ! Regarde le mien…
L’oie considéra un moment le coq et répondit en hochant la tête :
— Eh bien ! oui, je vois que tu as le cou beaucoup trop court. Je dirai même que c’est loin d’être joli.
— Trop court ! s’écria le coq. Voilà que maintenant c’est moi qui ai le cou trop court ! En tout cas, il est plus beau que le tien.
— Je ne trouve pas, fit l’oie. Du reste, ce n’est pas la peine de discuter. Tu as le cou trop court et un point c’est tout.
Si les petites n’avaient pas été aussi occupées de robes et de coiffures, elles se seraient avisées que le coq était très vexé et auraient essayé d’arranger les choses.
Il se mit à ricaner et dit avec un air insolent :
— Tu as raison. Ce n’est pas la peine de discuter. Mais sans parler du cou, je suis mieux que toi. J’ai des plumes bleues, des plumes noires et même des jaunes. Surtout j’ai un très beau panache, tandis que toi, je trouve que tu finis drôlement.
— J’ai beau te regarder, riposta l’oie, je vois un petit tas de plumes ébouriffées qui ne sont guère plaisantes. C’est comme cette crête rouge que tu as sur la tête, tu n’imagines pas, pour quelqu’un d’un peu délicat, combien c’est écœurant.
Alors, le coq devint furieux. Il fit un saut qui le porta tout contre l’oie et cria de toute sa voix :
— Vieille imbécile ! Je suis plus beau que toi ! tu entends ! Plus beau que toi !
— Ce n’est pas vrai ! Espèce de brimborion ! C’est moi la plus belle !
Au tapage, les petites avaient laissé leur conversation sur les robes et se préparaient à intervenir, mais le cochon, qui avait entendu les cris, traversa la cour au galop et, s’arrêtant auprès du coq et de l’oie, leur dit tout essoufflé :
— Qu’est-ce qui vous prend ? Est-ce que vous avez perdu la tête, tous les deux ? Voyons, mais le plus beau, c’est moi !
Читать дальше