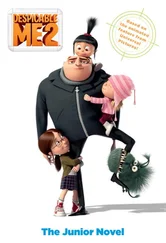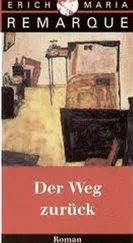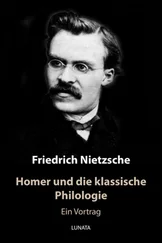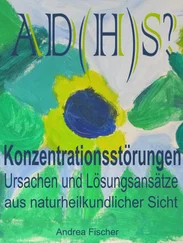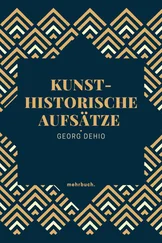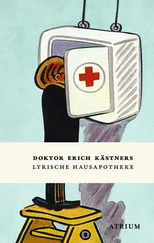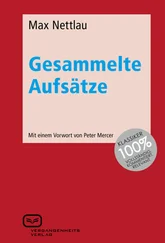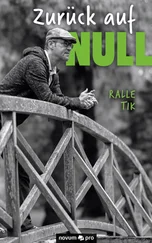DanteDante lui-même, quand il parle de sa Comédie dont le sujet est des plus sublimes – le sort des âmes après la mort, la justice de Dieu révélée – s’exprime parfois d’une manière qui rappelle l’idée de son commentateur Benvenuto ; pour désigner son poème, il se sert du mot commedia , tandis qu’en parlant de l’ Énéide il dit à Virgile : l’alta tua tragedia . Dans un passage souvent cité de la lettre à Cangrande, il explique ce choix du titre par deux considérations : c’est une comédie d’abord parce que la fin en est heureuse, et ensuite parce que son style est bas et humble: remissus est modus et humilis humilis , quia locutio vulgaris in qua et mulierculae comunicant . De prime abord il peut sembler que la seconde considération ne se rapporte qu’à l’emploi de la langue italienne ; mais ce n’est pas ainsi qu’il faut comprendre, car DanteDante lui-même a créé le style sublime en langue italienne, autant dans la théorie du De Vulgari Eloquentia que dans la pratique des grandes Canzoni ; c’est lui précisément qui a créé l’idée du Vulgare illustre vulgare illustre et qui est le fondateur de ce qu’on appelle l’humanisme en langue vulgaire. Donc il est loin de regarder chaque œuvre comme étant de style bas du seul fait qu’elle est écrite en langue maternelle et non en latin. Les paroles sur le style bas et humble de la Divine Comédie ne se rapportent pas à l’emploi de la langue italienne, mais bien au choix des mots bas et au réalisme fort poussé dans beaucoup de parties du poème3 – deux choses qui lui semblaient incompatibles avec le genre sublime et tragique tel qu’il l’avait conçu en étudiant la théorie des anciens. Toutefois il se rend compte que son poème dépasse les bornes du style bas. Dans ce même passage de la lettre à Cangrande dont nous parlons, il cite les vers de l’ Art poétique d’HoraceHoraz qui permettent au poète comique d’employer parfois le style tragique et vice versa – sans doute pour nous dire qu’il a fait usage de cette faculté. Mais il y a bien plus : DanteDante sait que son style comme son sujet sont des plus sublimes. Inutile d’énumérer ici tous les passages qui en témoignent. Notons seulement qu’il appelle deux fois sa Comédie «poème sacré», qu’il aspire au laurier des plus grands poètes, que Virgile est son modèle, qu’il traite de la matière la plus haute qui existe, à laquelle les forces humaines suffisent à peine et que personne avant lui n’a essayée, qu’il implore l’inspiration des Muses, d’Apollon et enfin de Dieu lui-même. Le poème sacré, al qual ha posto mono e cielo e terra , n’est pas une œuvre du style bas, et son auteur le sait, malgré le titre et les explications qu’il en donne. Ce n’est pas non plus un poème du style sublime dans l’acception antique ; il y a trop de réalisme, trop de vie concrète, trop de biotikon , comme disaient les théoriciens grecs : autant dans les paroles que dans les faits, et non seulement chez les habitants de l’Enfer, mais aussi au Purgatoire, souvent même dans le Paradis. Donc si c’est du sublime, c’est un sublime d’un autre genre que celui de l’antiquité, un sublime qui contient et comprend le bas et le biotikon ; DanteDante l’a bien vu, quoiqu’il ait éprouvé des difficultés à s’exprimer nettement sur ce problème. Benvenuto da Imola l’a compris quand il dit, à la fin de son introduction : unde si quis velit subtiliter investigare, hic est tragoedia, satyra et comoedia . Et les Romantiques du XIX esiècle s’en sont inspirés, toutefois d’une manière un peu superficielle ; car c’est bien plus que de mêler le «grotesque» au sublime.
C’est une tâche assez délicate que de chercher les origines de la conception nouvelle de la haute poésie. La théorie du moyen âge avant DanteDante n’en dit rien, à ce qu’il semble ; mais la pratique se trouve très nettement établie dans l’art populaire chrétien depuis la fin du XI esiècle, autant dans le théâtre liturgique que dans la statuaire des cathédrales. L’histoire du Christ en offre tous les éléments ; plus elle devient populaire et familière à tous, plus son réalisme originaire, intimement lié à son sublime, se développe et refleurit. Il est indéniable qu’il s’agit d’un sublime de création essentiellement chrétienne, provoqué et inspiré par l’histoire du Christ et le «style» de l’Écriture sainte en général. On en trouve la théorie chez les Pères de l’ÉgliseKirchenväter ; il est vrai qu’après eux, du VI eau XI esiècle, on n’en trouve que des traces assez faibles et vagues – surtout dans les actes des martyrs.
Chez les Pères de l’ÉgliseKirchenväter, la conception du style simultanément humble et sublime réalisé dans l’Écriture sainte ne se forme pas d’une manière purement théorique, mais elle leur est pour ainsi dire imposée par les circonstances, par la situation dans laquelle ils se trouvaient. Elle s’est formée spontanément à la suite de la polémique provenant de la part des païens cultivés, qui se moquaient du mauvais grec et du réalisme bas des livres chrétiens ; en partie aussi à cause d’un certain malaise que des chrétiens qui avaient reçu une éducation soignée dans les écoles de rhétorique avaient éprouvé tout d’abord, eux aussi, à leur lecture. Par sa formation classique et par la force de son cour qui lui fait vivre toutes ses idées et leur donne une vigueur d’expression incomparable, saint AugustinAugustinus occupe, pour notre problème, la place la plus importante.
Il raconte dans ses Confessions (III, 5) comment tout d’abord il a commencé à lire les Saintes Écritures sans être capable de les comprendre : il n’était pas encore fait pour entrer dans leur sens ni pour suivre leur pas, car elles lui semblaient trop au-dessous de la dignité cicéronienne. Il n’avait pas encore compris, dit-il, que leur apparence extérieure était humble, mais leur contenu sublime et voilé de mystère ( rem … incessu humilem, successu excelsam et velatam mysteriis ) ; qu’il fallait les lire comme un petit enfant, et qu’elles «grandissaient avec les enfants». Plus tard il comprend : eoque mihi illa venerabilior et sacrosancta fide dignior apparebat auctoritas, quo et omnibus ad legendum esset in promptu, et secreti sui dignitatem in intellectu profundiore servaret : verbis apertissimis et humillimo genere loquendi se cunctis praebens, et exercens intentionem eorum qui non sunt leves corde ; ut exciperet omnes populari sinu, et per angusta foramina paucos ad se traiceret ; multo tamen plures quam si non tanto apice auctoritatis emineret, nec turbas gremio sanctae humilitatis hauriret ( ibid. , VI, 5). Dans ces passages, il s’agit surtout du contraste entre le style humble qui se prête aux plus simples et les mystères sublimes qui y sont cachés ; des mystères qui ne se révèlent qu’à peu de gens ; non pas aux érudits et aux orgueilleux, mais à ceux qui nont sunt leves corde , tout simples qu’ils sont. On trouve cette idée un peu partout dans l’ouvre de saint AugustinAugustinus, par exemple dans le premier chapitre De Trinitate : Sacra scriptura parvulis congruens nullius generis rerum verba vitavit, ex quibus quasi gradatim ad divina atque sublimia noster intellectus velut nutritus assurgeret ; au second livre De Doctrina christiana, où il parle de la Scripturarum mirabili altitudine et mirabili humilitate ; plusieurs fois quand il parle du langage de la Genèse ; et assez longuement dans une lettre à Volusien (CXXXVII, 18). Dans ce dernier passage, il dit notamment que même les mystères les plus profonds ne sont pas exprimés, dans l’Écriture sainte, par un langage «superbe» : ea vero quae in mysteriis occultat, nec ipsa eloquio superbo erigit, quo non audeat accedere mens tardiuscula et inerudita quasi pauper ad divitem ; sed invitat omnes humili sermone, quos non solum manifesta pascat, sed etiam secreta exerceat veritate, hoc in promptis quod in reconditis habens . Donc, dans tous ces passages, il s’agit d’une synthèse entre l’humble et le sublime, réalisée par l’Écriture sainte ; toutefois, le humile y signifie plutôt la simplicité de l’élocution que le réalisme, et le sublime ou altum plutôt la profondeur des mystères que le sublime poétique. Mais un mot tel que humilis humilis (parfois il emploie abiectus ) qui exprime en même temps l’humilité du cœur chrétien, la bassesse de la position sociale et la simplicité populaire du style4 amenait facilement la notion du réalisme, d’autant plus qu’il s’employait couramment pour désigner le bas peuple par opposition aux classes élevées, les pauvres par opposition aux riches. La vie du Christ, du Verbe incarné, modèle de vie et de mort saintes et sublimes, s’était passée elle aussi, comme une vie ordinaire ou les scènes d’une comédie, parmi les humiles personae qui avaient été ses premiers disciples. Saint AugustinAugustinus parle souvent de ces imperitissimi et abiectissimi , de ces piscatores et publicani que le Seigneur a élus avant tous les autres, et il explique pourquoi il a agi ainsi.5 Il y insiste d’autant plus qu’il sait que les païens érudits se moquent du sermo piscatorius sermo piscatorius des Évangiles. Mais ce n’est pas seulement l’entourage du Christ, c’est lui-même, son sort sur la terre qui exprime l’antithèse entre l’humble et le sublime dans sa forme la plus aiguë et la plus passionnante – et alors, il ne s’agit plus de l’élocution, mais des faits. Parmi les nombreux passages où saint Augustin fait ressortir le paradoxe du sacrifice de Jésus-Christ, je n’en citerai qu’un seul qui se trouve dans les Enarrationes in Psalmos, XCVI, 4 : Ille qui stetit ante iudicem, ille qui alapas accepit, ille qui flagellatus est, ille qui consputus est, ille qui spinis coronatus est, ille qui colaphis caesus est, ille qui in ligna suspensus est, ille cui pendenti in ligna insultatum est, ille qui in cruce mortuus est, ille qui lancea percussus est, ille qui sepultus est, ipse resurrexit : Dominus regnavit. Saeviant quantum possunt regna ; quid sunt factura Regi regnorum, Domino omnium regnorum, Creatori omnium saeculorum ? On dira peut-être qu’un tel passage ne fait que résumer le récit de la Passion, et qu’il ne contient que des choses connues par les Évangiles et par les lettres de saint Paul qui a exprimé la même idée plusieurs fois, par exemple Phil. II , 7–11. Mais ni les Évangiles ni saint Paul n’ont aussi puissamment relevé l’antithèse entre le bas réalisme de l’humiliation et la grandeur surhumaine qui s’unissent ici ; pour la sentir dans toute sa force il fallait un homme formé aux idées classiques de la séparation des styles qui n’admettaient pas de réalisme dans le sublime ni d’humiliation corporelle chez le héros de la tragédie. Il est vrai que l’idée du sublime tragique avait subi chez quelques groupes de poètes et de théoriciens des restrictions et des modifications ; mais elles ne sont nullement comparables à la violence de l’humiliation réaliste qu’offrent la vie et la passion du Christ. Saint AugustinAugustinus a senti que l’ humilitas de l’Évangile est en même temps une forme toute nouvelle du sublime : une forme qui lui semblait, s’il la comparait aux conceptions de ses contemporains païens, plus profonde, plus vraie, plus substantielle ; elle aussi, tout comme l’Évangile dans lequel elle est contenue, excipit omnes populari sinu , et non seulement tous les hommes sans égard à leur position sociale, mais toute leur vie basse et quotidienne. La conception de l’homme, de ce qui en lui peut être admirable et digne d’imitation, se modifiait profondément ; Jésus-Christ devient le modèle à suivre, et c’est en imitant son humilité qu’on peut approcher de sa majesté ; c’est par l’humilité qu’il a atteint lui-même le comble de la majesté, en s’incarnant non pas dans un roi de la terre, mais dans un personnage vil et méprisé.
Читать дальше