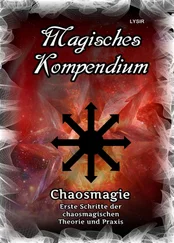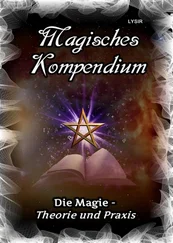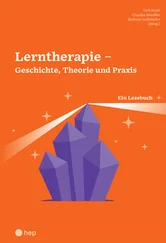Informationswissenschaft - Theorie, Methode und Praxis / Sciences de l'information - théorie, méthode et pratique
Здесь есть возможность читать онлайн «Informationswissenschaft - Theorie, Methode und Praxis / Sciences de l'information - théorie, méthode et pratique» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Informationswissenschaft: Theorie, Methode und Praxis / Sciences de l'information: théorie, méthode et pratique
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:4 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 80
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Informationswissenschaft: Theorie, Methode und Praxis / Sciences de l'information: théorie, méthode et pratique: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Informationswissenschaft: Theorie, Methode und Praxis / Sciences de l'information: théorie, méthode et pratique»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Informationswissenschaft: Theorie, Methode und Praxis / Sciences de l'information: théorie, méthode et pratique — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Informationswissenschaft: Theorie, Methode und Praxis / Sciences de l'information: théorie, méthode et pratique», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
L’attention portée aux métadonnées est essentielle, car elle renseigne sur les aspects techniques et de contenu des documents. Elle est nécessaire à tout dispositif d’archivage, plus particulièrement à tout système d’archivage électronique pérenne, chargé de garantir l’authenticité, l’intégrité, la fiabilité et l’exploitabilité des données. Il est à remarquer que OAIS ne définit pas la place des métadonnées qui doivent être en fait insérées dans chacun des paquets d’information, respectivement SIP pour Submission Information Package et AIP pour Archival Information Package, et être évaluées comme les documents. Les métadonnées doivent être gérées et consultables par les collaborateurs des Archives au moyen d’outils informatiques.
La numérisation a pris une importance accrue dans les institutions patrimoniales, elle accapare de gros montants financiers et mobilise de nombreuses ressources. L’étude de Théophile Naito se limite à la question des images numériques qui doivent répondre, comme c’est le cas de la Bibliothèque de Genève, à deux exigences: satisfaire la grande majorité des besoins des lecteurs; être durables et permettre une gestion aussi facile que possible. Empruntant son discours aux critères d’évaluation et pouvant s’appuyer sur des connaissances techniques et technologiques très sûres, l’auteur fait le tri parmi les différents formats d’images numériques. Il aborde successivement les éléments d’un format d’image, en particulier les algorithmes de compression (il est question alors de codages et de groupes de compression) et la notion de profil ICC pour la gestion des couleurs; les formats d’images courants; le choix du format d’images en fonction du besoin de numérisation: méthodes existantes et méthode alternative (arbre de décision), organisé autour d’étapes.
L’intérêt de l’étude de Théophile Naito provient justement qu’il propose et explique le recours à la méthode de l’arbre de décision – il illustre celle-ci à l’aide de quelques formats dont les deux dominants: d’un côté, TIFF (sans compression), aujourd’hui le standard de fait; de l’autre, JPEG 2000, de développement plus récent. Le processus doit permettre «un choix raisonnable en fonction du contexte», en ne méconnaissant pas les «contraintes pratiques» et les «contradictions possibles». Ainsi, en mode «compression sans perte», le poids des images JPEG 2000 est environ moitié moins important que celui des images équivalentes sauvegardées dans le respect du format TIFF.
Gabriella Hanke Knaus a jeté son dévolu sur les archives musicales du couvent bénédictin de Mariastein. L’auteure en constate le caractère hybride, l’appartenance davantagee à une collection qu’à un fonds d’archives, puisqu’elles sont formées d’ensembles documentaires d’abbés et de moines, en particulier d’autographes de Mozart réunies par le maître de chapelle Leo Stocklin (1803–1873), de pièces manuscrites et imprimées et qu’elles couvrent une période qui va des œuvres du P. Anton Kiefer (1627–1672) à 2010. L’histoire agitée de l’abbaye de Mariastein explique les aléas de la tradition et de la composition des archives musicales: l’abbaye bénédictine de Beinwil, fondée par des membres de la noblesse locale, vers 1100, fit partie d’abord du diocèse de Bâle dès 1338; elle fut rattachée en 1647/1653 à la congrégation suisse des bénédictins, à la suite du transfert de ses moines à Mariastein (commune soleuroise de Metzerlen). A la suite de l’invasion des troupes françaises, le couvent fut fermé entre 1798 et 1802, ensuite étatisé par le gouvernement soleurois en 1875, ce qui amena l’expulsion de l’abbé et des conventuels dans les régions voisines, avant d’être restitué à la vie religieuse en 1971 par les autorités de Soleure qui avaient abordé la question du retour déjà en 1953. Dans ce contexte, il n’est pas étonnant que les archives, en particulier les parties musicales, eurent à souffrir de dispersion et de pertes. L’expertise de Gabriella Hanke Knaus, restitue et commente l’histoire des archives et des différents catalogues dont le premier remonte à 1816, Catalogus Musici Chori Beinwilensis. De plus, elle s’inspire des enseignements donnés par d’autres catalogues musicaux des établissements de Bregenz et d’Altdorf. Si réorganiser la collection des archives musicales de Mariastein est une évidence, ses critères et exigences sont soigneusement décrits par l’auteure qui centre son expertise sur l’étape de l’évaluation («als Schlüssel zur erfolgreichen Reorganisation») dont les fondements théoriques sont empruntés en particulier aux standards retenus par le Répertoire International des Sources Musicales (RISM). En donnant une grille d’évaluation pour la réorganisation des archives, elle donne une nouvelle chance à la collection de former un ensemble cohérent et d’être une véritable source historique.
Partant de documents courants, domestiques et de la vie quotidienne, autrement dit communs à chacun d’entre nous, Anne Zendali Dimopoulos propose une définition des archives de la mémoire privée, en dessine les contours, la composition et la structure organique, et en fixe l’organisation intellectuelle et matérielle. Elle démontre l’intérêt de ce type d’archives privées qui sont sollicitées de plus en plus par les nouveaux champs d’enquêtes historiques et qui reflètent l’élargissement des domaines de conservation patrimoniale. Elle aborde les questions du statut juridique des archives privées et du droit d’auteur. Elle offre deux instruments de référence utilisés dans la pratique archivistique.
D’une part, la typologie des documents selon un plan de classement en 12 thèmes et qui ont entre autres noms factures, contrats, feuilles de salaire, relevés bancaires. Parfois des actes notariés, mais aussi des cartes postales, des lettres. Ajoutons à cela des courriels, des vidéos et des photographies numériques.
D’autre part, le calendrier de conservation qui recense l’ensemble des natures de la vie privée avec leur durée de conservation, leur support et leur sort final. L’auteure l’appuie sur la législation touchant les archives privées, plusieurs d’entre elles constituant des preuves à l’appui de nos droits.
La lecture de la contribution d’Anne Zendali Dimopoulos fait ressortir à la fois l’inconséquence de la simple accumulation, l’importance des archives personnelles et familiales correspondant à l’âge mémoriel et identitaire de notre époque, comme expression de l’expérience personnelle: «archiver pour agir»; «archiver pour se défendre»; «archiver pour s’enraciner»; «archiver pour témoigner»; «archiver pour s’épanouir». Elle a le mérite d’introduire des principes archivistiques professionnels dans la sphère des archives privées dont ils ont été trop longtemps exclus.
Face aux compressions budgétaires et aux enjeux croissants de la valorisation auprès des utilisateurs et la société en général, les institutions patrimoniales doivent faire preuve d’innovation. Ce n’est pas tout de l’affirmer, il faut encore pouvoir mesurer ce qui se cache derrière ce concept et comment l’introduire et comment ancrer le concept d’innovation dans l’organisation générale de l’institution. Matthias Nepfer parcourt les termes de l’innovation, dans le contexte de la Bibliothèque nationale suisse, en s’intéressant à chacune des étapes et aux contraintes de son développement. Ainsi, qui dit innovation, dit changement, ce qui n’est pas acquis d’entrée de cause: le changement exige légitimation et patience, participation des employés à tous les niveaux. Des conditions stratégiques, culturelles et structurelles doivent être remplies avant de proposer l’innovation qui exige de surmonter des obstacles; le directeur de l’innovation doit pouvoir contrôler les processus et garantir la circulation de l’information auprès des employés qui sont autant de forces de propositions. L’innovation doit débusquer toutes les routines et les inerties qui freinent les changements, encourager le dépôt spontané d’idées et faciliter l’émergence de propositions créatrices. Elle doit courir le risque de tester des formulations novatrices, sans garantie de succès, donner du temps à l’expérimentation, tout en évitant le perfectionnisme et l’utilisation excessive de moyens, et permettre une évaluation proportionnée des services existants et de nouvelles prestations. Il faut à la fois savoir créer et rejeter, construire et déconstruire. Pour y parvenir, Matthias Nepfer commente divers instruments d’innovation: ateliers, brainstorming, animation de groupes, blog, forum sur Intranet, pour lesquels il faut prévoir la mise en place de moyens d’écoute et créer un climat de confiance. Les nouveautés récentes de la Bibliothèque nationale suisse, passées au crible, démontrent leur utilité et leur justesse. Ainsi en font partie la présence sur les médias sociaux tels que Facebook et Twitter, la publication de la recherche du Mois Infos Swiss Desk (SID), marchés ciblés des appareils mobiles pour les employés, l’utilisation gratuite de métadonnées, de l’accès au catalogue mobile, l’ouverture d’un canal de discussion, la mise en place d’un atelier LOD, la participation dans le portail OGD@Bund. Les formulations et les choix en matière d’innovation dans les bibliothèques sont à considérer comme des sources d’inspiration pouvant être reprises, en les adaptant, par d’autres institutions, grandes ou petites. Il y a des solutions à valeur générale et des postures communément admises. Mais, l’auteur, à juste titre, conclut sa contributions avec une mise en garde qui trouve sa résonance dans son examen des politiques innovantes de la Bibliothèque nationale suisse: l’institution propose des exemples d’innovations réussies et abouties, elle fournit à la réflexion des exemples, elle n’est pas nécessairement exemplaire, dans le sens qu’il ne suffit pas de reproduire ses résultats pour obtenir les mêmes résultats: «Nichts davon hat den Charakter eines Rezepts, alles muss auf die Situation der eigenen Institution angepasst und auf die eigenen Anforderungen, Möglichkeiten und Ressourcen abgestimmt werden.»
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Informationswissenschaft: Theorie, Methode und Praxis / Sciences de l'information: théorie, méthode et pratique»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Informationswissenschaft: Theorie, Methode und Praxis / Sciences de l'information: théorie, méthode et pratique» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Informationswissenschaft: Theorie, Methode und Praxis / Sciences de l'information: théorie, méthode et pratique» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.