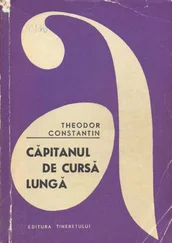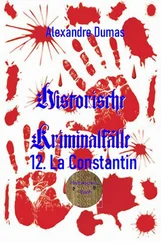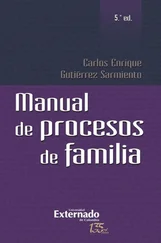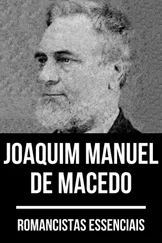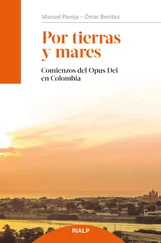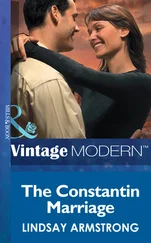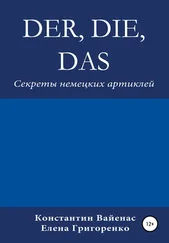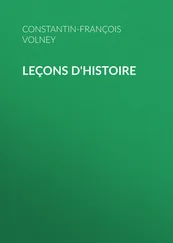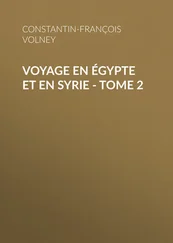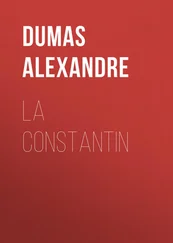Troisièmement, la Suisse est entrée de plein pied dans le régime européen de l’asile en acceptant en 2005 les accords d’association à Schengen et Dublin. Depuis cette date, les modifications de la loi sur l’asile ont été marquées par l’influence grandissante du cadre européen. En 2008, le Parlement a adopté la reprise du code frontières Schengen et ses compléments en vue de la mise en œuvre complète de l’acquis Schengen/Dublin. Dès lors, les développements des acquis Schengen et Dublin ont influencé la législation suisse sur l’asile, la Suisse s’étant engagée à reprendre ces développements. Pour le domaine de l’asile, les développements liés à la mise en œuvre de la Directive retour et la reprise des nouveaux règlements Dublin et Eurodac ont été particulièrement importants.
Ces trois composantes – pression grandissante des initiatives populaires, pression budgétaire et discussion sur la répartition des compétences entre cantons et Confédération, influence du contexte européen – continuent de marquer le développement du droit suisse. En plus d’adaptations ponctuelles, une nouvelle révision significative du droit d’asile se dessine depuis 2009. Cette révision de fond devrait changer durablement le visage de la procédure d’asile en Suisse.
1.2 Restructuration du domaine de l’asile
Entre 2010 et 2012, le Conseil fédéral et le Département de justice et police de la Conseillère fédérale Simonetta Sommaruga ont esquissé les contours d’une restructuration complète du domaine de l’asile. Une partie des modifications proposées ont été déclarées urgentes par le Parlement, puis combattues sans succès par référendum dans une votation populaire (juin 2013). Les mesures urgentes les plus débattues concernaient le droit de déposer une demande d’asile dans une ambassade suisse, le statut accordé aux personnes fuyant une obligation de service militaire, la création d’une base légale pour créer des centres spéciaux pour requérants d’asile récalcitrants et la création d’une base légale pour l’utilisation de bâtiments publics par la Confédération. Ces mesures urgentes ont été intégrées dans la révision générale proposée au Parlement fédéral en 2014. Dans les mesures non-urgentes proposées par le Conseil fédéral et acceptées par le Parlement, il est important de noter l’abandon de la plupart des clauses de non-entrée en matière. Seules les clauses relatives aux requérants dont la protection est assurée dans un Etat tiers,[30] aux cas Dublin ou aux demandes déposées exclusivement à des fins économiques ou médicales ont été maintenues.
La restructuration générale du domaine de l’asile est placée sous le mot d’ordre de l’accélération des procédures. A cette fin, la procédure d’asile sera fondamentalement modifiée en s’inspirant du modèle hollandais. L’idée-clé consiste à traiter rapidement un nombre important de demandes dans des centres rassemblant tous les acteurs de la procédure d’asile. A terme, la majorité des requérants ne seraient ainsi plus attribués à un canton et resteraient durant toute la procédure dans un centre unique. Ce centre rassemblerait l’ensemble des acteurs de la procédure d’asile, à savoir principalement les autorités fédérales du SEM, les services sociaux et les conseillers et représentants juridiques. Depuis janvier 2014, ce projet est testé dans le cadre d’un projet pilote mené à Altstetten (Zurich). Un projet de loi reprenant les éléments principaux de ce projet pilote a été soumis au Parlement fédéral en septembre 2014. Les Chambres fédérales ont adopté le projet, avec quelques modifications, le 25 septembre 2015.
La restructuration adoptée marque un changement fondamental dans la façon de concevoir la procédure d’asile. Elle signifie premièrement une répartition différente des compétences entre les cantons et la Confédération. Comme elle le faisait déjà pour les centres d’enregistrement et de procédure, la Confédération devient responsable des procédures accélérées ayant lieu dans les nouveaux centres. Sur ce nouveau modèle, les cantons qui n’hébergent pas de centres fédéraux ne sont responsables que des demandes qui leur sont transmises après une première phase de sélection, des personnes ayant reçu protection ainsi que des personnes dont l’exécution du renvoi n’est pas prévisible. Cette réforme devrait permettre, à terme, d’accélérer sensiblement la durée des procédures d’une majorité de demandes. De manière cruciale, la nouvelle loi repose sur l’équilibre entre cette accélération des procédures et la garantie d’une offre adéquate et gratuite en termes de conseils et de représentation juridiques. De plus, la qualité des procédures doit être compatible avec les standards de l’Etat de droit et avec les engagements européens et internationaux de la Suisse.
De manière générale, la restructuration complète du domaine de l’asile peut s’appuyer sur de solides appuis, tant au Parlement fédéral qu’auprès des organisations et associations travaillant dans le domaine de l’asile. Tous soulignent la nécessité d’accélérer les procédures d’asile tout en garantissant les standards d’un Etat de droit. Du point de vue de la protection des requérants d’asile, cette accélération ne sera acceptable que si la qualité de la procédure est compatible avec les standards que la Suisse se doit de respecter.
[31]2 Le contexte international
De manière générale, les Etats ont la compétence de déterminer à quels ressortissants étrangers ils veulent accorder un droit de séjour sur leur territoire. Par les choix souverains qu’elle a réalisés, la Suisse s’est toutefois engagée à respecter certains droits et principes du droit international.
Le concept de « juridiction » joue un rôle essentiel à cet égard. En bref, la responsabilité de l’Etat est engagée dès qu’une personne se trouve sous sa juridiction. Dès ce moment, l’Etat porte la responsabilité d’assurer une protection suffisante à cette personne. En plus des droits et principes reconnus dans sa propre Constitution, cette protection comprend l’ensemble des droits conférés par les conventions et traités internationaux que l’Etat en question s’est engagé à respecter.
Dans la plupart des cas, cette question de la juridiction est relativement facile à régler. La présence de la personne sur le territoire de l’Etat coïncide avec la juridiction. Lorsqu’un requérant d’asile se rend à la frontière d’un Etat, il entre sous sa juridiction en déposant une demande d’asile. Toutefois, comme une série de décisions sensibles le prouve, cet aspect peut être difficile à clarifier lorsque l’Etat agit au-delà de ses frontières. Un arrêt de principe de la Cour européenne des droits de l’homme de 2012 traite de la responsabilité de l’Italie lorsqu’elle intercepte des bateaux de migrants en Méditerranée. 3Selon la Cedh, le critère de juridiction était rempli dans ce cas d’espèce. L’Italie était donc responsable d’assurer une protection en adéquation avec ses engagements internationaux, dans ce cas la CEDH. Cette responsabilité n’implique pas de reconnaître automatiquement l’asile à ces requérants, mais elle implique un traitement juste et conforme de leur demande. De manière générale, cette notion de juridiction fait donc apparaître clairement les liens entre souveraineté, responsabilité et respect des engagements internationaux.
Une fois ce critère de juridiction établi, différents engagements internationaux de la Suisse s’appliquent, notamment la Convention de Genève (CR). Cette convention fonde le droit d’asile moderne et la définition du réfugié qu’elle contient fait office d’étalon pour les législations nationales. D’une part, le réfugié reconnu doit être traité sur un pied d’égalité avec les autres ressortissants étrangers présents sur le territoire, voire comme les nationaux, dans de nombreux domaines (travail, logement, soutien). D’autre part, la CR contient une interdiction de refoulement. Les Etats parties s’engagent ainsi à ne pas refouler des personnes vers un pays où elles seraient menacées de persécutions (« interdiction de refoulement du droit des réfugiés »).
Читать дальше