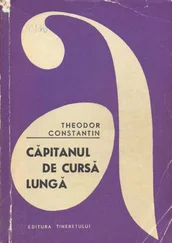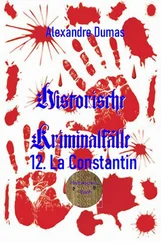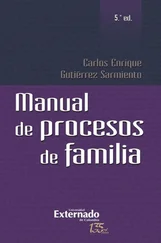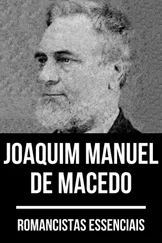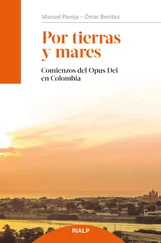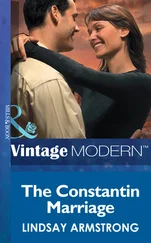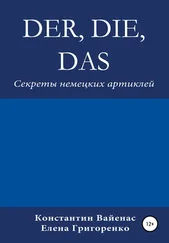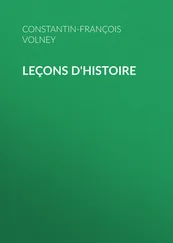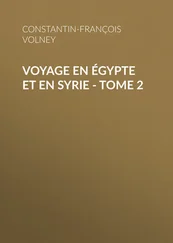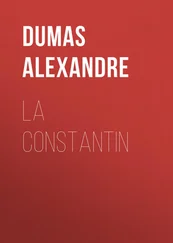Table des illustrations
Les auteurs
[21]Préface de l’éditrice
Le présent manuel de la procédure d’asile et de renvoi est la seconde édition, entièrement revue, du manuel rédigé par Ruedi Illes, Nina Schrepfer et Jürg Schertenleib. La première édition de l’ouvrage, parue aux éditions Haupt en 2009, avait revisité en profondeur le manuel de référence de Mario Gattiker sur la procédure d’asile et de renvoi paru dans sa 3 èmeédition en 1999. Depuis 2009, les bases du droit d’asile ont subi d’importantes modifications dans plusieurs domaines, tant dans le contexte européen que suisse, de sorte qu’une révision du manuel s’imposait depuis longtemps.
Le but du manuel n’a cependant pas changé : les représentant-e-s des œuvres d’entraide, les étudiant-e-s, les mandataires juridiques des requérant-e-s d’asile et des réfugié-e-s ainsi que toutes les personnes intéressées par les questions relevant du droit d’asile devraient y obtenir un aperçu rapide de la situation juridique actuelle et trouver facilement des informations précises sur les bases légales, la jurisprudence et la pratique en vigueur.
La structure du manuel s’apparente à celle de la première édition. Les fondements de la procédure d’asile et de renvoi et son déroulement y sont décrits, de même que leurs implications pour les personnes concernées. Le manuel ne se limite donc pas simplement aux procédures de reconnaissance de la qualité de réfugié, d’octroi de l’asile et d’examen des obstacles à l’exécution du renvoi ; il traite également des nouveaux développements politiques et juridiques et expose certaines constellations spécifiques au droit d’asile qui sont présentées de manière aussi complète que possible dans un cadre clair et concis. Il est tenu compte de la jurisprudence jusqu’à juin 2015. Dans la version française, nous avons renoncé, pour des motifs de simplification du texte, à l’usage du langage épicène. Nous avons privilégié la forme masculine du fait que la grande majorité des requérants d’asile arrivés en Suisse sont des hommes, à l’inverse des réfugiés à l’échelle mondiale majoritairement représentés par les femmes. La forme masculine inclut ici implicitement l’ensemble des personnes concernées, hommes et femmes confondus.
Nous remercions Ruedi Illes, Nina Schrepfer et Jürg Schertenleib qui ont rendu possible la parution de cette seconde édition en acceptant le remaniement de leur ouvrage de 2009. Nous tenons aussi à remercier le Secrétariat d’Etat aux migrations, qui a soutenu la publication de cette édition avec une généreuse contribution. L’OSAR remercie tout particulièrement les auteur-e-s de la nouvelle édition[22] et spécialement les auteures externes Susanne Bolz, Nula Frei, Teresia Gordzielik, Olivia Le Fort Mastrota et Stephanie Motz qui ont fait preuve d’un grand engagement et d’une précieuse expertise dans la rédaction de l’ouvrage. Nous remercions également Olivier von Allmen, avocat indépendant à la Chaux-de-Fonds, pour la traduction des textes allemands vers le français. Pour leur aide inestimable dans le cadre de la finalisation de l’ouvrage, nous remercions chaleureusement Maria Keller, Anne Kneer, Christelle Maire, Bojana Milicevic, Jonathan Thévoz, Djouna Vodoz et particulièrement Jean Perrenoud. Merci aussi aux collaboratrices et colborateurs de l’OSAR, en particulier Sarah Frehner, Seraina Nufer, Johan Rochel, Adrian Schuster et Christoph Hess pour le soutien multiple et varié apporté dans le cadre de la préparation, de la réalisation technique et juridique et de la finalisation de l’ouvrage. Nous adressons aussi nos sincères remerciements aux éditions Haupt pour être toujours restées à l’écoute et pour la collaboration empreinte de confiance dans le cadre de la publication du manuel.
Pour l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés,
Adriana Romer
Marie Khammas
Constantin Hruschka
Richard Greiner
Michael Pfeiffer
Berne, octobre 2015
I Introduction
[23]Le développement du droit d’asile en Suisse et en Europe est actuellement au cœur de l’attention politique et sociétale. Loin de se limiter au Parlement fédéral, les questions d’asile sont également âprement débattues dans le domaine public. Dans les cantons et les communes du pays, l’asile passionne et donne naissance à d’importants débats de société.
Ces débats ne reflètent pas seulement la sensibilité des thèmes liés à l’asile, mais indiquent également la pertinence des échanges sur l’identité suisse et la façon dont le pays voit son rôle dans un monde en changement permanent. Par les questions qu’il soulève et les défis qu’il provoque, l’asile renvoie le pays à l’importance de sa « tradition humanitaire ». Alors que l’histoire et la perception d’elle-même que la Suisse aime entretenir sont marquées par cette ambition humanitaire – notamment l’accueil des Huguenots à Genève aux 16 èmeet 17 èmesiècles – la législation actuelle trouve sa source au lendemain de la Seconde Guerre mondiale.
La politique suisse en matière de réfugiés durant ce conflit a souvent été critiquée parce qu’elle était dominée par une attitude générale de rejet. Pour de nombreux observateurs, le renvoi à la frontière des personnes cherchant protection et le statut juridique des réfugiés admis, pour la plupart, seulement de manière provisoire marquent un chapitre sombre de l’histoire contemporaine suisse. L’adhésion de la Suisse en 1955 à la Convention des Nations Unies de 1951 relative au statut des réfugiés 1est marquée par ce contexte.
En 1957, le Conseil fédéral considère l’octroi de l’asile comme une maxime de politique fédérale : « Le droit d’asile n’est pas une simple tradition de la Suisse. Il est un principe politique et une manifestation de la conception suisse de la liberté et de l’indépendance. […] L’histoire des réfugiés pendant la dernière guerre mondiale nous apprend que la Suisse devrait accueillir dans la mesure de ses possibilités les fugitifs étrangers, c’est-à-dire les hommes qui cherchent asile sur son sol parce que leur vie et leur intégrité corporelle sont sérieusement menacées. Elle nous montre aussi que les autorités ne devraient en principe pas fixer de chiffre maximum pour l’accueil de ces personnes. […] Notre pays ayant le devoir de pratiquer l’asile d’une manière conforme à sa tradition, il y a lieu d’envisager un large accueil des réfugiés [24][en allemand : « eine freie, weitherzige Aufnahme von Flüchtlingen »]. » 2L’accueil des personnes persécutées compte ainsi comme tâche essentielle de la collectivité et marque une ligne de conduite pour l’activité de l’Etat et pour le législateur.
Jusqu’au début des années quatre-vingts, la politique suisse d’asile a été marquée par l’admission de groupes de réfugiés persécutés à la suite de troubles politiques, de guerres et de guerres civiles, comme en Hongrie (1956), au Tibet (1962), en Tchécoslovaquie (1968), au Chili (1973), en Indochine (1975) et en Pologne (1982). Les réfugiés étaient d’habitude admis collectivement sans examen individuel comparable à la procédure d’asile actuelle. En règle générale, le pays accueillait les personnes qui pouvaient prouver leur appartenance au groupe que le Conseil fédéral avait décidé d’admettre en Suisse. Parallèlement, l’immigration des travailleurs étrangers fut débattue de manière extrêmement controversée depuis la fin des années soixante. Le discours public a été fortement marqué par l’initiative dite « Schwarzenbach », refusée à 54 % en 1970. 3A l’époque, l’admission des réfugiés se basait sur quelques normes du droit général des étrangers (loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers – LSEE, et ordonnances relatives à cette loi) et sur des circulaires. Ce n’est qu’en 1979 que le législateur a édicté une première loi sur l’asile, entrée en vigueur le 1 erjanvier 1981.
Читать дальше