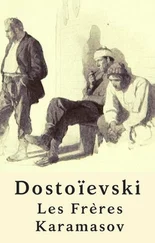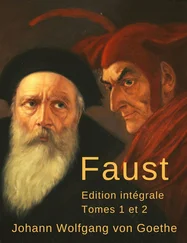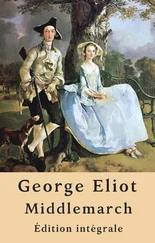« C’est une femme mondaine et sans foi, disait M. Crawley ; elle vit avec les athées et les Français. Je frémis de penser à cette terrible situation. Si près de la tombe donner autant à la vanité, au dérèglement, à des goûts profanes et insensés ! »
En réalité, la vieille dame se refusait complétement à écouter ses lectures du soir, et, lorsqu’elle venait à Crawley-la-Reine, il était obligé de suspendre le cours de ses pratiques religieuses.
« Mettez de côté votre livre de sermons, disait son père, car miss Crawley va nous arriver. Elle nous a écrit pour nous dire qu’elle ne pouvait entendre prêcher.
– Eh ! monsieur, songez aux domestiques.
– Que les domestiques aillent au diable, disait sir Pitt, et le fils trouvait qu’il leur arriverait pis encore s’ils étaient privés du bienfait de ses instructions.
– Et que diable ! disait le père après avoir écouté ses remontrances, vous ne serez pas assez sot pour laisser sortir de la famille trois mille livres de revenu ?
– Qu’est-ce que l’argent en comparaison de nos âmes ? reprenait Crawley. Croyez-vous donc que la vieille veuille vous dépouiller de cet argent ? »
Qui sait si ce n’était pas le désir de sir Crawley ?
La vieille miss Crawley était bien certainement une réprouvée. Elle avait une délicieuse petite habitation dans Park-Lane, et, comme elle buvait et mangeait trop pendant son hiver à Londres, elle allait se remettre l’été à Harrowgate ou à Cheltenham. De toutes les vieilles vestales de l’époque, c’était la plus hospitalière et la plus enjouée. Dans son jeune temps elle avait été une beauté, à ce qu’elle disait : on sait fort bien que les vieilles femmes ont toutes été plus ou moins des beautés dans leur temps.
Elle avait de plus des prétentions au bel esprit et au libéralisme. Pendant un séjour de quelque temps en France, Saint-Just, suivant la rumeur publique, lui avait inspiré une passion malheureuse. Elle aimait en conséquence les romans français, la pâtisserie française et les vins français. Elle lisait Voltaire et savait Rousseau par cœur. Elle discutait d’un ton assez dégagé la question du divorce, et défendait avec énergie les droits de la femme. Elle avait des portraits de Fox dans toutes les chambres de sa maison. Lorsque cet homme d’État comptait dans les rangs de l’opposition, elle combattait à ses côtés au pied du même drapeau ; et quand il arriva au pouvoir, elle était en grand crédit auprès de lui, pour avoir enrôlé dans ses rangs sir Pitt et son collègue de Crawley-la-Reine. Sir Pitt y serait bien entré de lui-même, sans la moindre peine de la part de cette honnête demoiselle.
Cette excellente et vieille fille avait pris en affection Rawdon Crawley dès son enfance. Elle l’envoya à Cambridge, parce que son frère était à Oxford ; et, lorsque les directeurs de la première université l’engagèrent à se retirer après deux ans de séjour, elle lui acheta ses brevets de cornette et de lieutenant.
Le jeune officier était à la ville un des plus élégants et des plus renommés dandys. Il boxait, courait les coulisses, jouait la bouillotte et conduisait à quatre chevaux ; tel était le fond de la science pour notre aristocratie d’alors, et il y était passé maître. Bien qu’il fît partie de la maison militaire, dont le service se bornait à parader autour du prince régent, et pour laquelle l’occasion ne s’était jamais présentée de montrer sa valeur sur le champ de bataille, Rawdon Crawley, pour des affaires de jeu, sa plus violente passion, avait eu trois duels terribles où il avait assez donné de preuves de son mépris pour la mort.
« Et pour ce qui suit la mort, » ajoutait M. Crawley, attachant au plafond ses yeux couleur groseille.
Il pensait toujours à l’âme de son frère et à l’âme de ceux qui ne partageaient pas ses opinions. C’est une sorte de consolation que se donnent à elles-mêmes les personnes pleines de gravité.
La ridicule et romanesque miss Crawley, loin de se fâcher des étourderies de son Benjamin, ne manquait pas de payer ses dettes, après ses duels, et n’aurait pas permis une parole de blâme sur sa moralité.
« Il jette sa gourme, disait-elle, et vaut cent fois mieux que son pleurnicheur de frère avec ses hypocrisies. »
CHAPITRE XI.
D’une simplicité toute pastorale.
Après avoir introduit le lecteur au milieu de ce respectable personnel du château, dont la simplicité et l’innocence toute champêtre montrent victorieusement la supériorité de la vie de la campagne sur celle de la ville, nous devons aussi lui faire connaître les parents et voisins du seigneur de l’endroit : le ministre Bute Crawley et son épouse.
Le révérend père Bute Crawley était d’une taille élevée et majestueuse, d’une humeur joviale, et portait des chapeaux à large bord. Dans le comté, il jouissait d’une popularité bien plus grande que le baronnet son frère. Au collége, il était la meilleure rame de l’embarcation de Christ-Church ; il avait cassé des dents aux meilleurs boxeurs de la ville. Dans la vie privée, il n’avait pu se détacher entièrement de ses goûts pour la boxe et les exercices gymnastiques. Point de combat, à vingt milles à la ronde, auquel il ne fût un des premiers ; pas de courses de régates, de soirées d’élections, de dîners de confrères, pas de grand gala enfin dans le comté, sans qu’il fût de la partie. On était sûr de rencontrer sa jument noire et les lanternes de son cabriolet à six milles de la cure, toutes les fois qu’il y avait un dîner à Fuddleston, à Roxby, ou à Wapshot-Hall, ou chez les gros bonnets du comté, avec lesquels il était dans les meilleurs termes. Il avait une jolie voix, chantait le Vent du midi et le Ciel nuageux , courait le cerf en casaque de jockey, et passait pour l’un des meilleurs pêcheurs du comté.
Mistress Crawley, la femme du recteur, était une petite créature fort remuante, qui composait les célestes homélies de son époux. Ménagère par excellence, elle avait avec ses filles la haute main dans la maison. Au presbytère elle régnait en despote, laissant pour tout le reste carte blanche à son mari ; il pouvait aller et venir, dîner dehors autant que son caprice le lui disait. Quant à mistress Crawley, c’était la femme économe qui sait le prix du vin de Porto.
Depuis l’enlèvement du jeune ministre de Crawley-la-Reine par mistress Bute (elle appartenait à une bonne famille ; elle était fille de feu le lieutenant-colonel Hector Mac Tavich, avait joué Bute contre sa mère, et avait gagné la partie), cette dame était dans toute sa vie un modèle de sagesse et d’économie ; mais, malgré tous ses efforts, son mari restait toujours avec des dettes. Il lui avait fallu dix ans pour acquitter ses notes de collége, qui remontaient au vivant de son père. En 179., comme il venait de se mettre à jour de son arriéré, il paria de grosses sommes contre Kangourou , qui gagna le prix aux courses de Derby. Le ministre, obligé d’emprunter à de ruineux intérêts, s’était toujours trouvé gêné depuis. Sa sœur, de temps à autre, lui donnait bien une centaine de livres sterling, mais c’était sur sa mort qu’il fondait ses plus belles espérances.
« Il faudra bien que le diable s’en mêle, disait-il, ou Mathilde me laissera au moins la moitié de son argent. »
Le baronnet et son frère avaient donc les meilleures raisons du monde pour être tous deux comme chien et chat ; sir Pitt avait toujours tondu sur Bute dans les transactions de famille ; le jeune Pitt, qui n’avait pas même le mérite d’aimer la chasse, s’était avisé d’élever une chapelle à la barbe de son oncle, enfin Rawdon devait venir en partage dans la succession de miss Crawley. Ces affaires d’argent, ces spéculations sur la vie et la mort inspiraient aux deux frères, l’un pour l’autre, une de ces tendresses comme on en voit dans la Foire aux Vanités. Pour ma part, je ne connais rien comme un billet de banque pour troubler et rompre entre deux frères une affection d’un demi-siècle, et je ne puis me lasser de penser que c’est une belle et admirable chose que l’affection entre gens du monde !
Читать дальше