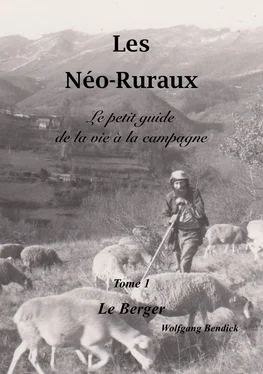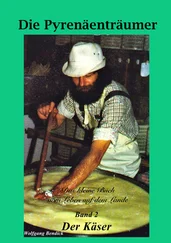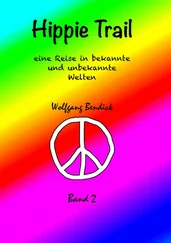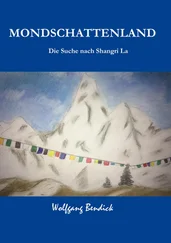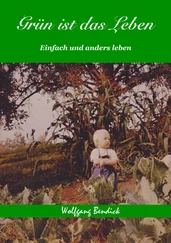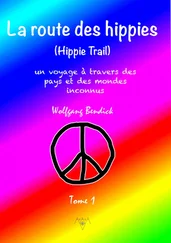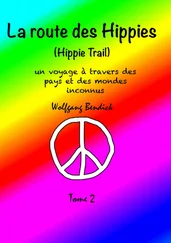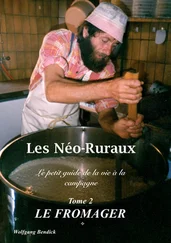Nous traversâmes un petit village. « Regarde, là ! », s’écria Ludwig. « La boulangerie ? », rétorquai-je d’un air interrogateur. « J’ai passé la nuit du nouvel an précisément dans cette vitrine, ou plutôt sur son rebord ! » « Ce n’était pas vraiment le meilleur endroit ! » répondis-je. « Si, parce que de la grille qui se trouvait au sol juste devant, émanait de l’air chaud, sans doute parce qu’elle se trouvait au-dessus des fourneaux. » « Je peux m’imaginer quelque chose de mieux ! Tu revenais d’une fête, ou alors pourquoi... ? » « Non ! La fête battait son plein à la maison, et j’ai eu envie de boire un expresso à Paris, vite fait. Tu te souviens, nous y étions tous allés à l’époque, avec ton premier combi VW... Et du coup je me suis posté au bord de la route et j’ai tendu le pouce. À deux heures du matin j’étais ici. Et puis plus rien ! Lorsque la boulangerie a ouvert, j’ai acheté un petit pain chaud et je me suis posté de l’autre côté de la route ! »
À Huningue, nous sommes passés au-dessus du Rhin et voulûmes passer la frontière. Il y avait un gros chantier. Apparemment le poste de frontière était en train d’être modernisé pour la circulation des poids lourds. À force de panneaux de déviation et du brouillard, nous avions sûrement dû rater la douane et vîmes soudain le premier panneau d’une localité française au bord de la route. « Appuie sur le champignon et continue ! », suggéra Ludwig. « Évidemment ! Ça nous a évité des ennuis ! », acquiesçai-je.
Au bout de deux jours, nous arrivâmes au camping où nous attendait notre caravane. « Achetez, achetez ! », ainsi nous accueillit le propriétaire, « Le franc français a chuté, le mark allemand a pris de la valeur ! » Avait-il oublié que nous avions déjà acheté il y a deux semaines ? Nous nous procurâmes quelques bouteilles de vin rouge, du fromage et des baguettes et célébrâmes notre arrivée en France. Tôt le lendemain matin, nous nous rendîmes dans le village près duquel se trouvait notre ferme. J’étais impatient de pouvoir poser les pieds sur nos propres terres ! D’abord nous nous arrêtâmes à la maison où nous avions déposé nos affaires. Mais le cadenas n’était plus là et on pouvait entrer sans clé. Malgré la semi-obscurité, je remarquai que quelqu'un avait tout inspecté. J’espérais que personne ne s’était servi ! Nous voulions refermer la porte lorsqu'un jeune un peu rondouillard apparut devant nous. Il avait une tête ronde et les cheveux ébouriffés et fumait une cigarette avec ce tabac gris et puant, le ‘Caporal’, que tous les bergers semblaient fumer ici ! Il nous sourit et grommela des mots incompréhensibles. Personne ne savait donc parler français ici ? Si ! Lorsqu’il s’aperçut que nous ne comprenions pas, il répéta, de façon un peu plus claire : « Un sacré bazar, ce que vous avez là-dedans ! » Qu’entendait-il par ‘bazar’, peut-être les affaires que nous avions déposées ici ? Il avait donc été là-dedans ! Et l’ancien propriétaire de notre ferme à qui appartenait cette maison visiblement aussi, car c’est lui qui en avait la clé. Il valait mieux ne plus rien laisser ici et monter sans attendre tout ce que nous avions apporté avec nous jusqu’à la maison.
Nous avons laissé le type sur place et nous nous sommes mis en route. Le chemin ne s’était pas amélioré et Ludwig dût monter sur la barre de la remorque pour mettre du poids sur l’essieu arrière afin de parvenir à monter. Au croisement qui servait également à faire demi-tour, se trouvait évidemment déjà Fernand, le voisin, en bleu de travail. Il approchait les 80 ans. Est-ce qu’il se postait toujours ici ou bien avait-il déjà entendu nos roues patiner de loin lorsque nous montions la côte ? Il me salua comme une vieille connaissance. Ensemble, nous allâmes jusqu’au roncier à travers duquel nous traçâmes un sentier avec nos pieds pour accéder à la maison. Nous remarquâmes qu’une piste carrossable menait jusqu’ici, et même encore un peu plus loin. Je ne l’avais pas remarquée auparavant, certainement à cause de toutes les broussailles ! Il y avait même un endroit un peu plus large où nous pûmes ranger la remorque.
D’abord nous allâmes chercher une faux et un croissant de notre chargement pour couper les ronces les plus épaisses. À notre étonnement, nous trouvâmes sous les ronces un chemin creusé et pioché dans la pente, comme une rampe, qui menait au pré se trouvant sous la maison. Vers midi nous avions fauché un passage à travers les ronces sèches vieilles de plusieurs années. Nous étions sacrément crevés ! Mais au moins on y voyait plus clair maintenant ! Il y avait une bande d’accès d’environ 1,50 mètre de large pour accéder au pré. Le voisin qui ne nous avait pas lâchés d’une semelle pendant un bon moment, m’avait expliqué que l’ancien propriétaire y était une fois monté avec un petit tracteur tout-terrain, mais avait failli se renverser. Cette rampe nous semblait parfaite pour notre système de treuil-chariot.
Nous nous mîmes à monter vers la maison. « La baraque n’a pas l’air en aussi piteux état que tu me l’avais dit. Je m’étais imaginé une ruine, et ça c’est plutôt un château fort ! », me dit Ludwig. D’ici, le bâtiment avait l’air imposant avec sa face avant d’environ 25 mètres de long. « Attends d’être dedans ! », répondis-je. Plus nous nous approchions, plus on voyait que la dégradation était déjà bien avancée. Mais depuis notre première visite, rien n’avait changé. Nous dûmes enfoncer la porte avec force pour accéder à la cave. Cela était certainement lié au fait que les poutres qui formaient l’encadrement s’étaient légèrement affaissées au contact de l’humidité. En enlevant deux centimètres du bas de la porte à la tronçonneuse, on pourrait de nouveau l’ouvrir et la fermer correctement. En tout cas il faudrait en mettre une avec des vitres car au rez-de-chaussée, les fenêtres étaient minuscules. Un souffle froid nous frôla, légèrement rance, mais qui sentait surtout la suie. Après avoir jeté un coup d'œil à l’intérieur, nous nous assîmes contre le mur de pierres réchauffé par le soleil et cassâmes la croûte.
Au lieu de faire une sieste, nous redescendîmes et détachâmes notre chargement. En premier, nous descendîmes la motofaucheuse de la remorque et l’allumâmes. Nous nous servîmes ensuite du pied de biche pour pousser le cadre en V du treuil avec tout l’équipement en bas de la remorque et l’attachâmes derrière la motofaucheuse avec des cordes. L’idée était de tracter le treuil en haut de la côte grâce à la faucheuse. Mais celui-ci était certainement aussi lourd que la motofaucheuse ! Les roues de la faucheuse tournaient dans le vide, sautaient sur place et commençaient doucement à s’enfoncer dans la terre. Nous disposions sur la remorque d’un essieu supplémentaire de récupération pour le chariot. Je l’avais gardé parce que j’étais persuadé qu’il servirait un jour. Et ce jour était arrivé ! Nous le fixâmes sous le cadre du treuil. Ainsi, seul l’arrière de ce dernier traînait encore sur le sol. Alors que j’appuyais de toutes mes forces sur les longerons de la motofaucheuse, Ludwig faisait levier avec une grande branche pour faire avancer l’arrière du treuil. C’est comme ça que nous entamâmes la montée de la côte, 10 centimètres par 10 centimètres. La première partie, la plus raide, était la plus difficile. Une fois celle-ci franchie et la maison en vue, nous nous écroulâmes d’abord dans l’herbe. Nous y restâmes allongés un moment, en haletant.
Ensuite, nous nous mîmes à remonter la côte, étape par étape. Le moteur sentait l’huile chaude, nous dégoulinions de sueur et étions à bout de souffle. Mais il nous fallait monter ces pièces, sinon il nous serait impossible de transporter quoi que ce soit car il n’y avait aucun accès pour un véhicule. Heureusement ! Car sinon le bien aurait coûté le double et il aurait été vendu à de riches Allemands travaillant chez Airbus à Toulouse, comme résidence secondaire. Deux heures plus tard, nous avions réussi ! Le treuil se trouvait dans la cour, nous éteignîmes le moteur et nous affalâmes par terre. Nous étions à bout. Aucun de nous n’avait jamais réalisé une telle épreuve de force auparavant ! Notre tête vrombissait, notre cœur battait comme un compacteur dans notre poitrine, l’air sifflait en entrant et sortant de notre gorge endolorie. Notre bouche était pâteuse et nous y ressentions un goût amer. Nous étions trempés de sueur. Nous restâmes allongés là sans dire un mot, épuisés, pendant dix bonnes minutes. Mais le corps est un bon esclave ! Après un quart d’heure, il se soumit de nouveau, fidèle, à notre volonté et se redressa.
Читать дальше