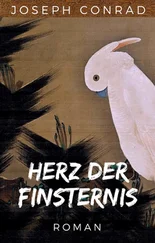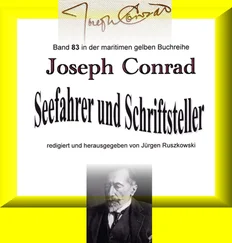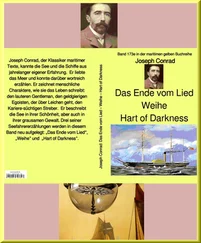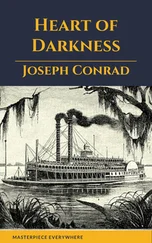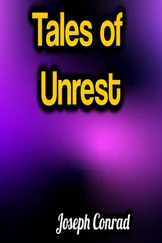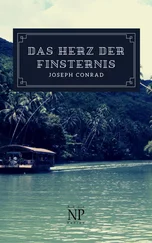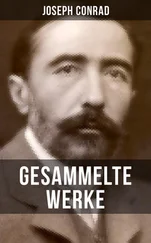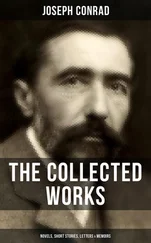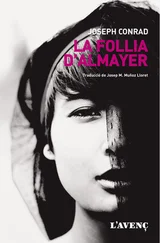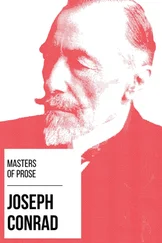[92]En anglais: dropped an anchor under foot . L’intention est de s’amarrer momentanément, sur une seule ancre et de façon précaire.
[93]Les cargues sont les cordages servant à retrousser les voiles sur elles-mêmes.
[94]Déborder: s’éloigner du flanc du navire.
[95]Le texte dit near six bells in the first watch («près de six coups de cloche du premier quart»); à bord d’un navire, on sonne l’heure en frappant la cloche avec son battant d’autant de coups qu’il s’est écoulé de demi-heures depuis le début du quart (période de service pour une équipe).
[96]Dans la marine de guerre, sous-officier chargé particulièrement de faire exécuter les ordres relatifs à la police du bord et de veiller sur les armes portatives.
[97]Levier en bois de chêne dont l’extrémité peut être garnie d’une armature de fer.
[98]Instrument en fer pour harponner les poissons. Il s’appelle en anglais fish-gig ou fishing spear . Conrad emploie en fait fish-grains , qui ne semble pas exister.
[99]Ouverture à peu près carrée pratiquée dans les ponts pour établir la communication entre eux.
[100]Agir avec les avirons d’une embarcation de manière à la faire marcher par l’arrière.
[101]Placer ou tenir debout, en situation à peu près verticale.
[102]À plusieurs reprises, Conrad décrit Réal comme un pédant. Dans une lettre à son ami Garnett écrite le 24 décembre 1923, il parlait encore de ce personnage comme «l’enfant de la Révolution […] avec son tour d’esprit et de conscience austère et pédant» ( Letters from Conrad . 1895-1924, Londres, 1928, p. 298-299). Réal n’est pourtant pas enclin à faire étalage de son savoir. On est tenté de se demander si Conrad n’a pas confondu pédant et pointilleux, ou pédantisme et puritanisme.
[103]La tentation suicidaire se rencontre souvent dans les romans de Conrad, qui avait lui-même attenté à ses jours à Marseille en février 1878.
[104]Allusion évidente à Pygmalion, dont le nom était particulièrement familier en Angleterre depuis que Bernard Shaw avait fait représenter et publier une brillante pièce sous ce titre en 1912.
[105]Les disposer pour ramer ou nager, de manière que les hommes n’aient qu’à agir dessus, quand ils en recevront l’ordre.
[106]Dans le texte, on trouve ici un deuxième emploi de l’adverbe pedantically (voir note n. 103).
[107]Un navire dont les vergues sont brassées c’est-à-dire orientées n’importe comment est désemparé.
[108]La ralingue étant un cordage cousu en renfort sur le côté d’une voile, une voile est en ralingue quand elle est disposée de manière que le vent la frappe dans la direction de sa ralingue de chute qui est au vent, c’est-à-dire de manière que la voile ne soit ni pleine ni coiffée et n’ait aucune influence sur la marche du navire.
[109]L’idée que la vie est un songe a été exprimée à maintes reprises par des poètes comme Shelley, Poe, Longfellow, Browning, sans parler de Shakespeare, tous plus conscients et cultivés que Peyrol.
[110]La Petite Passe sépare la presqu’île de Giens de l’île de Porquerolles. Le cap Blanc, au sud du cap Bénat, se trouve à l’extrême est de la rade d’Hyères.
[111]Étance grossière et forte; une étance est une sorte d’épontille en bois sommairement équarri qu’on place sous le pont pour le soutenir à des endroits où il risquerait de fléchir.
[112]Cordage destiné à tendre le bord inférieur d’une voile.
[113]Bien que l’anglais emploie pour désigner cette manoeuvre l’expression to masthead the yards , il est évident que les vergues ne sont pas toutes en tête de mât.
[114]Carguer une voile, c’est en retrousser les angles inférieurs (en agissant sur les cordages nommés cargue-joints) pour la soustraire en partie à l’action du vent.
[115]Lieu où étaient les bureaux du major de la Marine, officier qui présidait à l’établissement de la garde dans l’Arsenal.
[116]Déhaler, c’est haler en dehors (généralement, tirer d’une position fâcheuse). Se déhaler, c’est se sortir d’une situation d’immobilité, telle qu’un échouement.
[117]Embraquer (ou abraquer) un cordage, c’est haler dessus pour le tendre ou en faire disparaître le mou.
[118]Éviter (sur son ancre), c’est pour un navire au mouillage changer de direction sous l’action du vent ou d’un courant.
[119]Changea de direction pour gonfler ses voiles et prendre de la vitesse.
[120]Un hunier est une voile carrée fixée à la vergue d’un mât de hune (surmontant un bas mât).
[121]Un chouquet est un billot quadrangulaire en bois, cerclé de fer et solidement fixé au tenon du sommet d’un mât.
[122]Gradé choisi parmi les matelots de 1re classe et exerçant, sous les ordres des officiers, une autorité directe sur les hommes de l’équipage.
[123]Avait arrêté le navire en orientant les voiles de façon qu’elles ne prennent plus le vent.
[124]Voiles triangulaires.
[125]Éventer, ou faire servir, c’est manoeuvrer un navire pour lui faire quitter la panne, en sorte qu’il fasse route.
[126]La hanche est la partie d’un navire comprise entre les porte-haubans d’artimon et la poupe.
[127]Le texte dit: under all plain sail , ce qui désigne toutes les voiles établies normalement par temps ordinaire, sans prendre de dispositions particulières pour forcer l’allure.
[128]Longues manoeuvres dormantes (cordages fixes) servant à assujettir, par le travers et vers l’arrière, les mâts supérieurs.
[129]Adopter l’allure du plus près, c’est-à-dire la direction de sa route approchant de celle du vent.
[130]Le mot anglais malicious employé dans le texte signifie généralement «méchant» ou «hostile». Conrad semble lui donner ici plutôt le sens du français «malicieux» (malin, taquin, railleur).
[131]Choquer, c’est relâcher progressivement la tension d’un cordage ou d’un câble.
[132]Gouvernait près du vent.
[133]Morceau de bois dur ou de métal portant deux cornes et fixé en divers endroits du navire pour y tourner des cordages.
[134]Placer la barre du gouvernail du côté sous le vent.
[135]Partie comprise entre les gaillards d’avant et d’arrière; milieu d’un navire.
[136]Solide montant vertical destiné à supporter l’effort des câbles d’amarrage ou de mouillage.
[137]Nom donné par abréviation au bout-dehors de foc (un foc est une sorte de voile triangulaire ou latine établie sur une draille (cordage) tendue entre les mâts de beaupré et de misaine).
[138]En anglais, de façon expressive, seatop («haut de mer»); cette crête est arrachée par le vent.
[139]Le mot, laissé en anglais à cause du contexte, pourrait se traduire par «Droit(e) la barre!», ordre visant à obtenir que la barre ne se trouve ni d’un côté ni de l’autre du navire, mais au milieu, dans le sens de la quille du bâtiment.
[140]Fermez l’angle que forme cette voile par rapport à l’axe longitudinal du navire.
[141]Un navire de ce nom faisait effectivement partie de la flotte britannique au large de Toulon.
[142]Le commandant du Superb s’appelait Sir Richard Goodwin Keats (1751-1834); il s’était distingué pendant la guerre contre la France de 1793 à 1801 et fut nommé amiral en 1825.
[143]Les amures sont des cordages destinés à fixer le point inférieur (d’une basse voile) qui se trouve au vent. Changer d’amures, c’est virer de bord pour recevoir le vent du côté du navire qui, auparavant, était sous le vent.
[144]Nom historique du célèbre navire amiral de Nelson, cinquième et dernier du nom dans la marine britannique, lancé en 1765, achevé en 1778. C’est à bord du Victory que Nelson mourut à Trafalgar, en 1805, et c’est le Victory qui rapporta sa dépouille à Londres.
Читать дальше