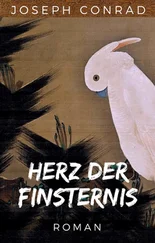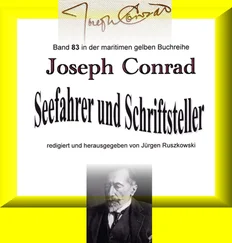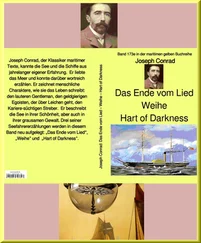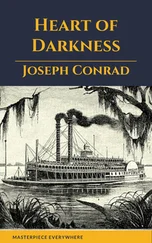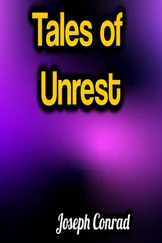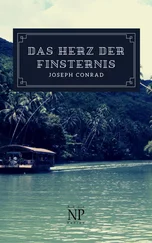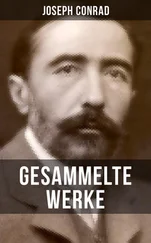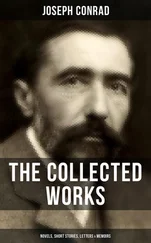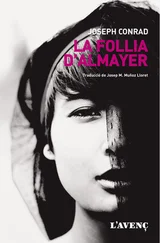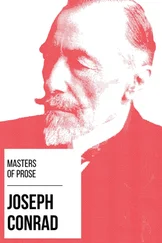La veille du jour où les deux femmes devaient retourner à Escampobar, Catherine, dans l’église de Sainte-Marie-Majeure [154], aborda un prêtre, un petit homme rond et mal rasé à l’œil larmoyant, pour lui demander de dire des messes pour les morts.
«Mais pour l’âme de qui devons-nous prier?» murmura le prêtre sur un ton bas et poussif.
«Priez pour l’âme de Jean, dit Catherine. Oui. Jean. Il n’y a pas d’autre nom.»
Le lieutenant Réal, blessé à Trafalgar, mais ayant réussi à n’être pas fait prisonnier, se retira avec le rang de capitaine de frégate et disparut aux yeux du monde naval de Toulon et même du monde tout court. Le signe, quel qu’il fût, qui l’avait ramené à Escampobar au cours de la nuit décisive, ne devait pas l’appeler à la mort, mais à une vie paisible et retirée, obscure à certains égards, mais non pas dénuée de dignité. Quelques années plus tard, Réal fut nommé maire de la commune par les gens de ce même petit village qui avait si longtemps considéré Escampobar comme un foyer d’iniquité, un repaire de buveurs de sang et de femmes perverties.
Un des premiers événements qui vinrent rompre la monotonie de la vie d’Escampobar fut la découverte d’un obstacle volumineux au fond du puits, une année de sécheresse où l’eau faillit manquer. Après avoir eu beaucoup de mal à l’en retirer, on s’aperçut que l’obstruction était causée par un vêtement fait de toile à voile, qui avait des emmanchures et trois boutons de corne devant, et qui avait l’air d’un gilet; mais il était doublé, positivement piqué, d’une quantité surprenante de pièces d’or, d’ages, de valeurs et de nationalités différents. Nul autre que Peyrol ne pouvait l’avoir jeté là. Catherine put donner la date exacte du jour où la chose avait été faite, car elle se rappela avoir vu Peyrol près du puits le matin même du jour où il était parti en mer avec Michel en emmenant Scevola. Le capitaine Réal devina aisément l’origine de ce trésor et il décida, avec l’approbation de sa femme, d’en faire remise au gouvernement comme étant le magot d’un homme mort intestat, sans parents connus et dont le nom même était resté incertain, y compris à ses propres yeux. Après cet événement, ce nom incertain de Peyrol revint de plus en plus souvent sur les lèvres de Monsieur et Madame Réal, qui ne l’avaient jusqu’alors prononcé que rarement, bien que le souvenir de sa tête blanche, de sa placide et irrésistible personnalité, eût continué à hanter le moindre coin des champs d’Escampobar. À partir de ce moment ils parlèrent ouvertement de lui, comme si, de nouveau, il était revenu habiter avec eux.
Bien des années plus tard, par une belle soirée, Monsieur et Madame Réal, assis sur le banc devant le mur de la salle (la maison n’avait subi extérieurement aucun changement, si ce n’est qu’elle était maintenant régulièrement blanchie à la chaux), parlaient de cet épisode et de l’homme qui, venu des mers, avait traversé leurs vies pour disparaître à nouveau en mer.
«Comment s’était-il emparé de tout cet or?» demanda innocemment Mme Réal. «Il n’en avait véritablement pas besoin; et pourquoi, Eugène, l’avoir jeté là?
– Il n’est pas facile, ma chère amie, dit Réal, de répondre à cette question. Les hommes et les femmes ne sont pas si simples qu’ils en ont l’air. Même toi, fermière» (il donnait parfois ce nom à sa femme par manière de plaisanterie), «tu n’es pas si simple que bien des gens pourraient le croire. Je pense que si Peyrol était ici, il ne pourrait peut-être pas répondre lui-même à ta question.»
Et ils continuaient à se rappeler l’un à l’autre en courtes phrases entrecoupées de longs silences les particularités de sa personne et de sa conduite, lorsque, au haut de la montée qui venait de Madrague, apparurent d’abord les oreilles pointues puis tout le corps d’un âne minuscule à la robe d’un gris clair tacheté de noir. De chaque côté de son corps, jusqu’en avant de sa tête, s’allongeaient deux morceaux de bois de forme étrange qui avaient l’air des très longs brancards d’une charrette. Mais l’âne ne traînait aucune charrette derrière lui. Il portait sur son dos, sur un petit bât, le torse d’un homme qui semblait n’avoir pas de jambes. Le petit animal, bien soigné, et qui avait une intelligente et même impudente physionomie, s’arrêta devant Monsieur et Madame Réal. L’homme, qui se tenait adroitement en équilibre sur le bât, ses jambes rabougries croisées devant lui, se laissa glisser à terre, retira vivement ses béquilles de chaque côté de l’âne, s’appuya dessus et de sa main ouverte donna à l’animal une tape vigoureuse qui le fit partir en trottant vers la cour. L’infirme de Madrague, en sa qualité d’ami de Peyrol (car le flibustier avait souvent fait son éloge devant les femmes et le lieutenant Réal: «C’est un homme, ça!»), faisait partie de la maison d’Escampobar. Son emploi consistait à parcourir le pays pour faire les courses emploi peu adapté en apparence à un homme dépourvu de jambes. Mais l’âne se chargeait de la marche, tandis que l’infirme apportait de son côté sa vivacité d’esprit et son infaillible mémoire. Le pauvre diable ayant enlevé son chapeau qu’il tenait d’une main contre sa béquille droite, s’avança pour rendre compte de l’emploi de sa journée par ces simples mots: «Tout a été fait selon vos instructions, madame.» Puis il s’attarda là, serviteur privilégié, familier mais respectueux, sympathique, avec ses bons yeux, sa longue figure et son sourire douloureux.
«Nous parlions justement de Peyrol, déclara le capitaine Réal.
– Ah! l’on pourrait parler de lui bien longtemps, dit l’infirme. Il m’a dit une fois que si j’avais été complet (je suppose qu’il voulait dire avec des jambes, comme tout le monde), j’aurais fait un bon camarade là-bas sur les mers lointaines. C’était un grand cœur.
– Oui», murmura Madame Réal d’un air pensif. Puis se tournant vers son mari, elle demanda: «Quelle sorte d’homme était-ce réellement, Eugène?» Le capitaine Réal restait silencieux. «Vous êtes-vous jamais posé cette question? insista-t-elle.
– Oui, lui dit Réal. Mais la seule chose certaine que l’on puisse dire de lui, c’est que ce n’était pas un mauvais Français.
– Tout est là» murmura l’infirme avec une ardente conviction, dans le silence qui tombait sur les paroles de Réal et sur le petit sourire d’Arlette habitée par le souvenir.
La surface bleue de cette Méditerranée qui enchanta et déçut tant d’hommes audacieux gardait le secret de son sortilège, embrassait dans son sein paisible les victimes de toutes les guerres, de toutes les calamités et de toutes les tempêtes de son histoire sous la merveilleuse pureté du ciel au soleil couchant. Quelques nuages roses flottaient bien haut au-dessus de la chaîne de l’Esterel [155]. Le souffle de la brise du soir vint rafraîchir les rochers brûlants d’Escampobar; et le mûrier, seul grand arbre au bout de la presqu’île, dressé comme une sentinelle à la porte de la cour, soupira doucement de toutes ses feuilles frémissantes, comme s’il regrettait le Frère-de-la-Côte, l’homme aux sombres exploits, mais au grand cœur, qui souvent, à midi, venait s’étendre là pour dormir à son ombre.
1923
[1] SPENSER [1] À G. Jean-Aubry, en toute amitié ce récit des derniers jours d’un Frère-de-la-Côte français [2] .
Ces deux vers, qui devaient être gravés en 1924 sur la tombe de l’auteur, sont extraits de The Faerie Queen ( La Reine des Fées , 1589, livre I, chant LX, strophe 40) d’Edmund Spenser (1552-1599).
Читать дальше