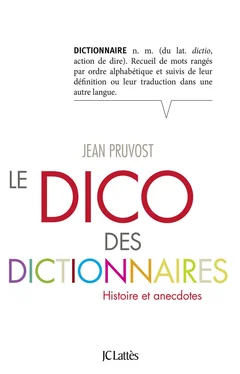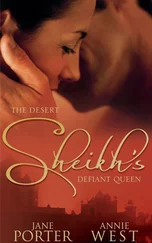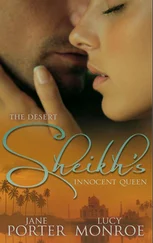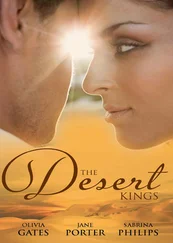Qu’importe en réalité la nationalité et la langue maternelle pourvu qu’on ait l’ivresse des dictionnaires ! À ceci près qu’il semble bien que les auteurs de dictionnaires soient pour leur immense majorité touchés par la grâce des langues en contact.
De Robert Estienne et des polyglottes
Qui a eu en effet plus particulièrement propension à se lancer dans l’aventure des dictionnaires ? Le plus souvent, ceux-là même qui ont été confrontés à une ou plusieurs autres langues, anciennes ou modernes, et qui ont donc rencontré deux systèmes linguistiques, ou davantage, à travers une approche comparative.
Par exemple et sans la volonté d’être exhaustif, signalons simplement que les premiers auteurs de dictionnaires monolingues, français-français donc, et non latin-français, avaient tous au départ l’expérience d’un bilinguisme qui n’était pas fortuit mais de formation. La langue première de l’érudition et de l’enseignement restait le latin. Ainsi, Robert Estienne, auteur du premier dictionnaire bilingue offrant les mots français en position initiale, était-il comme on l’a constaté l’imprimeur de François Ier pour les langues latine et hébraïque. C’est à un imprimeur polyglotte, langues vivantes et langues anciennes, qu’on est confronté.
Il suffit ensuite de se pencher sur les biographies des auteurs de dictionnaires du XVII esiècle, pour s’apercevoir rapidement que si le latin fait partie de leur formation, la connaissance d’une ou de plusieurs langues étrangères les caractérise souvent. Ainsi, Jean Nicot, auteur du Thresor de la langue française (1606), originaire de Nîmes (où se parlait la langue d’oc…), fin latiniste, fut un diplomate envoyé notamment au Portugal : sans être lusophone, la langue portugaise ne lui était pas étrangère.
Richelet, auteur du premier dictionnaire monolingue français, latiniste comme chacun à l’époque, fut aussi, on l’oublie souvent, l’auteur d’une traduction de l’ Histoire de la Floride de l’Espagnol Garcilasso. De son côté, Vaugelas, surnommé « l’Oracle de la langue française », à qui l’on doit en grande partie la première édition du Dictionnaire de l’Académie française et bien sûr les célèbres Remarques sur la langue française (1647), fut le brillant traducteur de l’historien latin Quinte-Curce et « réussissait assez bien dans la poésie italienne », rappelle Pierre Larousse dans le Grand Dictionnaire universel du XIX esiècle .
Quant à Gilles Ménage, auteur des Observations sur la langue française (1650) et du premier Dictionnaire étymologique du français (1694) digne de ce nom, il avait la passion des langues : des langues anciennes lorsqu’il brochait des épigrammes grecques et latines ; mais aussi des langues modernes, l’espagnol et l’italien en l’occurrence, avec un ouvrage, Origini della lingua italiana , qui le fit même nommer membre de l’homologue de l’Académie française en Italie, l’Accademia della Crusca. On sait qu’il avait par ailleurs acquis la maîtrise de l’ancien français, qu’il avait appris l’hébreu et possédait des rudiments d’anglais et d’allemand. Il représente en somme le polyglotte du XVII esiècle.
Ce qui me fait me souvenir d’un colloque très sérieux qui se déroula à Lyon en 1996, où l’un des conférenciers, intéressé par le contexte familial de chaque lexicographe, posa une question ingénue mais propice à l’éclat de rire : « Que faisait la femme de Ménage ? » Elle faisait défaut, Ménage était célibataire ! Le sujet est pourtant sérieux : que font les femmes des lexicographes, la profession ayant été jusqu’à ces dernières années fortement masculinisée ? Elles sont souvent, si l’on songe à Bernard Quemada, Ferdinand Brunot, Robert Martin, Alain Rey, de remarquables conseillères et parfois même de très grandes lexicologues.
Diderot, disciple de Shakespeare
En ce qui concerne les lexicographes du XVIII esiècle, au-delà des jésuites latinistes du Dictionnaire de Trévoux (1704), se souvient-on que, par exemple, Diderot fut contacté par l’éditeur Le Breton non pas en tant que philosophe mais en tant que traducteur-contrôleur de la Cyclopaedia de Chambers, à l’origine de l’ Encyclopédie ? Diderot s’était effectivement fait connaître dans le milieu des éditeurs pour ses talents en anglais. On a du mal parfois à imaginer que la langue de Shakespeare et des Beatles aujourd’hui ait pu, à une époque où les voyages étaient difficiles, être aussi répandue chez les intellectuels. En fait, le XVIII esiècle était fasciné par l’Angleterre, politiquement en avance sur la France, en étant dotée d’une monarchie parlementaire.
Diderot avait notamment traduit, en 1742, l’ Histoire de la Grèce de Temple Stanyan, et, en 1745, l’ Essai sur le mérite et la vertu du théiste anglais Shaftesbury. Il achevait la traduction du Dictionnaire de médecine de Robert James au moment où Le Breton le contacta.
Pour ne citer que quelques lexicographes du XIX esiècle, il serait bon de rappeler par exemple que Jean-Charles Laveaux, auteur d’un remarquable Dictionnaire des difficultés de la langue française (1818) parlait parfaitement l’allemand et avait déjà rédigé un Dictionnaire français-allemand (1784). Dans le même ordre d’esprit, Claude-Marie Gattel, avant d’être l’auteur du Dictionnaire universel (1812), l’un des premiers dictionnaires à indiquer la prononciation, fut l’auteur d’un Nouveau Dictionnaire espagnol-français . Quant à Prévost-Paradol, à qui fut initialement confiée la huitième édition du Dictionnaire de l’Académie (1878), il parlait couramment l’anglais. Émile Littré, qui se destinait à la médecine, se passionnait par ailleurs pour les langues anciennes et fut d’abord le spécialiste érudit et incontesté de la traduction critique des œuvres d’Hippocrate. Et se souvient-on qu’il écrivit des poèmes en ancien français ?
S’agissant de Larousse, comme c’en est le cas au XIX esiècle pour tous les Français qui n’ont pas passé leur enfance dans une grande ville, on n’aura pas de mal à rappeler que, vivant à Toucy, en pays poyaudin, il passa son enfance entre patois et langue française, le tout dans une auberge tenue par sa mère qui accueillait des colporteurs de tous dialectes.
À l’heure espagnole, algérienne, anglaise et alsacienne
L’Espagne, au reste siège d’un dictionnaire académique très apprécié, n’est jamais loin lorsqu’il s’agit de dictionnaires. Si, au XX esiècle, l’on se tourne vers la maison Larousse, il ne serait pas inutile de rappeler que Michel (Miguel) de Toro, qui dirigea le Petit Larousse aux lendemains de la Seconde Guerre mondiale, était parfaitement bilingue français-espagnol, au point d’ailleurs d’être à l’origine, en Espagne, du Pequeño Larousse ilustrado (1912). Son père avait à la frontière des deux siècles déjà donné un excellent dictionnaire français-espagnol.
C’est Jean Dubois qui prendra la suite de Miguel de Toro, à la tête du Petit Larousse illustré . Il fut aussi dans la même maison l’auteur d’un dictionnaire révolutionnaire, dit structuraliste et distributionnaliste. Pas d’inquiétude quant à ces qualificatifs : on résumera en signalant que, au lieu de présenter le mot clou avec plusieurs sens dans un seul article, il l’offrait en plusieurs articles, distinguant un article nouveau chaque fois que la « distribution » grammaticale était différente : au clou qu’on enfonce correspondait un article ; au clou du spectacle qu’on applaudit , un nouvel article ; le vieux clou sur lequel on pédale , encore un autre article, etc. Cette méthode marquera profondément l’histoire de la lexicographie au point qu’il faut se poser la question : Jean Dubois était-il bilingue ? Non. Mais il était de formation classique et professeur de latin. Et il épousera un professeur d’anglais…
Читать дальше