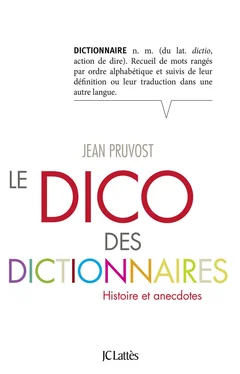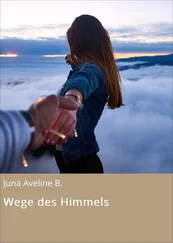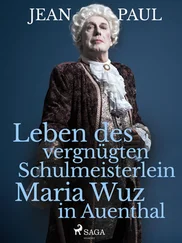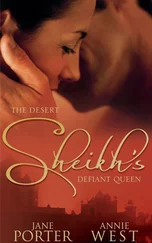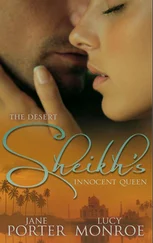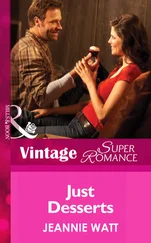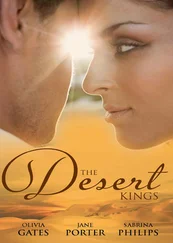Pour être plus précis, à ma gauche, pas encore sur le ring (anglicisme incontournable bien qu’il s’agisse d’un cercle devenu carré), Marie Eva de Villers, qui représentait à son insu Montréal, métropole québécoise à défaut d’être la capitale du Canada (Toronto) et véritable pôle commercial et industriel du Canada dit oriental. À ma droite, Guy Dumas, de la belle ville de Québec, fondée par le Français Champlain en 1608 et capitale de la Province de Québec.
Rappelons pour planter le décor que depuis le millésime du bicentenaire de la Révolution, le Petit Larousse 1989 , figurent dans l’ ours — c’est-à-dire, en argot typographique, la liste des collaborateurs de l’ouvrage — les érudits consultés pour l’insertion de mots consacrés à « la francophonie hors de France (Belgique, Suisse, pays d’Afrique, Québec, Louisiane) », selon l’heureuse formule de la préface.
« Les belgicismes ont bénéficié de la contribution de Jean-Marie Klinkenberg, professeur à la faculté de Liège », ainsi commence le paragraphe consacré à la francophonie dans l’ours du millésime 1989, avec naturellement l’évocation des helvétismes, et nous voilà en Suisse avec Pierre Knecht, puis des québécismes, ce qui fait d’emblée citer le très prolifique Office de la langue française du gouvernement du Québec, sans oublier pour la Belle Province « l’amical concours de Jean-Claude Corbeil », alors maître du domaine, avant que ne soit évoqué le « domaine africain » nourri lexicalement par l’Inventaire du français d’Afrique établi par l’AUPELF, l’Association des universités partiellement ou entièrement de langue française.
En 1988, pour le millésime 1989 donc, l’homme fort du Petit Larousse pour les québécismes était Claude Poirier. C’est lui qui vint, bien qu’absent, semer la discorde, au-dessus de mon assiette. « Que pensez-vous des derniers québécismes entrés dans le Petit Larousse ? » me demande Eva de Villers. Réponse prudente : pour nous, ils ne manquent pas de charme, ils pourraient même nous être bien utiles. Magasiner , par exemple, est tout de même de loin plus attractif que « faire du shopping ». À Guy Dumas de prendre le relais : « Il y a aussi les emplois spécifiques, qu’il faut faire entrer progressivement dans le Petit Larousse . Claude Poirier a proposé boyau d’arrosage. Je suis ravi qu’il ait été accepté dans le Petit Larousse . » « Eh bien, pas moi ! s’exclama alors Marie Eva de Villers… Ce n’est pas un mot québécois. Personne ne le dit. » « Mais si, tout le monde dit boyau d’arrosage à Québec. »
Et ce fut une courtoise passe d’arme m’aspergeant à ma droite et à ma gauche, boyau d’arrosage brandi à ma gauche et tuyau d’arrosage à ma droite. J’aurais aimé ne pas être « mouillé ». Impossible, ma position entre les deux protagonistes appelait un arbitrage.
Avant le boyau, la wassingue
J’ai alors timidement avancé qu’il s’agissait peut-être d’une variante ou d’un régionalisme. Je n’ai pu m’empêcher de penser dans le même temps que si le débat avait eu lieu en France entre la serpillière et la wassingue , tout le monde aurait admis que la norme était la serpillière et que la wassingue correspondait à un régionalisme du Nord (issu du germanisme washen et de l’anglais to wash , laver).
Ici, en définitive, l’interrogation suscitée par ce « tuyau d’arrosage » était tout autre : où était la norme ? Or, d’évidence, elle n’était pas partagée. Au point de mériter une polémique sur ledit tuyau ou boyau.
Un des problèmes de la lexicographie québécoise était posé. Comment rédiger un article de dictionnaire au nom d’une collectivité, lorsque celle-ci ne distingue pas encore clairement ce qui relèverait des régionalismes et ce qui relèverait de l’usage normatif. Et qui, en pleine démocratie, aura le culot de dire voilà le « vrai » mot. Sous Louis XIII puis Louis XIV, Malherbe puis Vaugelas avaient pu instituer une norme acceptée par la Cour, en l’installant entre autres dans le Dictionnaire de l’Académie française , peu ou prou arbitre du bon usage. Au XXI esiècle, c’est un peu tard, et ce n’est pas un hasard si la notion même de « norme » fait l’objet au Québec de nombreux colloques, très animés, quand en France elle soulève très peu d’intérêt. La norme fait débat lorsqu’elle n’est pas encore consensuelle.
Et pour nous en réalité, la rédaction d’un dictionnaire de référence, celui dont on attend une forme d’autorité, se doit d’être le reflet d’un consensus certain autour de la langue. Lorsque deux érudits s’empoignent sur des mots courants, on peut penser que l’heure de la lexicographie autonome n’est peut-être pas encore venue. Et, pour tout dire, quoi de plus revigorant qu’une langue en débat, vigoureuse et non fixée dans le marbre !
Et l’ours ?
À propos, l’ ours …, cette belle page où sont cités les tenants des mots de la francophonie, « hors de France », à partir du millésime 1986 du Petit Larousse illustré , d’où vient-il ? Consultez force dictionnaires étymologiques, et vous constaterez que c’est à qui est le plus confus pour expliquer l’origine du sens que le gros mammifère a acquis dans l’imprimerie. Si on comprend parfaitement par exemple que l’ours ait pu désigner l’ouvrier typographe chargé de la presse, en comparant sa démarche forcément lourde à celle balancée et impressionnante du gros plantigrade, avec une première attestation en 1713 au moment où l’imprimerie est en pleine expansion, si l’on perçoit plus difficilement, que par une supposée allusion à l’ours mal léché, l’ ours a pu aussi définir une pièce de théâtre jaunissant dans les cartons, faute d’être publiée, le lien avec le manuscrit à revoir puis la liste des collaborateurs d’un ouvrage collectif devient franchement plus mystérieux. Il est bon parfois d’avouer que le sens figuré d’un mot garde une belle part de son mystère. Après tout, l’ours des cavernes ou du zoo reste un animal mythique.
Si le C gagne la victoire, c’est qu’il règne sur tous les cœurs.
Il est très ancien dans la Grèce
Par lui commença Cupidon ;
Il n’est pas sans C de caresse,
De contrat, de convention :
Sans lui que serait la science ?
Les Étrennes lyriques, 1786, cité dans le Grand Dictionnaire universel du XIX esiècle, Pierre Larousse.
CANDIDAT s. m. Qui aspire à quelque degré, à quelque dignité. Il n’est pas encore receu dans une telle charge, il n’est que candidat . Il ne se dit guere qu’en raillerie.
Dictionnaire de l’Académie française, 1694.
Les excès déplument le crâne.
Exemple du Petit Larousse, millésime 1906.
Champignon. Manière de petit potiron qui vient dans les champs sans être fermé, & dont on se sert dans les ragoûts.
Pierre Richelet, Dictionnaire françois, 1680.
Il ne fait vraiment pas bon se tromper en matière de champignon. L’aventure peut coûter très cher à une maison d’édition. Où se trouve la plus belle et la plus ancienne planche de champignons ? Dans le Petit Larousse illustré , depuis le premier millésime, en 1905. Et tous les mycologues de France et de Navarre de la consulter avec délice, effroi, et attention. Qui n’est pas allé vérifier, du temps où Internet n’existait pas, si le champignon cueilli au pied du cerisier était comestible, en essayant de le retrouver sur cette planche ? Une planche qui d’ailleurs a été parfois arrachée dans les dictionnaires trouvés en brocante. Dès 1905, elle est en effet en couleurs : page 167.
Читать дальше