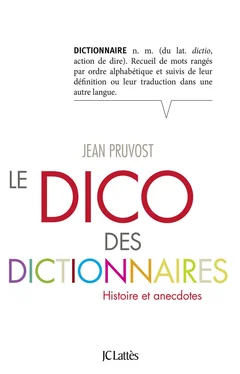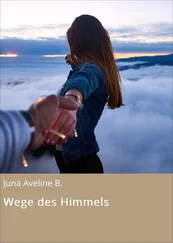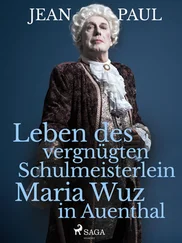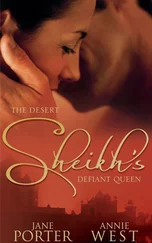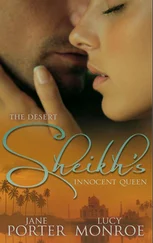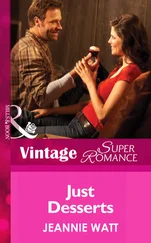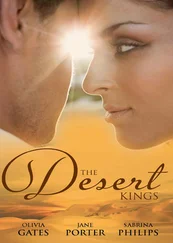S’il n’est pas un Français qui ignore le nom de Larousse, il en va de même pour un nouveau venu au cours de la seconde moitié du XX esiècle, également synonyme de dictionnaire, Robert. Mais d’où vient Paul Robert ? Il est originaire d’Algérie où il fit toutes ses études dans un environnement arabophone, mais il aimait passionnément l’anglais qu’il avait pratiqué tout d’abord en tant que jeune élève, mais aussi, dans le cadre d’un voyage d’études avec son père aux États-Unis, voyage au cours duquel il fit office de traducteur. Il avait ensuite beaucoup parlé la langue anglaise pendant la Seconde Guerre mondiale, en travaillant au Dictionnaire du chiffre auprès des services secrets américains. Et, comme il le signale dans ses souvenirs, c’est en dressant par plaisir au lendemain de la guerre des listes de mots anglais par thèmes que lui viendra l’idée d’un traitement analogique des mots français.
Que le Trésor de la langue française (1971–1994) soit par ailleurs successivement dirigé par un romaniste s’il en est, mais aussi alsacien et germaniste, Paul Imbs, puis par Bernard Quemada, comme on l’a déjà dit, grâce à son enfance, parfaitement bilingue de langues française et espagnole, ne manque pas aussi de confirmer la fréquente expérience bilingue ou plurilingue des lexicographes monolingues.
Enfin, on n’oubliera pas qu’Alain Rey enseigna dans des universités des États-Unis et il suffit de consulter son Que sais-je ? sur les Encyclopédies et Dictionnaires pour être convaincu de sa sensibilité et de sa compétence interculturelles.
Oserons-nous ajouter que l’auteur de ces lignes fut rompu à la sténographie et à l’esperanto avant l’âge de onze ans, dans le cadre d’une formation première un peu particulière mais en partie transculturelle, et qu’il faillit par ailleurs devenir professeur d’anglais ? Ce dernier projet n’aboutit point, fort heureusement pour les élèves.
Dictionnaires : œuvres d’interprètes
S’il ne s’agit pas d’afficher en matière d’œuvre lexicographique un déterminisme à tous crins, il n’en reste pas moins qu’on ne peut mettre sous le boisseau l’expérience pluriculturelle de presque tous les lexicographes, tantôt naturellement bilingues, tantôt manifestement ouverts à l’inter-culturalité. C’est en effet forts de cette ouverture qui en fait des interprètes privilégiés que les lexicographes peuvent donner toute leur mesure.
On partage assurément avec Paul Imbs, le créateur inspiré du Trésor de la langue française , la conviction que le dictionnaire, et notamment « le dictionnaire de langue » comme le TLF , le Littré , le Robert , reste d’abord « un dictionnaire de lecture, d’interprétation, de décodage », comme il l’affirme dans la préface du TLF . Mais il importe de rappeler au passage que c’est par sa dimension culturelle et interculturelle que l’œuvre passe à la postérité en demeurant toujours prégnante.
Le dictionnaire est donc loin de représenter une étude neutre, froide, plate, unilingue : il résulte d’un merveilleux appétit pour les langues et les cultures et je pense très souvent à cette citation de Goethe notée dans mon premier petit carnet de pensées fortes à mes yeux, avant même de rencontrer les dictionnaires : il était en effet persuadé qu’on apprenait très bien sa langue maternelle en en apprenant une autre. Et si nos lexicographes avaient rédigé un dictionnaire pour mieux connaître la langue choisie, pas forcément la langue spontanément dominée ?
Il y a dans tout auteur d’un dictionnaire un élève se soumettant à un exercice préparatoire d’une œuvre littéraire à laquelle il rêve sans oser l’avouer. On dispose cependant de quelques aveux sur lesquels nous reviendrons.
BOYAU. s. m. Les conduits ou tuyaux par où les gros aliments sortent du corps humain. […] Du Cange témoigne qu’on disoit autrefois boël et bouële, & croit qu’il vient de botulus, qui signifie aussi boudin.
Antoine Furetière, Dictionnaire universel, 1690.
Chaque année dans le Petit Larousse depuis les années 1970 entrent des mots ou des sens québécois, soigneusement choisis par d’éminents professeurs québécois, qu’il s’agisse par exemple de Jean-Claude Corbeil, thaumaturge de la politique linguistique francophone du Canada, ou de Claude Poirier, figure universitaire de premier plan dans la lutte propre à garantir le rayonnement de la langue française en terre canadienne. Ainsi, dans le millésime 2006 entrait prosaïquement chez la Semeuse un nouvel élu lexical, non pas le mot boyau , installé dans nos dictionnaires depuis le XVII esiècle, mais son acception québécoise, le boyau d’arrosage , correspondant en « français de France », si l’on peut dire, au « tuyau d’arrosage ».
À dire vrai, je n’avais pas immédiatement débusqué cette nouvelle acception du boyau (du latin botellus , petite saucisse) dans la mesure où il ne s’agissait que d’un sens ajouté au sein d’un article déjà fourni et non d’un nouveau mot glissé dans la nomenclature, plus facile à repérer.
Entre la poire et le fromage
C’est entre la poire et le fromage, à la table copieuse et prestigieuse du consul de Montréal, que je me retrouvai lexicalement arrosé, tant et plus et à jet continu, par le « boyau d’arrosage ». En octobre 2006 avait lieu en effet à Québec, selon un rituel trisannuel, la Journée québécoise des dictionnaires, homologue très réussi de la Journée des dictionnaires que j’ai créée en France en 1993. Organisée et mitonnée par ma collègue, Monique Cormier, sœur de lait lexicographique, cette Journée, ou plutôt cette manifestation de deux jours, se concluait donc par un dîner d’apparat chez le consul en compagnie de quelques hautes et valeureuses personnalités. Un « dîner », c’est-à-dire dans la Belle Province, un « déjeuner ». Gare à ceux qui, invités à dîner sans précision, et ignorant la dangereuse variante, se présentent benoîtement en fin de soirée !
La disposition protocolaire des couverts m’avait nettement favorisé, assis entre deux personnes charmantes et de belle culture. À ma droite, le sous-ministre Guy Dumas, qui avait été chargé des Affaires culturelles et linguistiques du Québec, avec une expérience magnifique. « Sous-ministre », voilà certes au passage encore un québécisme et un portefeuille très valorisant outre-Atlantique, mais relevant d’une manière de dire que la France de Louis XIV et de De Gaulle, volontiers immodeste et orgueilleuse, aurait incontinent classé, à tort, dans les formulations péjoratives. Ce qui n’a jamais été le cas au Québec. Vivent les sous-ministres.
À ma gauche, Eva de Villers, fort jolie personne et auteur très réputé au Québec pour ses dictionnaires conçus à partir des questions linguistiques posées à l’Office québécois de la langue française. Avec donc un objectif privilégié : rassurer ses nombreux lecteurs par l’indication d’une norme intangible, offrir une règle à tous ceux qui, et ils sont nombreux au Québec, se sentent en « insécurité linguistique ». Confrontés qu’ils sont à une langue en mouvement permanent, fort vivante en somme, ils ont la constante impression que rien n’est stable, d’où cette formule très usitée au Québec, plus qu’ailleurs : l’« insécurité linguistique ».
La conversation, si ouverte et enlevée fut-elle, ne pouvait échapper à un moment ou à un autre au thème privilégié, objet de toutes les attentions, les dictionnaires. Et c’est ainsi qu’il fut question du Trésor de la langue française du Québec, dirigé de main de maître par Claude Poirier, à l’université Laval de la ville de Québec, à 300 kilomètres en aval du Saint-Laurent au confluent de la rivière Saint-Charles par rapport à Montréal. Ces précisions géographiques, à propos de l’immense espace du Canada et de sa vaste portion francophone, ne sont pas inutiles, comme nous allons le constater, compte tenu du tour incongru que prit la conversation.
Читать дальше