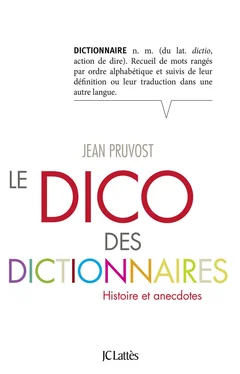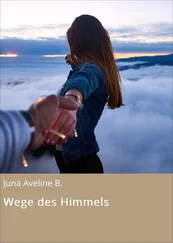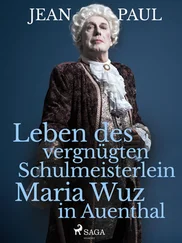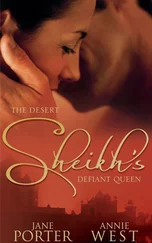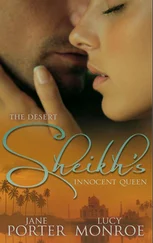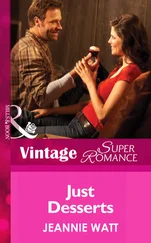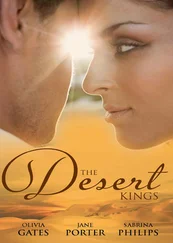— achever ce premier lot de mots avec d’une part la zymotechnie , technique ou étude de la fermentation, et d’autre part le bien sonnant zymogène , ressemblant fort à un prénom, mais relevant indubitablement de la fermentation, ici spontanée ;
… voilà qui, sans être rassurant pour le lexicographe, ne manquerait pas de pittoresque. Avec pour l’encourager, si on se réfère au Trésor de la langue française (1971–1994), en huitième position dans cet ordre analphabétique — du grec ana , de bas en haut — le délicieux adjectif-nom zygomatique . C’est-à-dire ce qui se rapporte à la pommette. Et qui grâce au grand et au petit zygomatique , deux muscles rubanés qui descendent obliquement de la pommette à la commissure des lèvres, nous permettent d’offrir rires et sourires à nos contemporains.
Ainsi, le premier lot de mots attribués au lexicographe commencerait-il d’une part avec l’inquiétant zzz polysémique, « sifflement d’un projectile » ou rassurant « souffle d’un dormeur », ou encore « vol d’un insecte » qu’on imagine vrombissant dans la chaleur de l’été, ou bien, plus moderne, « mouvement d’une machine », et s’achèverait-il d’autre part sur la plus belle posture de l’être humain, lorsqu’il manifeste son plaisir, sa joie ou son bonheur à la pointe des zygomatiques …
Quant aux toutes premières citations du tout dernier mot alphabétique — ou du premier, analphabétique… — , elles passent avec Paul Imbs et Bernard Quemada, vigilants gardiens du Trésor de la langue française , par un roman sans concession, Folies d’infâme (1984), de P. Siniac : « Toujours personne dans le bistrot », s’inquiète-t-il. « Même pas les zzzzzzzz d’une mouche pour dégeler l’atmosphère. » Bigre…
Ou encore dans le Dictionnaire culturel en langue française (2005). Mais alors là, danger pour les diptères dont la mouche est l’un des éminents représentants, le choix d’Alain Rey se portant sur Céline avec un extrait de Nord , mettant en scène son prédateur premier : « Les araignées viennent regarder, elles se laissent filer du plafond, elles gafent… et zzz ! elles se renroulent. »
Aucun doute : les trois z acérés de l’araignée auront raison des huit z de la mouche qu’elle soit bleue ou verte, de toute façon à « trompe molle », précise-t-on dans nos lexiques.
À tout prendre, commencer par le mot À reste peut-être plus rassérénant. C’est en tout cas la certitude de rencontrer assez vite l’Académie : cinq siècles de lexicographie, de la première à la neuvième édition, une pérennité pour le moins rassurante.
Zoophyte (« Animal qui tient de la plante comme les éponges »), zone, zodiaque, zizanie, ziczac : dans l’ordre inverse, ce sont là les cinq derniers mots de la première édition du Dictionnaire de l’Académie française (1694).
Ziczac ? Un mot disparu (si l’on fait semblant d’oublier zigzag …) : « Sorte de machine qui est composée de plusieurs pièces de bois attachées & pliées, les unes sur les autres, & qui s’allonge & se resserre selon qu’on veut. Donner une lettre de la ruë à une fenestre par le moyen d’un ziczac ; une broderie en ziczac , des livres dorés en ziczac », lira-t-on dans l’édition de 1694.
Un merveilleux ziczac , au service de chacun : voilà une belle image en définitive pour un dictionnaire.
POSTFACE
de l’Académie et de l’andouille de vire
Académie française :
La dénigrer, mais tâcher d’en faire partie si on peut.
Gustave Flaubert, Le Dictionnaire des idées reçues, 1850.
— Vous auriez donc rencontré Jean Mistler, Secrétaire perpétuel de l’Académie française, dans son bureau ?
— C’était au siècle dernier.
— Le sujet de l’entretien ?
— La rédaction du Dictionnaire de l’Académie.
— Et puis…
— La fabrication des andouilles de Vire…
J’avais un peu plus de vingt ans ; c’était en 1973. À la suite d’une licence de Lettres, un concours réussi m’avait propulsé en région parisienne : je serais professeur dans le secondaire. Il faut bien l’avouer, lesdites études de Lettres s’étaient révélées décevantes. Vivre une année entière, plongé dans Athalie , ou le Nouveau Christianisme de Saint-Simon, c’était pour le moins réducteur et vraiment trop peu pour des étudiants affamés de littérature venus s’ouvrir au vaste monde lettré.
Certes, mais les andouilles ? J’y viens.
Licence en poche, je décidais cependant de poursuivre. Bien m’en prit puisque je rencontrai à Paris XIII un professeur rayonnant dont le programme était immense et simple : les mots — tous les mots —, les dictionnaires — tous les dictionnaires. Il dirigeait pour le CNRS le bien nommé Trésor de la langue française qui allait compter seize volumes, 450 000 citations, un monument du XX esiècle… : les dicopathes ont reconnu le professeur Bernard Quemada.
Arrière alors les horizons bornés et place aux grandes marées de mots, de tous poils, de toutes saveurs. Avec fougue, sous sa houlette hyperactive, nous parcourions ainsi l’histoire exaltante des pionniers du mot, de Richelet à Paul Robert, en passant par Émile Littré, Pierre Larousse et les différents tenants des neuf éditions du Dictionnaire de l’Académie française .
Et l’histoire du mot andouille ? Patience.
Pour les plus curieux d’entre nous, après les cours, nous pouvions suivre Bernard Quemada dans une aile de l’université, toute neuve, où était installé le laboratoire CNRS qu’il dirigeait. Et où vibrait, aussi imposante qu’une belle voiture américaine, une machine rutilante qui se nourrissait des cartes perforées, le nec plus ultra du modernisme d’alors. C’est avec cette machine que j’engrangeais une maîtrise, diplôme post-licence englouti dans de nouvelles réformes au XXI esiècle. 10 000 cartes perforées… avec tout au bout de la trieuse, en somme au niveau du pare-choc arrière de la belle américaine, une imprimante crachant en accordéon des listes de mots. Voilà qui nous faisait rêver, avant la danse frénétique des électrons au bout des claviers d’ordinateurs.
Les andouilles ? J’y suis presque.
Pour le diplôme suivant, alors appelé DEA, Diplôme d’études approfondies, lui aussi englouti dans les neiges du siècle dernier, Bernard Quemada demandait entre autres deux dossiers, l’un fondé sur la description d’un vocabulaire technique, l’autre sur un dictionnaire ad libitum . Je choisissais l’Académie française et la constitution de son dictionnaire. Quant au vocabulaire technique, je demeurais dans l’interrogation.
Cette interrogation allait être levée au volant d’une 4 L : nous allions souvent en Normandie et, en sortant de Condé-sur-Noireau, à l’issue d’un long virage, sur le bord de la route, j’aperçus une pancarte défraîchie : « Filature d’andouilles », avec une flèche signalant la direction à prendre, un petit chemin de pierre sinueux, en contrebas. Le lendemain, j’entrais dans cette « filature », une toute petite maison normande, aux murs de granit bleu, le long d’un filet d’eau. Bien avant d’avoir franchi le seuil de la porte, le fumet qui s’en exhalait n’autorisait aucun doute : on y fabriquait bien des andouilles. La question première allait de soi : pourquoi une filature ? Personne ne le savait, c’était ainsi depuis des siècles.
La réponse allait cependant être offerte par les mots découverts au cours de la matinée passée à enquêter dans ladite « filature d’andouilles ». Je repérais en effet rapidement de nombreuses analogies entre le traitement des boyaux de porc et celui, artisanal, de la laine, le vocabulaire étant en grande partie identique. La filature d’andouilles ou de laine suppose de fait un même emplacement, le long d’une rivière, pour laver, nettoyer , faire dégorger le coton ou les boyaux, il faut étirer, lier, attacher en écheveaux , on se sert de barrettes , de chariots , de cadres , et de tringles , enfin on file les boyaux comme la laine ou le coton. D’où la filature .
Читать дальше