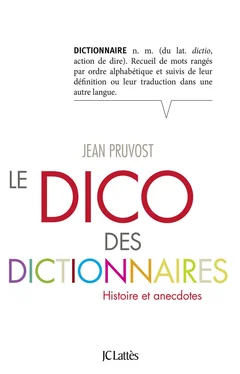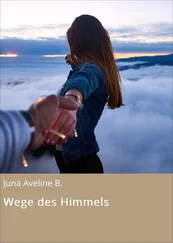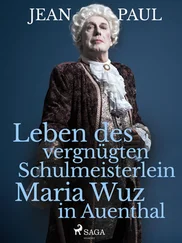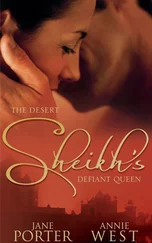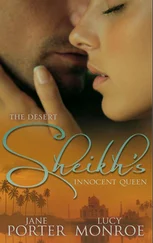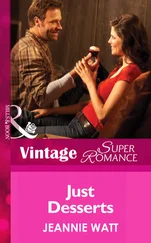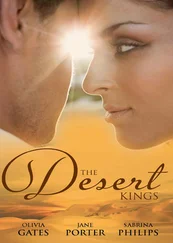Facile mais imparable.
Combien de mots ?
Dix ans plus tard, dans son Dictionnaire universel , Furetière se montre plus courageux. Après quelques commentaires sur le fait qu’il s’agit d’une « lettre double qu’on a empruntée du Latin », il ose un mot. Quel mot commençant par x fera ainsi sa première entrée dans l’histoire de nos dictionnaires monolingues ?
Xiphoide . Construit sur le mot grec xiphos , désignant une épée, il s’agit d’un terme de médecine. Pour être plus précis, « c’est un nom qu’on donne au cartilage qui termine la closture de la poitrine par devant, qui est au bas du sternon [le sternum…] ou du brechet ». Et Furetière de traduire en changeant de registre : « On l’appelle vulgairement fourchette , parce qu’il se divise en deux comme une fourche. »
Enfin, premier ouvrage d’une longue série, vient le Dictionnaire de l’Académie française en 1694. Début modeste pour le X… Un seul article, celui correspondant à la lettre. « L’ X est une lettre double qui a ordinairement le son du C , & de l’ S , joints ensemble. Ainsi dans le mot d’ Alexandre , on la prononce comme s’il y avoit Alecsandre . » Suit alors une remarque en partie déjà formulée par Richelet : « La Langue Françoise n’a aucun mot qui commence par cette lettre, si ce n’est quelques noms propres. Comme Xaintes, Xaintonge , etc. dans lesquels l’ X se prononce comme une S rude, & comme s’il y avoit Saintes, Saintonge . »
Ainsi, les débuts du X — la lettre… — au sein de nos premiers dictionnaires monolingues, donc ceux du Grand Siècle, ne furent pas à proprement dit prometteurs. À peine un quart de page dans chaque ouvrage. Les décennies allaient cependant se suivre en faisant s’épanouir progressivement ce chapitre ; deux siècles plus tard, à la fin du XIX esiècle, Littré ouvre cette fois-ci un chapitre entier consacré à la lettre X qui a indiscutablement pris du poids : 2 pages, 68 mots.
Émile Littré, qu’il est très difficile de surprendre joyeux, commence de fait assez froidement la description de la lettre. Sitôt la précision donnée qu’il s’agit d’une « Lettre consonne qui est la vingt-troisième de l’alphabet », le lexicographe, qui bénéficie d’une formation de médecin et n’est pas vraiment romantique, commence brutalement par une remarque physiologique peu plaisante : « Jambes en X, se dit des genoux tournés en dedans et se touchant. »
On préfère sa définition de xylophone , musicale, encore que le grand homme ne se distingue pas par une haute pertinence dans l’analyse du son émis par ledit instrument, doté, dit-il platement, d’« un son très-singulier et d’une qualité toute particulière ». Au bout de l’alphabet, il peut arriver que le lexicographe soit fatigué.
Combien de sens ?
Il est toujours fascinant de faire émerger de ces articles liminaires sur la lettre à traiter, articles qu’en fait personne ne consulte, des savoirs encyclopédiques patiemment accumulés par le lexicographe. On imagine aisément l’érudit Littré se délecter de signaler par exemple qu’« en marge des anciens manuscrits, X est une note critique qui indique une expression inusitée ou une figure trop hardie ». Bien des professeurs pratiquent encore ainsi en marge des copies sans imaginer que leur réflexe a plus de dix siècles.
S’y dénichent aussi des expressions aujourd’hui désuètes, « les x » par exemple, synonyme familier des mots algèbre et mathématiques . Il est peu probable que déclarer aujourd’hui d’un ingénieur qu’il est « fort en x » soit d’emblée compris.
Il n’en reste pas moins que l’ X , niche privilégiée pour les forts en mathématiques, tient sans doute son nom de là. La présence de deux canons croisés sur l’insigne de l’École polytechnique, École créée en 1794, incite certes à y repérer la forme d’un X . Mais de l’avis même des premiers polytechniciens à la surnommer ainsi, cette lettre tient plutôt à la prééminence des mathématiques dans leurs formations. Les x , mais aussi les y , y pullulent… Prestige oblige, la majuscule est de rigueur, tant pour le nom de l’école que pour le surnom des élèves : il était une fois un X, un polytechnicien, qui épousa une X, une polytechnicienne et qui eurent x enfants…
Qu’il s’agisse du prude Émile Littré ou du bon vivant Pierre Larousse, point de mention, par force, quant au cinéma et ses films X. La majuscule s’impose aussi mais rien de mathématique en l’occurrence, il s’agit du simple calque de l’américain X rated , c’est-à-dire rayé d’une croix, d’un X , un emprunt fait à l’univers du cinéma américain, attesté pour la première fois en 1975 dans la langue française.
En ce même XX esiècle, fructueux quant aux nouveaux sens du x , était apparu en son tout début, en 1904, un autre sens de la lettre pour qualifier un certain type de rayons, les rayons X , ainsi nommés parce qu’on ne savait pas encore les identifier. Tout comme devait s’installer aussi dans la seconde moitié du siècle une nouvelle expression issue d’une loi de 1941, l ’accouchement sous X , préservant par ce X l’anonymat d’une femme ne prenant pas en charge son enfant, le nouveau-né étant dès lors adoptable.
Lettre mystérieuse aux multiples sens, x n’a sans doute pas fini sa carrière : c’est la marque de l’infini ! Elle sert même, toujours issue de l’anglais, à construire quelques mots plaisants : Xtra, par exemple. Enfin, que serions-nous sans le jeu des chromosomes X et Y, les femmes et leurs deux chromosomes X, les hommes et leurs chromosomes X et Y. Y ? Le lien est tout fait pour la lettre suivante. Ainsi, en rédigeant l’article de la lettre X , le lexicographe presque arrivé au bout de son dictionnaire prend déjà de l’avance sur Y .
« Six est un nombre composé de deux fois trois ou de quatre et deux », déclare sans se tromper l’Abbé Féraud dans le Dictionnaire critique de la langue française (1787). De son côté, le Petit Robert 2003 préfère définir l’adjectif numéral cardinal en soulignant avec autant de certitude que c’est un « nombre entier naturel équivalant à cinq plus un ». Quant au Trésor de la langue française qui offre bien heureusement la même solide information, les auteurs ajoutent habilement qu’il a pour synonyme la « demi-douzaine ».
Tout cela nous rassure arithmétiquement, tout en démarquant la multiplicité des choix offerts aux lexicographes pour définir un nombre. Mais c’est au Petit Larousse que revient la réflexion première formulée sur les trois formes qui se cachent sous ce chiffre. On dit [sis] pour le chiffre prononcé seul mais « [si] devant une consonne ou un h aspiré, [siz] devant une voyelle ou un h muet ». C’est spontanément qu’en effet on prononce de trois manières différentes : on arrive ainsi à six (sis), que ce soient six hommes (siz), avec la liaison en z , ou six femmes (si). Indiquer dans un dictionnaire la prononciation des chiffres se terminant par un x, six, dix , etc., suppose donc de longues explications. Nous n’irons pas jusqu’à dire que c’est infernal, mais Furetière devait y songer puisqu’il conclut l’article six en signalant que « la grande Beste de l’Apocalypse a pour marque six cens soixante six ». Trois six. D’ailleurs, tout se tient, puisqu’un trois-six est un alcool redoutable à 36 degrés. « C’était de l’alcool presque pur », fait dire Alphonse Daudet à l’un de ses personnages éponymes, Jack (1876), à qui pourtant « le trois-six […] parut aussi fade et insipide que de l’eau claire ». Il n’a qu’à boire du xérès.
Читать дальше