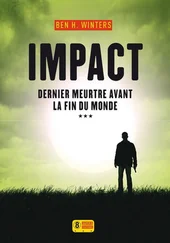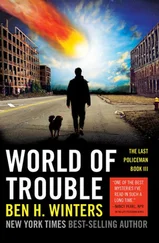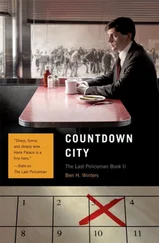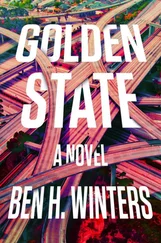« Dans l’ouest du Massachusetts, inspecteur, me dit-elle. Toi et moi. »
Elle me fait un clin d’œil, rabat sa visière, et elle sourit, je le vois aux rides de son front au-dessus du Plexiglas. Puis elle s’en va, se mettant à courir tandis que le camion à dix-huit roues arrive en grondant, son chauffeur agrippé au volant pour garer l’engin. Les policiers envahissent ses flancs métalliques tels des insectes sur une charogne en forêt.
Je la rappelle. C’est plus fort que moi.
« Trish ! S’il y a du café dans le camion… »
Par-dessus son épaule elle me montre son majeur, et disparaît dans la horde des flics.
* * *
Nico, ma sœur, vit dans une friperie de Wilson Avenue. C’est là qu’elle se trouve, terrée avec un petit assortiment de neuneus défoncés parano-égarés, négligés, à la mâchoire pendante, qui se succèdent régulièrement. Ma frangine.
Je vais la voir un jour sur deux. Je ne frappe pas, n’entre pas. Je me tiens de l’autre côté de la rue ou bien je rôde dans la ruelle boueuse qui longe l’arrière de la boutique, en me penchant vers les fenêtres ouvertes pour entendre sa voix, pour l’apercevoir. Aujourd’hui, je me recroqueville sur le banc d’un arrêt de bus en face de ce magasin appelé Next Time Around , un numéro de Popular Science vieux de six mois ouvert devant les yeux, façon agent secret.
La dernière fois que j’ai parlé avec Nico Palace, c’était en avril, et elle se tenait devant chez moi dans sa veste en jean, pour me révéler avec orgueil et provocation comment elle avait profité de la crédulité de son grand frère policier, comment elle m’avait baratiné pour que je fasse jouer mes relations dans la police afin d’obtenir des informations sensibles sur la sécurité des installations de la Garde nationale du New Hampshire, sur Pembroke Road. Elle m’avait utilisé, sans parler de son mari, Derek, qui a probablement été exécuté ou emprisonné à vie en résultat de ses manœuvres. J’étais stupéfait et furieux, et je le lui ai dit, et Nico m’a assuré – le souffle coupé par sa propre importance – que ses machinations servaient un objectif d’importance capitale. Elle était là, sur mon porche, à fumer ses American Spirit, les yeux étincelants de malice, à soutenir qu’elle-même et ses compagnons anonymes travaillaient à nous sauver la vie à tous.
Elle avait envie que je lui demande des précisions, et je me suis refusé à lui faire ce plaisir. Au lieu de quoi je lui ai dit que ce projet, quel qu’il soit, n’était qu’un ramassis d’absurdités dangereuses, et depuis nous ne nous sommes plus adressé la parole.
Et pourtant me voilà, en train de tourner les pages de mon Popular Science , relisant pour la millionième fois un article sur la composition du sous-sol au fond de la mer d’Indonésie, et sur ce que cela implique pour le panache qui sera projeté dans notre atmosphère au moment de l’impact… me voilà, en train d’attendre pour m’assurer que Nico n’est pas en danger. Une fois, elle a été absente pendant deux jours, et son absence m’a suffisamment inquiété pour que je passe trois heures misérables accroupi dans cette immonde ruelle à l’arrière, à écouter par les fenêtres jusqu’à ce que l’un des déchets humains présents à l’intérieur dise à un autre que Nico était partie quelques jours à Durham, pour aller voir les utopistes et les révolutionnaires improvisés de la République libre du New Hampshire.
Je ne me suis pas attardé sur les détails. J’avais juste besoin de savoir, comme maintenant, qu’elle allait bien.
Enfin la porte s’ouvre, un gros garçon d’une vingtaine d’années aux cheveux gras sort pour vider un seau rempli de quelque fluide – de l’urine ? De l’huile de friture ? Le liquide d’une pipe à eau ? –, et j’aperçois Nico, mince, pâle, la clope au bec, dans l’embrasure.
J’aimerais pouvoir abandonner ma sœur à ses copains et à ses plans débiles. J’aimerais pouvoir « m’en soucier comme de mon premier gilet de flanelle », comme aurait dit mon père, de cette enfant égoïste, indisciplinée, ignorante. Mais que voulez-vous, c’est ma sœur. Nos parents sont morts, ainsi que le père de mon père, qui nous a élevés, et c’est ma responsabilité de m’assurer, pour le moment du moins, qu’elle reste en vie.
« Assieds-toi où tu veux, chéri. »
C’est l’heure du déjeuner mais Culverson et McGully ne sont pas là et, en me perchant sur un tabouret devant le comptoir, j’ai une bouffée d’angoisse. Chaque fois que quelqu’un est absent alors qu’il ne devrait pas l’être, une zone de mon esprit se précipite sur la certitude qu’il est mort ou qu’il a disparu.
« Il est encore tôt, me dit Ruth-Ann, qui lit dans mes pensées, en s’approchant avec son pichet d’eau chaude et des sachets de thé sur un plateau. Ils vont arriver. »
Je la regarde repasser de l’autre côté du comptoir. L’astéroïde s’abattra, détruira la Terre, et ne laissera derrière lui que Ruth-Ann, flottant dans les vastes ténèbres de l’espace, une main serrée sur la poignée de son pichet.
Sur le comptoir, je trouve le numéro d’adieu du Concord Monitor , qui date d’un dimanche, il y a quatre semaines de cela, et, bien que je l’aie sans doute déjà lu une centaine de fois de la première à la dernière ligne, je le reprends pour le relire une fois de plus. La campagne de bombardements américains et européens contre des cibles nucléaires, militaires et civiles au Pakistan. La toute nouvelle commission Mayfair, qui exige par assignation les archives de la Surveillance spatiale et de l’observatoire portoricain d’Arecibo. Le gigantesque paquebot de croisière à douze ponts, arborant pavillon norvégien, qui s’est échoué dans le port d’Oakland et s’est révélé porteur de plus de vingt mille réfugiés d’Asie centrale, ses soutes pleines de femmes et d’enfants « entassés comme des animaux ».
Il y a un long reportage en dernière page sur une jeune femme, ancienne étudiante en droit à l’université de Boston, qui a décidé de partir pour l’Orient, pour l’Indonésie, réfugiée à rebours, afin d’attendre la fin du monde « à l’épicentre de l’événement ». Le ton de l’article est doucement amusé, du genre « bah, que voulez-vous ? », à l’exception des citations horrifiées de ses parents.
Et là, dans le coin inférieur gauche de la première page, le bref mea culpa angoissé de l’éditeur : par manque de ressources, par manque de personnel, nous sommes au grand regret de vous annoncer qu’à dater de ce jour…
Ruth-Ann est en train de poser ma tasse à thé sur sa soucoupe lorsque quelqu’un pousse la porte à grand fracas. Je pivote sur moi-même, renverse la tasse avec mon coude, et celle-ci se fracasse au sol. Ruth-Ann sort un fusil à canon double de sous le comptoir, façon Calamity Jane, et le braque sur la porte.
« Stop, dit-elle à la femme qui tremble sur le seuil. Qui êtes-vous ?
— Ça va, ce n’est rien, dis-je en descendant de mon tabouret, trébuchant, me précipitant. Je la connais.
— Il est revenu , Henry, m’annonce Martha, fébrile, suppliante, le teint coloré, rosé. Brett est venu à la maison. »
* * *
Je parviens à asseoir Martha Milano sur mon guidon et à pédaler jusque chez elle comme si nous étions des amoureux de l’ancien temps. Une fois que nous sommes entrés, une fois qu’elle a claqué la porte et fermé toute la colonne de verrous de haut en bas, elle file droit à la cuisine et au placard, celui qui contient les cartouches de cigarettes… puis s’interrompt, se tape sur la cuisse, bat en retraite vers le canapé, où elle s’effondre.
Читать дальше