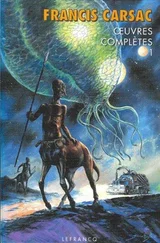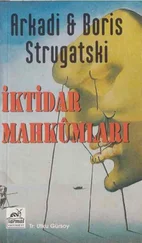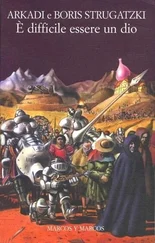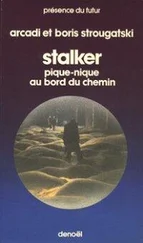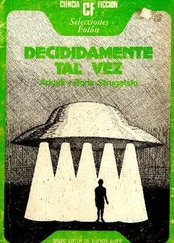— Oui. Vous ne devriez pas sortir aujourd’hui …
— Écoute-moi. Si dans trois jours je ne suis pas revenu, prends Kira et conduis-la dans la saïva, au bois du Hoquet. Tu sais où c’est ? Là, tu trouveras la Tanière de l’Ivrogne, une cabane, pas très loin de la route. Tu demanderas, on t’indiquera. Seulement, ne demande pas à n’importe qui. Il y a là un homme qu’on appelle le père Kabani. Raconte-lui tout. Tu as compris ?
— Oui. Mais ce serait mieux si vous restiez …
— Je voudrais bien. Mais je ne peux pas : le service … Bon, fais attention, hein ? … »
Il lui donna une légère chiquenaude sur le nez et sourit en réponse à son sourire embarrassé. En bas, il prononça un petit discours pour réconforter les domestiques, sortit et se retrouva dans l’obscurité. Derrière lui les verrous grincèrent.
Les appartements du prince avaient toujours été mal gardés. Pour cette raison, peut-être, personne n’avait jamais attenté à la vie des enfants royaux d’Arkanar. Quant au prince actuel, il n’intéressait personne. Nul ne se souciait de ce gosse souffreteux, aux yeux bleus, qui ne ressemblait en rien à son père. Le petit garçon plaisait à Roumata. Son éducation avait été conçue de façon exécrable, aussi était-il très réfléchi ; il n’était pas cruel, ne pouvait souffrir don Reba, aimait chanter à pleine voix des chansons de Tsouren et faire voguer de petits bateaux. Roumata faisait venir pour lui, de la métropole, des livres d’images, lui expliquait le ciel étoilé et avait définitivement conquis le petit garçon en lui parlant de vaisseaux volants. Pour lui qui voyait peu d’enfants, le prince de dix ans était l’antipode de toutes les couches sociales de ce pays barbare. C’était justement de ces petits garçons aux yeux bleus, identiques dans tous les milieux, que naissaient ensuite la cruauté, l’ignorance, la docilité, et pourtant il n’y avait en eux aucune trace, aucun germe de ces laideurs. Il se disait quelquefois que ce serait magnifique si tous les plus de dix ans disparaissaient de la planète.
Le prince dormait déjà. Roumata, debout à côté de l’officier qu’il relevait, près du petit garçon endormi, accomplit, avec ses épées nues, les gestes compliqués qu’exigeait l’étiquette ; il vérifia, selon l’usage, que les fenêtres étaient bien fermées, que les gouvernantes étaient toutes là, que les lampes brûlaient dans toutes les pièces. Revenu dans l’antichambre, il fit une partie de dés avec l’officier qu’il remplaçait et lui demanda ce qu’il pensait de ce qui se passait en ville. Le gentilhomme, personnage d’un grand esprit, réfléchit profondément et émit la supposition que le peuple se préparait à fêter la Saint-Mika.
Resté seul, Roumata approcha un fauteuil de la fenêtre, s’installa commodément et contempla la ville. La demeure du prince était située sur une éminence d’où l’on voyait Arkanar jusqu’à la mer. Mais à cette heure, tout était plongé dans les ténèbres, piquetées çà et là de bouquets de lumière. C’étaient les torches des Troupes d’Assaut, rassemblées aux carrefours et attendant le signal convenu. La cité dormait ou faisait semblant. Les habitants se rendaient-ils compte que quelque chose d’effroyable se préparait cette nuit ? Ou bien pensaient-ils, comme le gentilhomme de grand esprit, qu’on allait fêter la Saint-Mika ? Deux cent mille hommes et femmes, deux cent mille forgerons, armuriers, bouchers, merciers, joailliers, bourgeoises, prostituées, moines, changeurs, soldats, vagabonds, lettrés rescapés se retournaient dans leurs lits étouffants qui sentaient la punaise, dormaient, s’aimaient, supputaient leurs bénéfices, pleuraient, grinçaient des dents de colère ou d’humiliation … Deux cent mille personnes. Il y avait en elles quelque chose de commun pour un envoyé de la Terre. Presque tous sans exception n’étaient pas encore des hommes au sens actuel du mot, mais de la matière brute, gueuse, que seuls des siècles d’histoire sanglante transformeraient en hommes fiers et libres. Ils étaient passifs, cupides et invraisemblablement, fantastiquement égoïstes. Sur le plan psychologique, presque tous étaient des esclaves : esclaves d’une foi, de leurs semblables, de leurs passions mesquines, esclaves de leur cupidité, et si par la volonté du destin, quelqu’un d’entre eux naissait ou devenait un maître, il ne savait que faire de sa liberté, s’empressait de se faire l’esclave de sa richesse, de choses superflues, d’amis débauchés, esclave de ses esclaves. L’énorme majorité d’entre eux n’était en rien coupable. Ils étaient trop passifs, trop ignorants. L’esclavage prenait sa source dans leur passivité et leur ignorance, et celles-ci à leur tour engendraient l’esclavage. S’ils avaient tous été semblables, tout espoir aurait été vain, le courage aurait manqué pour se mettre à la tâche. Mais tous étaient des hommes, porteurs d’une étincelle de raison, et tantôt ici, tantôt là, s’allumaient en eux les petites lueurs d’un avenir incroyablement éloigné mais proche. S’allumaient envers et contre tout. En dépit de leur apparente inutilité. En dépit de l’oppression et du fait qu’ils étaient traînés dans la boue. Bien que personne ne se souciât de ces hommes et que tous fussent contre eux. Bien qu’au meilleur des cas ils pussent compter sur une pitié méprisante et étonnée …
Ils ne savaient pas que l’avenir était avec eux, que l’avenir, sans eux, était impossible. Ils ne savaient pas que dans ce monde de fantômes terrifiants du passé ils étaient l’unique réalité du futur, qu’ils étaient le ferment, la vitamine de l’organisme social. Détruisez cette vitamine, la société se gangrène, c’est le début d’un scorbut social, les muscles faiblissent, la vue baisse, les dents tombent. Aucun État ne peut se développer à l’écart de la science, ses voisins l’anéantiraient. Sans arts et sans culture, un État n’est plus capable de pratiquer l’autocritique, il commence à encourager des tendances erronées, engendre à chaque seconde des hypocrites et des crapules, développe chez ses citoyens l’instinct de consommation et la présomption, pour finir, quand même, victime de voisins plus intelligents. Il est possible de persécuter longtemps les hommes de savoir, d’interdire les sciences, de détruire l’art, mais tôt ou tard, il faut se reprendre, et à son corps défendant, laisser le chemin libre à tout ce que détestent tellement les despotes et les ignorants obtus. Les hommes gris qui sont au pouvoir ont beau mépriser la science, ils ne peuvent rien contre l’objectivité historique, ils peuvent freiner mais non arrêter le mouvement. Craignant le savoir, ils finissent toujours par l’encourager dans l’espoir de se maintenir. Tôt ou tard, ils sont contraints d’autoriser les universités, les sociétés scientifiques, de créer des centres de recherche, des observatoires, des laboratoires, de former des cadres, hommes de pensée et de savoir lesquels échappent à leur contrôle, lesquels ont une mentalité totalement différente, des besoins totalement différents. Ces hommes ne peuvent vivre, et encore moins travailler, dans une atmosphère de basse cupidité, de mesquinerie, d’autosatisfaction béate, de besoins strictement physiologiques. Il leur faut une autre atmosphère, de savoir universel, de tension créatrice, ils ont besoin d’écrivains, d’artistes, de musiciens. Les hommes gris sont obligés de céder sur ce point aussi. Ceux qui s’entêteront seront éliminés par des rivaux plus rusés, mais ceux qui cèdent, inévitablement et paradoxalement, creusent leur propre tombe. Car l’élévation du niveau culturel du peuple, dans tous les domaines, depuis les progrès des sciences naturelles jusqu’à l’amour de la musique, est mortelle pour les égoïstes incultes et les fanatiques … Puis vient une époque de gigantesques ébranlements sociaux, qu’accompagne un développement inouï de la science, et en corollaire, un très vaste phénomène d’intellectualisation de la société ; alors, la grisaille livre un dernier combat, dont la cruauté ramène l’humanité au Moyen Âge, elle subit une défaite, et disparaît pour toujours en tant que force réelle.
Читать дальше