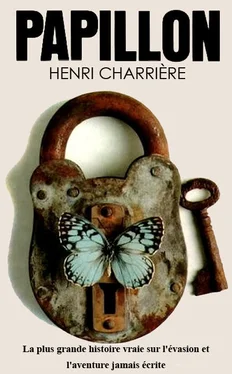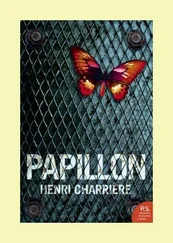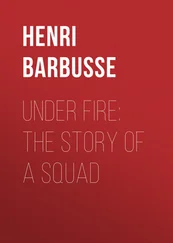1 ...5 6 7 9 10 11 ...161 …Une, deux, trois, quatre, cinq… quatorze heures de marche. Pour bien acquérir l’automatisme de ce mouvement continu, il faut apprendre à baisser la tête, les mains derrière le dos, ne marcher ni trop vite ni trop doucement, bien faire des pas de même dimension et tourner automatiquement, à un bout de la cellule sur le pied gauche et à l’autre bout sur le pied droit.
Une, deux, trois, quatre, cinq… Les cellules sont mieux éclairées qu’à la Conciergerie et on entend les bruits extérieurs, ceux du quartier disciplinaire, et aussi certains qui nous arrivent de la campagne. La nuit on perçoit les sifflements ou les chansons des ouvriers de la campagne qui rentrent chez eux contents d’avoir bu un bon coup de cidre.
J’ai eu mon cadeau de Noël : par une fissure des planches qui bouchent la fenêtre, j’aperçois la campagne toute blanche de neige et quelques gros arbres noirs éclairés par une grosse lune. On dirait une de ces cartes postales typiques pour la Noël. Secoués par le vent, les arbres se sont débarrassés de leur manteau de neige et, grâce à cela, on les distingue bien. Ils se découpent en grosses taches sombres sur le reste. C’est Noël pour tout le monde, c’est même Noël dans une partie de la prison. Pour les bagnards en dépôt, l’Administration a fait un effort : on a eu le droit d’acheter deux barres de chocolat. Je dis bien deux barres et non deux tablettes. Ces deux morceaux de chocolat d’Aiguebelle ont été mon réveillon de 1931.
…Une, deux, trois, quatre, cinq… La répression de la Justice m’a transformé en balancier, l’aller et retour dans une cellule est tout mon univers. C’est mathématiquement calculé. Rien, absolument rien, ne doit être laissé dans la cellule. Il ne faut surtout pas que le condamné puisse se distraire. Si j’étais surpris à regarder à travers cette fente du bois de la fenêtre, j’aurais une sévère punition. Au fait, n’ont-ils pas raison, puisque je ne suis pour eux qu’un mort vivant ? De quel droit me permettrais-je de jouir de la vue de la nature ?
Un papillon vole, il est bleu clair avec une petite raie noire, une abeille ronronne non loin de lui, près de la fenêtre. Que viennent chercher ces bêtes à cet endroit ? On dirait qu’elles sont folles de ce soleil d’hiver, à moins qu’elles aient froid et veuillent entrer en prison. Un papillon en hiver est un ressuscité. Comment n’est-il pas mort ? Et cette abeille, pourquoi a-t-elle quitté sa ruche ? Quel culot inconscient de s’approcher d’ici. Heureusement que le prévôt n’a pas d’ailes, car ils ne vivraient pas longtemps.
Ce Tribouillard est un horrible sadique et je pressens qu’il m’arrivera quelque chose avec lui. Je ne m’étais malheureusement pas trompé. Le lendemain de la visite de ces deux charmants insectes, je me fais porter malade. Je n’en peux plus, j’étouffe de solitude, j’ai besoin de voir un visage, d’entendre une voix, même désagréable, mais enfin une voix, d’entendre quelque chose.
Tout nu dans le froid glacial du couloir, face au mur, mon nez à quatre doigts de lui, j’étais l’avant-dernier d’une file de huit, attendant mon tour de passer devant le docteur. Je voulais voir du monde… eh bien, j’ai réussi ! Le prévôt nous surprit au moment où je murmurais quelques mots à Julot, dit l’homme au marteau. La réaction de ce sauvage rouquin fut terrible. D’un coup de poing derrière ma tête, il m’assomma à moitié et, comme je n’avais pas vu venir le coup, je suis allé frapper du nez contre le mur. Le sang jaillit et après m’être relevé, car je suis tombé, je me secoue et essaye de réaliser ce qui m’est arrivé. Comme j’esquisse un geste de protestation, le colosse qui n’attendait que cela, d’un coup de pied dans le ventre m’étend à nouveau à terre et commence à me cravacher avec son nerf de bœuf. Julot ne peut supporter cela. Il lui saute dessus, une terrible bagarre s’engage et comme Julot a le dessous, les gardiens assistent impassibles à la bataille. Personne ne s’occupe de moi qui viens de me relever. Je regarde autour si je ne vois rien comme arme. Tout à coup, j’aperçois le docteur penché sur son fauteuil, essayant de voir de la salle de visite ce qui se passe dans le couloir et, en même temps, le couvercle d’une marmite qui se soulève sous la poussée de la vapeur. Cette grosse marmite en émail est posée sur le poêle à charbon qui chauffe la salle du docteur. Sa vapeur doit servir à purifier l’air, certainement.
Alors, d’un réflexe rapide j’attrape la marmite par ses oreilles, je me brûle mais ne lâche pas prise et, d’un seul coup, je jette cette eau bouillante à la figure du prévôt qui ne m’avait pas vu tant il était occupé avec Julot. Un cri épouvantable sort de la gorge du bougre. Il est bien touché. Il se roule par terre et comme il porte trois tricots de laine, il se les arrache difficilement, l’un après l’autre. Quand il arrive au troisième, la peau vient avec. Le cou du maillot est étroit et dans son effort pour le faire passer, la peau de la poitrine, une partie de celle du cou et toute celle de la joue viennent, collées au maillot. Il a été brûlé aussi à son unique œil et est aveugle. Enfin il se relève, hideux, sanguinolent, les chairs à vif et Julot en profite pour lui porter un coup de pied terrible en pleines couilles. Il s’écroule, le géant, et se met à vomir et à baver. Il a son compte. Nous, on ne perd rien pour attendre.
Les deux surveillants qui ont assisté à la scène ne sont pas assez gonflés pour nous attaquer. Ils sonnent l’alarme pour du renfort. Il en arrive de tous les côtés et les coups de matraque pleuvent sur nous gros comme de la grêle. J’ai la chance d’être très vite assommé, ce qui m’empêche de sentir les coups.
Je me retrouve deux étages plus bas, complètement nu, dans un cachot inondé d’eau. Lentement je reprends mes sens. Ma main parcourt mon corps douloureux. Sur ma tête il y a au moins douze à quinze bosses. Quelle heure est-il ? Je ne sais pas. Ici il n’y a ni nuit ni jour, pas de lumière. J’entends des coups contre le mur, ils viennent de loin.
Pan, pan, pan, pan, pan, pan. Ces coups sont la sonnerie du « téléphone ». Je dois moi-même frapper deux coups contre le mur si je veux recevoir la communication. Frapper, mais avec quoi ? Dans le noir, je ne distingue rien qui puisse me servir. Avec les poings c’est impossible, leurs coups ne se répercuteraient pas assez. Je m’approche du côté où je suppose que se trouve la porte, car c’est un peu moins noir. Je me heurte contre des barreaux que je n’avais pas vus. En tâtonnant je me rends compte que le cachot est fermé par une porte distante de moi de plus d’un mètre, à laquelle une grille, celle que je touche, m’empêche de parvenir. Ainsi, quand quelqu’un entre chez un prisonnier dangereux, celui-ci ne peut pas le toucher car il est dans une cage. On peut lui parler, le mouiller, lui jeter à manger et l’insulter sans aucun danger. Mais, avantage, on ne peut pas le frapper sans se mettre en danger car, pour le frapper, il faut ouvrir la grille.
Les coups se répètent de temps en temps. Qui peut bien m’appeler ? Il mérite que je lui réponde, ce type, car il risque gros s’il est pris. En marchant, je manque me casser la gueule. J’ai mis mon pied sur quelque chose de dur et de rond. Je touche, c’est une cuillère en bois. Vite, je la saisis et m’apprête à répondre. L’oreille collée au mur, j’attends. Pan, pan, pan, pan, pan-stop, pan, pan. — Je réponds : pan, pan. Ces deux coups veulent dire à celui qui appelle : Vas-y, je prends la communication. Les coups commencent : pan, pan, pan… les lettres de l’alphabet défilent rapidement… abcdefghijklmnop , stop. Il s’arrête à la lettre p . Je frappe un grand coup : pan. Il sait ainsi que j’ai enregistré la lettre p, puis vient un a , un p , un i , etc. Il me dit : « Papi ça va ? Tu es bien touché moi j’ai un bras cassé. » C’est Julot.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу