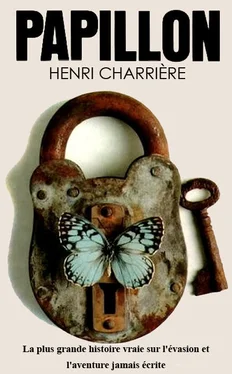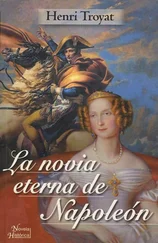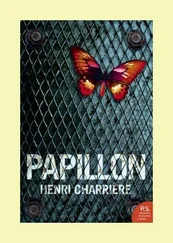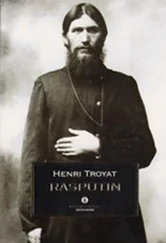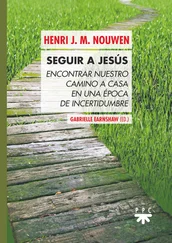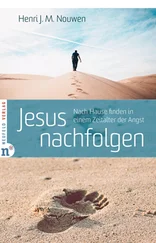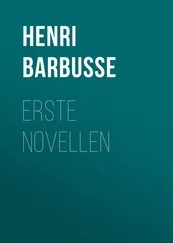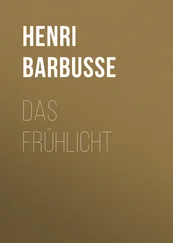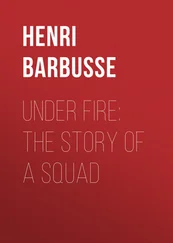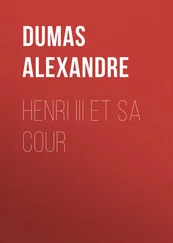Il semble donc que le texte à la fois narratif et non documentaire, objectif et poétique, fait de mémoire ou d’imagination (car en l’espèce la différence importe peu) ne puisse réapparaître désormais que de façon sporadique, de loin en loin, en quelques livres aberrants, imprévisibles, hors l’histoire, impossibles à susciter, à prévoir. Sans doute, également, la force d’évocation visuelle et événementielle, et non point sa contrefaçon au niveau du langage, jouit-elle d’une sorte de dispense qui permet de braver les écoles et les conjonctures littéraires — sans le savoir, bien sûr. Sans doute aussi ne trouve-t-on, dans ce cas l’écriture que pour ne l’avoir jamais eue, ou le langage pour l’avoir toujours eu. Car il s’agit en fait ici de langage, je veux dire de langage oral, et non d’écriture. Dans Papillon, l’écriture est un succédané de la parole, elle n’en est pas le dépassement, la transmutation, comme dans la littérature savante. La vigueur narrative de Charrière relève de la littérature orale, celle qui ne devient littérature que par la nécessité de « noter » le récit, pour qu’il ne soit pas perdu. Mais le rythme profond de la conception et de l’expression est celui du verbe et c’est cela qu’il faut chercher à retrouver en lisant, exactement comme on lit une partition, qui n’est pas un but en soi, mais un moyen de reconstituer et d’exécuter la substance musicale dans son intégralité. Je n’ai d’ailleurs jamais eu un tel sentiment aveuglant de la différence entre le français écrit et le français parlé qu’en lisant Papillon. Il s’agit véritablement de deux langues différentes. Non point tant par l’usage de l’argot ou d’un vocabulaire familier que par des divergences capitales dans la syntaxe, les tournures, la charge affective des mots. Les reconstitutions littéraires de la langue parlée, chez Céline par exemple, souffrent précisément de ne pas porter la marque de la spontanéité. D’autre part, il est d’une rareté extrême que le français parlé puisse, sans truquage, aboutir à une œuvre achevée. Devant la page à écrire, le génie populaire se croit généralement obligé de faire appel aux quelques bribes qu’il connaît du français littéraire. Il perd sur les deux tableaux. (C’est ce qu’on appelle méchamment des « romans d’autodidacte ».) Pour franchir ce barrage redoutable — la culture écrite — sans s’en apercevoir, en gardant la totalité de ses ressources narratives comme si l’on parlait, il faut cette innocence rusée qui fut celle du Douanier Rousseau, et que possède Papillon, l’intemporel « conteur qui prend place au pied du térébinthe ».
FIN
10.000 francs de 1932, soit environ 5.000 francs 1969.
Aux durs : au bagne, là où sont envoyés les durs.
Exécuteur des hautes œuvres en 1932.
Quatre cent cinquante grammes de pain et un litre d’eau.
Aux durs : au bagne, là où sont envoyés les durs.
Tiges de fer sur lesquelles coulissent les fers qu’on met aux pieds des prisonniers punis.
Trad. Robert Latonche. Certaines expressions auraient d’ailleurs pu être traduites dans une langue populaire dont je parlerai plus bas à propos de celle de Papillon.« Crapulatus a vino », par exemple.
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу