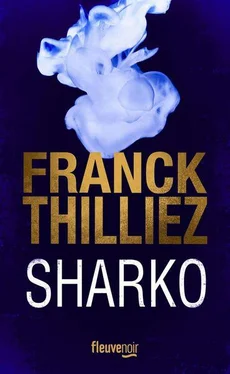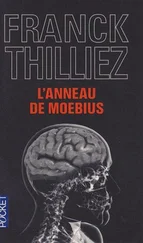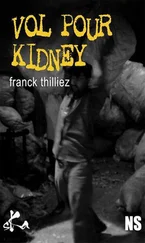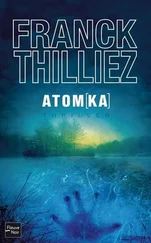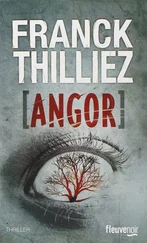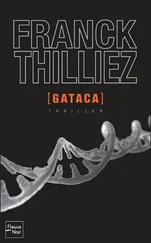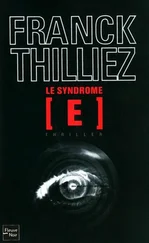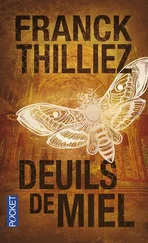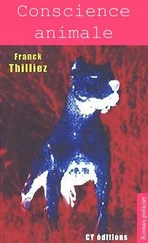Le pire n’était ni ce circuit de la mort ni la cruauté de l’acte — contrairement à Robillard, Sharko ne crachait pas sur un bon morceau de viande —, mais ces employés en blouse blanche, masse de casques jaunes imprimant des gestes las, automatiques, qui pourtant arrachaient des centaines de vies par jour. De vrais médecins légistes alimentaires dont certains, parfois, pétaient les plombs, s’acharnaient sur les bêtes, acteurs pervers de scandales filmés et incendiaires mis sur Internet.
Il observa les gros flux de lave rouge qui bouillonnaient à travers les grilles — des litres et des litres par seconde — et ne put s’empêcher de faire le rapprochement avec la victime du château d’eau : vidée comme un animal qu’on saigne.
Ils redescendirent et gagnèrent une immense salle où les cadavres suspendus avançaient avec langueur à la file indienne. Les couteaux dans les mains de trois personnes masquées brillaient sous l’éclat des lampes, dépeçant les ventres, creusant les chairs de mouvements presque artistiques. Bruits de découpe, de déchirure — de ceux qu’on ne peut supporter, comme la craie crissant sur un tableau — au milieu du ronflement des machines. Chutes de panses, de tripes, de boyaux dans des bacs qui eux-mêmes circulaient sur des rouleaux bien huilés, tandis que les carcasses allégées poursuivaient leur périple dans une autre direction, pour subir un nouveau sort. « Tout est bon, dans le cochon », disait l’adage.
Il fallut moins d’un souffle pour qu’un des trois individus au travail se mette soudain à courir le long des rails. Des bacs d’abats giclèrent sur son passage. Sharko et Robillard brandirent leur arme.
— Bougez pas !
À la vue des pistolets, les autres ouvriers se mirent à pousser des cris et à courir comme des insectes paniqués. La silhouette disparaissait déjà derrière une porte. Franck balança son casque et s’élança à sa poursuite. Après une glissade, il faillit s’étaler dans le sang renversé. Lanières de plastique en pleine figure, il fonça droit devant, tête baissée comme un taureau. Mayeur chevauchait agilement des tapis, des plans de découpe, repoussant des carcasses qui s’agitaient comme des sacs de frappe. Malgré sa taille menue, elle bouscula d’un violent coup d’épaule l’un des employés planté sur son chemin.
Sharko esquivait, s’agrippait, empli de hargne et de colère. Il la prit en chasse sur l’asphalte du parking, souffle court, alors qu’elle escaladait déjà les grillages, parvint à lui agripper le pied, tira d’un coup sec vers lui. Elle s’écrasa sur une bande d’herbe, et le flic pesa de tout son poids sur elle pour l’immobiliser. Bref coup d’œil vers l’arrière : Robillard manquait à l’appel. Alors, il retourna sans ménagement la jeune femme, qui le fixa d’un regard apeuré, les yeux noirs et profonds comme des orbites creuses de porc.
Et Sharko eut alors la certitude qu’elle ne le connaissait pas.
— J’ai rien fait.
Il la retourna comme une crêpe et lui enfila les pinces.
— Moi non plus.
Pas de réaction par rapport à la voix. Parfait. Il pouvait passer à l’étape suivante en toute sérénité.
— On est le vendredi 25 septembre, 10 h 48. À partir de maintenant, t’es en garde à vue.
Le laboratoire de toxicologie-stupéfiant se partageait les bâtiments avec l’Institut médico-légal, place Mazas, le long du quai de la Rapée. Tout transitait entre ces murs, en provenance de l’ensemble des services de police : drogue, produits illégaux, fluides corporels, mèches de cheveux, prises de sang. Rares étaient les affaires criminelles qui n’avaient pas recours aux limiers capables de vous dire, en analysant vos cheveux, les stupéfiants que vous aviez consommés six mois plus tôt et pendant combien de temps. Rien n’échappait à leur vigilance ni au flair de leurs machines.
Avant de s’y rendre, Lucie et Nicolas en profitèrent pour aller voir Chénaix, qui détenait les premiers retours de l’anapath : douze plaies sur les vingt et une avaient pour le moment été analysées, et toutes avaient été réalisées post mortem. Quant aux sangsues insérées dans les blessures, elles avaient préalablement été gorgées de sang animal et non humain, dont l’espèce restait à définir. Pour Nicolas, il s’agissait à l’évidence de sang de chat, vu les découvertes dans le jardin. Donc Lucie disait vrai : tout résultait d’une mise en scène après la mort, destinée à les tromper.
Restait à comprendre pourquoi Jack avait agi de la sorte.
— Il y a un dernier truc avant que vous partiez, ajouta Chénaix. Ça concerne le cerveau de Ramirez, que j’ai découpé en tranches. Il semblerait qu’il y ait une infime région située dans les lobes temporaux qui ne soit pas normale.
— Qu’est-ce que ça signifie, pas normale ?
— Spongieuse, comme rongée. Mais je ne suis pas un spécialiste du cerveau, impossible de vous en dire davantage sans des examens approfondis en laboratoire. Ça peut être n’importe quoi. Ramirez était peut-être atteint d’une maladie neurodégénérative, ou d’une infection, ou de je ne sais quel cancer. Là aussi, je vous tiendrai au courant mais, franchement, ça risque de prendre un peu de temps. Les examens s’accumulent, nos labos ne sont pas extensibles, et savoir quelle maladie portait ce type avant de mourir n’est pas vraiment une priorité pour l’anapath.
— Essaie de ne pas oublier quand même…
Les policiers le remercièrent et changèrent de pièce. À présent, ils se tenaient debout devant une paillasse encombrée de binoculaires, de lamelles de verre, de fioles et de liquides colorés. Le chimiste à leurs côtés, Angel Vigo, était une tige de presque deux mètres, au dos un peu voûté à force de se pencher sur les éprouvettes et les microscopes. Il portait la blouse, boutonnée jusqu’au col comme s’il s’agissait d’un corset ou d’une camisole, des baskets blanches et de petites lunettes rondes à la Steve Jobs.
Lucie fixait le râtelier de treize éprouvettes trouvé chez Ramirez. Des larmes… Elle se demanda combien de temps il fallait pleurer pour les remplir une à une. Combien de larmes Laëtitia avait-elle versées, enchaînée à son radiateur, et dans quelles conditions ? Parce qu’elle en était certaine avant même que le spécialiste ouvre la bouche : ces larmes appartenaient à la jeune fille au petit anneau dans le nez.
Vigo prit l’un des tubes et le mit entre les mains de Nicolas.
— Je préférais que vous veniez, parce que… c’est peu commun, ce que je vais vous expliquer, et a priori très grave. Je n’avais jamais eu affaire à ce genre de cas. D’ordinaire, on analyse le sang, les cheveux, les poils. Mais des larmes, c’est la première fois.
Nicolas observa le contenu translucide. Qui avait-il de plus intime que des larmes ? Il se rappelait cette trappe, planquée à l’étage. Cette niche secrète. À qui appartenait le contenu de ces tubes de verre ?
— Il faut savoir que les larmes sont très riches en composants chimiques. Chlorure de sodium, enzymes, lipides, protéines et même des hormones, comme la leucine, la prolactine… Bref, elles transportent un véritable microcosme de notre expérience, de notre vécu. Elles nous racontent toutes une histoire. On est capable aujourd’hui de différencier trois types de larmes : les larmes basales, réflexes ou psychiques. Ça vous parle ?
Les deux flics haussèrent les épaules. Ça voulait dire : oui et non.
— Les larmes basales sont les plus communes, elles sont produites par l’organisme pour lubrifier nos yeux. Les larmes réflexes sont celles provoquées pour défendre l’œil suite à une agression extérieure, comme le vent, le froid, un objet… Quant aux larmes psychiques, elles surviennent à partir d’émotions, pas besoin de vous faire un dessin : tristesse, rire, déception… On connaît tous ça. Ce sont plus particulièrement celles-là qui nous intéressent.
Читать дальше