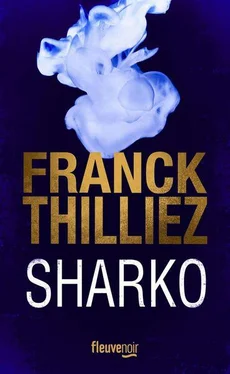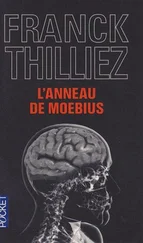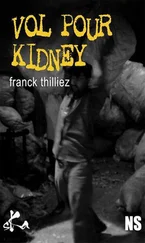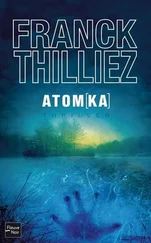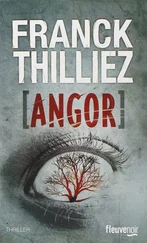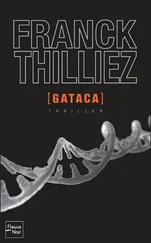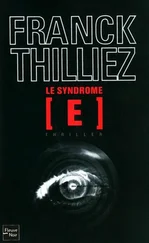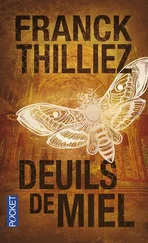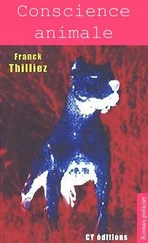En 1966 — leur vampire avait alors une dizaine d’années —, le nom du père réapparaissait à l’université médicale de Houston, au Texas, où il travaillait sur les maladies neurodégénératives. Peut-être portait-il la variante du koroba dans ses veines et l’étudiait-il, mais on ne le saurait jamais : il était mort dans cette même ville en 1977 d’un cancer du pancréas.
Quant à Raphaël Merlin, le fils… Pas grand-chose sur lui pour le moment. Juste un nom sur des documents, quelques photos : rien sur sa jeunesse, études dans une université de médecine à Houston en 1976, trace dans l’organigramme de Plasma Inc. en 1980, puis dans celui de Cerberius en 1988. Présence en France en 2001, achat de l’appartement dans le 16 e en 2002, de la résidence secondaire de Dieppe en 2005. En 2007, il créait Helikon.
De longues recherches permettraient peut-être de combler tous les vides, de retracer les chemins maudits du père et du fils, de comprendre comment des hommes pouvaient en arriver à accomplir de telles horreurs. Le père avait-il volontairement semé la graine du mal dans l’âme de son fils, ou Raphaël Merlin avait-il plongé de lui-même dans les ténèbres après la mort de son géniteur, la bombe du koroba entre les mains ? Mev, la jumelle, finirait-elle par développer la maladie de son frère ? Peut-être faudrait-il, un jour, tenter de lui expliquer ses origines. Son psychiatre déciderait de ce qui serait le mieux pour elle.
Père et fils étaient morts, les membres de la secte Pray Mev aussi, mais pas la maladie. La catastrophe sanitaire déployait ses grandes ailes noires sur le monde. On cherchait les malades atteints par la variante du koroba, on rappelait des stocks de sang et les moindres lots de produits dérivés aux origines douteuses — on avait surtout retracé les poches des donneurs identifiés de Pray Mev. La France était pointée du doigt, et plus aucun produit dérivé du sang ne sortait du pays.
Ironiquement, la société de Merlin, Helikon, vit ses commandes croître de façon exponentielle — elle disposait de la seule parade actuelle sur le marché contre le koroba —, ce qui fit la joie de ses employés dont l’enquête n’avait révélé aucune implication. Mais les dons du sang avaient drastiquement chuté, et les malades refusaient qu’on les transfuse. La paranoïa était bel et bien présente en ce début novembre 2015, et cette forme d’attaque microbiologique, greffée au climat déjà bien pesant, rendait l’atmosphère irrespirable. La population avait peur. Dix mois après, Charlie était encore dans les esprits et l’air crépitait comme le gaz échappé d’une bouteille de butane. À la moindre étincelle, le pays s’embraserait.
La chanson se termina, le DJ enchaîna sur un air plus rythmé, et les invités envahirent la piste. Jacques se déhancha comme jamais, Pascal piochait dans les amuse-gueules, à la recherche de toasts au saumon dont il abandonnait en toute discrétion le pain sur un coin de table, Nicolas fumait dehors, seul.
Lucie se serra contre son homme.
— Lucie Sharko, je crois que ça va me faire tout drôle.
— Va falloir t’y habituer, pourtant.
— Je ne sais pas si j’y arriverai. Il n’y a qu’un seul Sharko.
La plupart des éléments de ce roman sont avérés et basés sur une solide documentation scientifique ou issus de rencontres faites au gré de mes recherches. Tout ce qui est décrit autour du sang — son histoire, ses maladies, le circuit du don, le bio-art et ses étranges peintures… — est vrai. En revanche, ne cherchez pas le koroba, les Banaru ou les Sorowai sur Internet ni ailleurs, vous ne les trouverez pas, ils sont pure fiction.
Pure fiction ? Pas tant que cela, toute réflexion faite. Mon cerveau de conteur d’aventures s’est juste appuyé sur les épopées peu communes de ces hommes aventureux qui, par leur courage, leur acharnement et leur goût de la découverte, font avancer l’humanité. La cruauté de mes personnages et de mon récit m’a fait tout naturellement m’éloigner d’eux.
Permettez-moi néanmoins de vous exposer, en deux pages, les faits exacts qui m’ont en partie inspiré.
En 1957, Michael Alpers, un étudiant en médecine australien, entendit parler d’une grave affection neurologique spécifique aux Fore, une tribu de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Les anthropologues qui avaient voyagé dans ces contrées encore inconnues racontaient que les individus atteints tremblaient, riaient et perdaient l’équilibre. Cette maladie, bien vite baptisée le kuru, « la morte riante », était associée par les Fore au pouvoir des sorciers ennemis.
Alpers passa une bonne partie de sa vie auprès des Fore, à essayer de comprendre le mal qui les frappait eux, et seulement eux. Après des années, un autre aventurier le rejoignit, le virologue américain Daniel Carleton Gajdusek, seul autre chercheur décidé à cerner ce terrible mal. Les deux hommes découvrirent alors, pour la première fois, une maladie neurodégénérative transmissible d’humain à humain, que les indigènes contractaient en ingérant le cerveau de leurs défunts lors de leurs rites anthropophages.
Leur immense découverte fut publiée en 1966. Ils affirmèrent que le tout premier cas était apparu de façon spontanée et firent ensuite le rapprochement avec une maladie très rare, dont tout le monde se désintéressait à l’époque parce qu’il n’y avait eu que quelques cas recensés depuis sa découverte quarante ans plus tôt : la maladie de Creutzfeldt-Jakob. Les deux hommes décidèrent alors de se pencher sur la MCJ : était-elle transmissible ? Comme ils l’avaient fait pour le kuru, ils injectèrent les cellules cérébrales d’une victime de Creutzfeldt-Jakob à des chimpanzés. Les singes contractèrent la maladie.
Ils prouvèrent ainsi le caractère transmissible de la MCJ. Daniel Carleton Gajdusek établit que le responsable n’était ni un virus connu ni une bactérie identifiée, et qu’il était mille fois plus petit qu’un agent pathogène classique. Il obtint le prix Nobel de médecine en 1976 pour la découverte d’un « virus non conventionnel ».
Plus tard, Stanley Ben Prusiner, un neurologue américain, mit un nom sur ce « virus non conventionnel » : le prion, qui n’avait rien d’un virus, en fait. Il décrivit ainsi le premier nouvel agent pathogène depuis un siècle et obtint le Nobel en 1997 pour ses travaux sur les prions.
Vingt-cinq ans après l’arrêt des pratiques cannibales imposé par le gouvernement australien, une trentaine de Fore déclaraient encore la maladie. De nos jours, un ou deux cas par an continuent à apparaître : des individus de 70, 80 ans qui, jeunes enfants, ont mangé des cerveaux malades. Cela prouve que les délais d’incubation du kuru peuvent être de plus de cinquante ans.
En 1985, une pratique cannibale moderne faisait trembler le monde entier : la maladie de la vache folle a été propagée par les fameuses farines animales, constituées, entre autres, de cerveaux broyés. Dix ans plus tard, on constatait que la maladie était passée à l’homme qui, en bon consommateur des vaches incubant la maladie, mangeait lui-même, en quelque sorte, les cellules cérébrales défectueuses. On l’appelait « la variante de la maladie de Creutzfeldt-Jakob ».
Depuis 1995, cent cinquante personnes l’ont contractée en Grande-Bretagne, après avoir avalé de la viande bovine infectée. Mais on soupçonne, à l’identique du kuru, des délais d’incubation pouvant atteindre cinquante, voire cent ans ! Combien de personnes sont réellement infectées et mourront sans que la maladie se déclare ? Qu’en est-il des dons — organes, sang, tissus — qu’ont pu faire ces personnes ?
Читать дальше