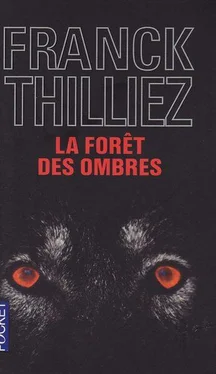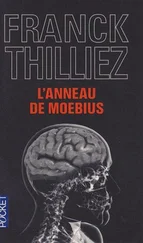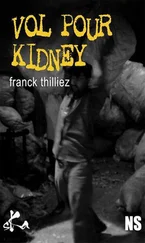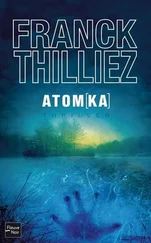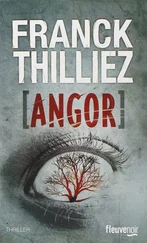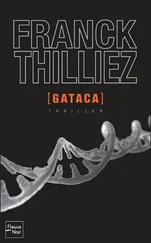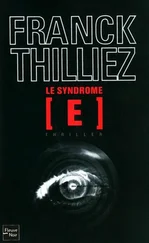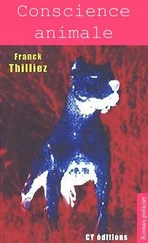Les autres fiches reprenaient plus ou moins la même thématique. Cette histoire de greffe. La manie des chiffres. La volonté de tout peser, de dénombrer. Et la peur grandissante de se déplacer, par souci d’économiser ses propres battements cardiaques.
David se plaqua les mains sur le visage et expira bruyamment. Durant tous ces entretiens, Bourne avait menti à Doffre.
Et, à la vue du rapport d’autopsie, des notes des policiers, Doffre l’avait forcément découvert. Qu’avait-il alors ressenti ? De la colère ? De la rancœur ?
Pour quel motif Bourne était-il allé le voir, dans ce cas ? Pourquoi avoir inventé cette incroyable histoire de battements détraqués ? Pourquoi un psychologue ?
Pourquoi Arthur Doffre ?
C’était incompréhensible. Purement et simplement incompréhensible. La théorie des pulsations cardiaques sur les crânes des enfants semblait pourtant si plausible ! À présent, tout s’effondrait. Retour à la case départ.
David revint aux photocopies des notes concernant l’environnement de l’assassin. Petit pavillon, gazon parfaitement entretenu et coupé à ras — le souci de la précision —, dans un quartier tranquille. Très peu de meubles, une télévision, une radio, des piles de quotidiens. Une maison des plus normales pour un célibataire, et une hygiène de vie soignée. Poubelles toutes vides, lit fait au carré. Dans sa chambre, la balance de Roberval et la plume de Mâat. Aidés de Luminol, les techniciens de la police scientifique avaient réussi à détecter, sur les plateaux en cuivre, du sang vieux de plusieurs mois, appartenant au même groupe que celui de la dernière victime, Patricia Böhme. Les outils de torture, les cordes et les bougies servant à asphyxier ses proies étaient précieusement étalés sur une table basse, tous orientés dans la même direction, bien parallèles, et positionnés à proximité du lit. Probablement un moyen de prolonger les fantasmes, de ramener les cadavres sous ses draps.
Contrairement à la plupart des tueurs en série, Bourne n’était pas un collectionneur. Aucune photographie, nul souvenir — mèche de cheveux, bijoux, partie corporelle — de ses victimes. Entre ses crimes, sa jouissance passait uniquement par la vision de ses instruments. Et la préparation de son carnage suivant.
David continua à examiner toutes ces preuves qui accablaient Bourne, qui effaçaient l’humain et dévoilaient le monstre. Une bête solitaire, un reclus, qui, pourtant, avait rassuré, appuyé, aimé son psychologue durant son séjour à l’hôpital, au point de se suicider après avoir été cruellement rejeté. Bourne, dont l’aversion profonde pour les femmes n’était plus à démontrer, avait-il pu tomber amoureux de Doffre ? Ce qui fournirait le motif de ces séances… Une espèce d’Emma au masculin, prêt au mensonge le plus saugrenu — cette invention des battements cardiaques — pour approcher l’objet de son amour : Arthur Doffre.
Non… Aucun rapport écrit, aucun livre ne faisaient mention de tendances homosexuelles à son sujet. Jamais d’amies, certes, mais jamais d’amis non plus. Cette hypothèse ne tenait pas la route.
Mais alors, pourquoi ces séances ? Pourquoi ?
« Tout est une question de point de vue, et d’influence », avait dit Doffre avec insistance, le premier soir, avant de parler du Bourreau.
Tout est une question de point de vue… Changer d’angle de vision… Renverser les a priori … Ne pas se laisser influencer par ce qui paraissait évident… Et qu’est-ce qui paraissait évident ? Que Tony Bourne mentait.
Inverser les rôles. Peut-être n’était-ce pas Tony Bourne qui avait entretenu le mensonge. Mais Arthur Doffre.
David s’empara de toutes les fiches cartonnées, s’assit sur le plancher et les plaça en arc de cercle autour de lui, dans l’ordre chronologique. Il vérifia la cohérence des dates, relut consciencieusement les résumés des séances.
L’ensemble se justifiait à la perfection. La thèse de la phobie de Bourne ne présentait pas la moindre faille. Les détails cités par Arthur étaient crédibles, on ne pouvait plus vraisemblables.
Et pourtant, l’un des deux avait menti. Lequel ?
David se dit qu’il avait peut-être manqué un indice dans le journal intime de Doffre, rédigé sur son lit d’hôpital. Il rouvrit donc le vieux cahier d’écolier et le parcourut en partant de l’hypothèse qu’Arthur mentait au sujet de Bourne.
Il tomba alors à nouveau sur les pages où était répété le mot « Mort ». Le coup de blues d’Arthur, ses plaintes et lamentations. Puis les descriptions précises des visites de Bourne, dont l’état de santé, selon Arthur, s’améliorait, alors que lui s’enfonçait. Avec, toujours, cette écriture tremblotante, fracturée. Des « e » grossiers, des « a » malmenés. Bel exploit tout de même, en fin de cahier, pour un droitier contraint d’être gaucher, nota David. Arthur avait vite appris, et écrivait presque à la perfection après trois mois d’hospitalisation.
Le jour n’allait pas tarder à se lever. David se frotta les paupières, s’empara d’une fiche verte, rédigée avant l’accident, et la plaça en vis-à-vis du cahier. L’écriture, sur le bristol, était fluide, sans rature — jolis « a », « e » parfaits, voyelles arrondies. Pas vraiment différente de celle de la fin du cahier, en définitive. Degré d’inclinaison identique, même manière de lier les lettres, longueur de la barre des « p » ou des « t » semblable.
Etrange, car l’une était tracée de la main droite, et l’autre de la main gauche.
David posa soudain le bristol et mima, l’index pointé devant lui, l’écriture de la lettre « t ». Ce geste, il le répéta cinq fois d’affilée.
Le bras du « t », que le droitier trace de gauche à droite.
Il avala sa salive.
Son regard se porta à nouveau sur le papier cartonné vert. Puis sur le cahier.
Son doigt se mit à trembler.
Il venait d’avoir la certitude d’une chose : c’était Arthur qui mentait.
Sur les bristols vert pomme, Doffre avait tracé ses barres de « t » de droite à gauche, comme le font les gauchers, comme il l’avait fait sur son journal intime, à l’hôpital. Le sens du tracé se devinait à l’infime point d’encre initial, abandonné à droite par la plume. Il en allait de même avec les accents, ainsi qu’avec les lettres rondes — les « o », les « a » —, tracées à l’envers.
Tous ces bilans avaient été rédigés de la main gauche.
Et donc, après l’accident.
Dès sa sortie d’hôpital, avant que les flics ne débarquent chez lui, Arthur avait pris sa plus belle plume, inventé une phobie au Bourreau 125 et rédigé brièvement ces dizaines de bilans, dont les derniers se limitaient à de simples flèches de tendance — sûrement par manque de temps. Une hallucinante histoire de souffle au cœur apportant une explication aux tatouages sur les crânes des enfants. Et légitimant ainsi leurs rendez-vous au cabinet, dont la police avait pris connaissance lorsqu’elle s’était intéressée aux mouvements sur le compte bancaire de Bourne, après son décès.
Aux yeux des flics, Bourne consultait pour soigner sa phobie.
Mais en réalité, Doffre et Bourne ne s’étaient pas rencontrés pour un quelconque problème psychologique.
David y était presque, il le sentait.
L’influence… L’arum, la tache verte abdominale, la scie électrique…
Et si Doffre s’était servi de Tony Bourne ? S’il l’avait guidé dans ses actes, lui avait indiqué la manière de procéder, de progresser dans ses crimes ? Et si ces deux-là avaient travaillé ensemble, dans un but commun : le meurtre ?
Arthur Doffre avait-il fabriqué le Bourreau ? Et Arthur Doffre s’en était-il débarrassé par la suite, le forçant à se suicider grâce à l’influence qu’il exerçait sur lui ? Parce que, immobilisé sur son lit d’hôpital, il se sentait lui-même déjà mort ?
Читать дальше