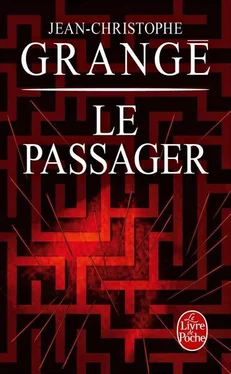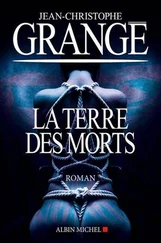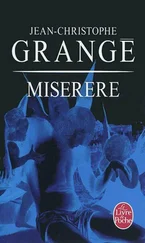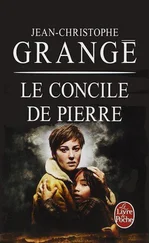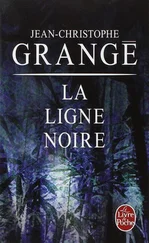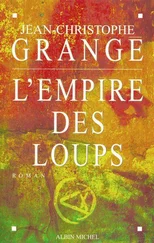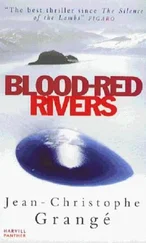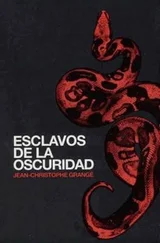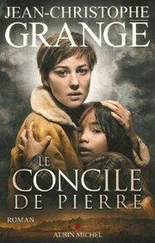Il parvint, enfin, à extraire les images.
Il fut terrassé par ce qu’il voyait.
Dans le liquide amniotique, il n’y avait pas un, mais deux fœtus.
Deux embryons face à face, poings serrés. Deux jumeaux en chiens de fusil, qui s’observaient dans le silence des eaux prénatales.
Les jumeaux à naître de Francyzska et Andrzej Kubiela.
Une terreur brûlante coula en lui comme d’un robinet ouvert. Il saisit les autres échographies. Trois mois. Quatre mois puis cinq… Au fil des images, une anomalie apparaissait. Les fœtus n’évoluaient pas de la même façon. Un des deux était plus imposant que l’autre.
Aussitôt, Kubiela s’identifia au plus petit qui lui paraissait reculer avec crainte, face à son jumeau plus fort.
Une vérité éclata sous son crâne. Le dominant était son frère caché. Un enfant qui avait été écarté de la famille Kubiela pour une raison qu’il ne pouvait encore imaginer. L’idée monta, s’amplifia, se dilata dans sa tête au point de tout occulter.
Théorie.
Il avait été le jumeau dominé au fond du ventre de sa mère.
Mais il avait été choisi par ses parents pour jouer le rôle de fils unique.
L’autre avait été rejeté, oublié, renié.
Et il revenait aujourd’hui des limbes pour se venger.
Pour lui faire endosser la responsabilité des meurtres qu’il commettait.
Le musée de la photographie contemporaine de Marne-la-Vallée prenait place dans un solide bâtiment en briques du XIX e siècle, sans doute une ancienne manufacture. Un de ces lieux où des ouvriers avaient sué sang et eau et qui étaient aujourd’hui recyclés en ateliers branchés où des hommes « faisaient de l’art ». Des musées d’art contemporain, des salles de concerts, des espaces d’expression corporelle…
Anaïs méprisait ce genre d’endroits mais cette bâtisse avait de la gueule. Sur la façade, des frontons, des ornements, des châssis plus clairs donnaient à l’ensemble une noblesse artisanale. Des décorations en faïence lui conféraient même un petit air de station maritime comme celle qu’on voit sur le Bosphore à Istanbul.
Elle n’avait eu aucun mal à fausser compagnie aux sbires de Solinas. À 15 heures, après leur avoir donné des consignes concernant l’enquête sur Medina Malaoui, elle avait fait mine d’aller chercher un autre café puis avait pris l’ascenseur. Tout simplement. Elle avait un badge, les clés d’une voiture. Il lui avait suffi d’actionner la télécommande pour trouver le véhicule. L’adrénaline suppléait à son épuisement.
Elle n’avait pas d’illusions sur le boulot mené par les cerbères. Pas grave. Dans sa petite tête obstinée, elle misait tout sur sa piste des daguerréotypes.
À l’intérieur, une grande pièce d’un seul tenant de plus de 300 mètres carrés, au plancher de bois et aux piliers vernis, sentait bon la sciure, la colle et la peinture fraîche. Une exposition se mettait en place. C’était précisément cette exposition qui l’intéressait : celle d’un artiste-photographe, Marc Simonis, qui occupait le poste de président de la fondation de Daguerréotypie. L’ouverture était pour le lendemain. Elle espérait tomber sur l’artiste en plein accrochage de ses œuvres.
Quand elle aperçut un gros homme engueulant des ouvriers indifférents, à genoux dans la sciure ou debout sur des escabeaux, elle sut qu’elle avait trouvé sa cible. Elle marcha vers lui à pas lents afin de lui laisser le temps d’achever sa tirade. Du coin de l’œil, elle repéra les cadres déjà fixés. Elle s’arrêta pour mieux les voir. Les daguerréotypes avaient une particularité qu’elle n’avait pu capter dans les livres de reproductions : c’étaient des miroirs. Des surfaces polies, argentées ou dorées, réfléchissantes. Cette singularité devait plaire au tueur. En admirant son œuvre — son crime —, il se contemplait lui-même.
Elle retrouvait aussi les singularités des illustrations, mais renforcées ici par la clarté naturelle. Ombre et lumière s’y mélangeaient en un clair-obscur tamisé. L’image était rectangulaire mais la partie éclairée plutôt ovale, comme rongée par une brume grisâtre. On y retrouvait le charme des images des films muets, vacillantes, tremblantes. Le centre éclatant, d’une précision aiguë, faisait presque mal aux yeux. Il avait la violence d’une coupure.
Simonis prenait des portraits contemporains. Des musiciens, des acrobates, mais aussi des traders, des secrétaires, des agents immobiliers — sanglés dans leur costume moderne, saisis dans une lumière qui paraissait jaillir du XIX e siècle. L’effet était contradictoire : on avait tout à coup l’impression d’être projeté dans un futur non défini où le temps présent serait déjà une époque révolue, vieille de plus d’un siècle.
— Qu’est-ce que vous cherchez, vous ?
Le gros photographe se tenait devant elle, l’air furieux. Elle réalisa qu’elle n’avait pas de carte de flic. Il y eut un moment d’incertitude, durant lequel elle détailla le bonhomme. Il mesurait plus de 1,90 mètre et dépassait largement le cap des 110 kilos. Un géant qui s’était laissé vivre et qui, à la cinquantaine, évoquait plus une montagne de graisse qu’une stèle de marbre. Il portait un pull à col roulé noir et un jean énorme qui ressemblait plus à un sac à patates. Elle devinait la raison du col roulé : cacher son goitre de crapaud.
Simonis carra ses poings sur ses hanches :
— Vous ne voulez pas répondre ?
In extremis, elle trouva la force de sourire :
— Excusez-moi. Je m’appelle Anaïs Chatelet. Je suis capitaine de police.
Effet d’annonce garanti. L’homme se raidit et déglutit. Elle put voir son double menton se gonfler puis s’aplatir comme un monstrueux boa avalant une gazelle.
— Ne vous inquiétez pas, fit-elle. Je cherche seulement quelques informations sur la technique du daguerréotype.
Simonis se détendit. Ses épaules retombèrent. Son goitre se mit au repos. Haussant la voix pour couvrir le bruit des ponceuses et des marteaux, il se lança dans un discours technique qu’elle n’écouta pas. Mentalement, elle lui accorda environ cinq minutes de déblatérations avant d’entrer dans le vif du sujet.
Pendant qu’il parlait, elle pesait le pour et le contre. Pouvait-il être l’assassin ? Il avait la puissance mais certainement pas la rapidité. Elle le voyait bien scier la tête d’un taureau ou émasculer un clochard mais… Les cinq minutes étaient passées.
— Excusez-moi, le coupa-t-elle. À votre avis, combien y a-t-il de daguerréotypistes en France ?
— Nous ne sommes que quelques dizaines.
— Combien exactement ?
— Une quarantaine.
— Et en Île-de-France ?
— Une vingtaine, je pense.
— Je pourrais avoir la liste ?
L’obèse se pencha vers elle. Il la dépassait de vingt bons centimètres :
— Pour quoi faire ?
— Vous avez vu assez de films pour savoir que les flics posent les questions. Ils n’y répondent jamais.
Il agita sa main grasse :
— Excusez-moi mais… vous avez un mandat, quelque chose ?
— Les mandats, c’est bon pour la poste. Si vous voulez parler d’une commission rogatoire signée par un juge, je ne l’ai pas sur moi. Je peux revenir avec mais ça me fera perdre un temps précieux et je vous jure que je vous ferai payer chaque minute gaspillée.
L’homme déglutit à nouveau. Le boa digérait encore une fois. Il fit un geste vague vers le fond de la salle.
— Il faudrait que je retourne dans mon bureau pour imprimer cette liste.
— Allons-y.
Simonis eut un regard circulaire : les ouvriers travaillaient sans lui prêter la moindre attention. Des ponceuses ponçaient, des perceuses perçaient. Une odeur de métal chauffé à blanc tournait dans l’air. Il paraissait désolé d’abandonner son chantier mais se dirigea vers un bureau vitré au bout de la pièce. Anaïs lui emboîta le pas.
Читать дальше