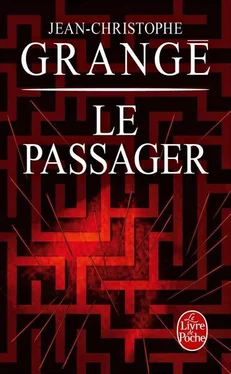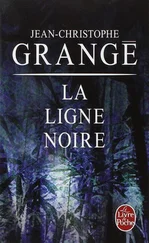Il passa au deuxième carton — celui qui concernait la famille Kubiela. Les documents ne lui apprirent que deux éléments d’importance. Le premier, c’était que sa mère, Francyzska, ne l’avait pas élevé. Elle avait été internée dans un institut spécialisé en 1973, deux ans après sa propre naissance. Elle n’avait plus jamais quitté les asiles. Elle appartenait au triste club des chroniques. D’après les documents, elle était toujours vivante, au Centre hospitalier Philippe-Pinel à Amiens. À cette idée, Kubiela n’éprouvait aucune émotion. Avec la mémoire, on lui avait aussi arraché les réseaux de sa sensibilité.
Il passa aux données techniques. Les dossiers médicaux de Francyzska évoquaient à la fois une « schizophrénie aiguë », une « bipolarité récurrente », des « troubles de l’angoisse ». Les diagnostics étaient variés et même contradictoires. Il parcourut en diagonale les bilans, les prescriptions, les HDT, les Hospitalisations à la demande d’un tiers. Chaque fois, c’était son père, Andrzej, qui avait signé la demande. Jusqu’en 2000. Après cette date, c’était lui-même, François Kubiela, qui avait rempli la paperasse.
Ce dernier fait s’expliquait par la deuxième information majeure du dossier : son père était mort en mars 1999, à 62 ans. Le certificat de décès évoquait un accident chez des amis — Kubiela Senior était tombé d’une toiture alors qu’il installait une gouttière. Entre les lignes : le Polonais était sans doute mort sur un chantier au noir mais ses commanditaires avaient prétendu être des amis pour faire jouer les assurances et éviter les emmerdes avec les flics. Requiescat in pace, papa …
Kubiela trouva une photo. Ses parents à leur arrivée en France, en 1967, sur l’esplanade du Trocadéro. Deux hippies, cheveux longs et pattes d’ef, avec quelque chose de paysan, de mal dégrossi, en droite provenance de leur Silésie natale. Francyzska était une frêle jeune femme, blonde et diaphane. Elle ressemblait aux créatures de David Hamilton. Andrzej répondait à un autre cliché : le bûcheron polonais. Tignasse jusqu’aux épaules, barbe de Raspoutine, sourcils à l’avenant. Sa carrure de colosse était serrée dans une veste en velours élimé. Les deux exilés se tenaient amoureusement par les épaules, fin prêts pour leur destin français.
Les autres documents ne disaient pas grand-chose sur leur vie quotidienne, excepté qu’Andrzej Kubiela était le roi des cumulards. Venu en France en qualité de réfugié politique, il avait été embauché dans une entreprise de travaux publics. En 1969, il avait eu un premier accident professionnel qui lui avait permis de toucher une pension d’invalidité. Quelques années plus tard, il avait commencé à encaisser une allocation au nom de sa femme handicapée mentale. Il avait également obtenu plusieurs aides de l’État et d’autres subventions — Andrzej vivait sous perfusion sociale, alors même qu’il n’avait sans doute jamais cessé de travailler sur des chantiers.
Le psychiatre passa aux documents qui le concernaient directement. Scolarité primaire et secondaire dans des établissements publics de Pantin. Faculté de médecine et internat à Paris. Pas de petits boulots à côté de ses études. François avait grandi comme un fils à papa. Andrzej la magouille avait tout misé sur son fils et François le lui rendait bien. Du primaire à sa thèse de doctorat, il avait toujours obtenu les meilleures notes.
Au fond du carton, il tomba sur une boîte plate de grande dimension qui avait dû contenir, des années auparavant, une tarte ou une galette des rois. Des photographies et des coupures de presse y étaient répertoriées dans un ordre antéchronologique. Les premières enveloppes concernaient les années 2000. Articles scientifiques, comptes rendus sur ses travaux, ménageant parfois un espace pour une photo. Kubiela s’observa sur papier imprimé : toujours cet air de savant à la coule, tignasse noire et sourire enjôleur…
Dans les enveloppes suivantes, il trouva seulement des photos. 1999 offrait les images d’un Kubiela visiblement éméché, entouré d’autres gaillards dans le même état. Une fête quelconque, organisée en l’honneur de son internat réussi. 1992 proposait un Kubiela plus jeune encore, souriant, solitaire. Son cartable sous le bras, il se tenait devant l’université de médecine de la Pitié-Salpêtrière. Il portait un maillot Lacoste, un jean 501, des mocassins de bateau. Un jeune étudiant, bien propre sur lui, qui avait rompu les amarres avec ses origines ouvrières.
1988. 17 ans, cette fois avec son père. L’homme dépassait d’une tête son fils et portait maintenant une coiffure et une barbe disciplinées. Les deux personnages souriaient à l’objectif, visiblement complices et heureux.
Kubiela essuya ses larmes et jura. Ce n’était pas l’effet de la mélancolie. Il pleurait de rage. De déception. Même devant ces photos intimes, il ne se souvenait de rien. Depuis sa fuite, deux semaines auparavant, il avait affronté des tueurs, traversé des identités, traqué un assassin, se demandant toujours s’il ne s’agissait pas de lui-même. Tout cela, il l’avait fait en s’accrochant à un espoir : quand il découvrirait sa véritable identité, tout lui reviendrait.
Il se trompait. Il s’était toujours trompé. Il était un passager éternel. Il n’y avait pas de destination finale. Il avait atteint son identité première mais ce but n’était encore qu’une étape. Bientôt, il perdrait de nouveau la mémoire. Il se bricolerait une nouvelle personnalité puis comprendrait qu’il n’était pas celui qu’il prétendait être. Alors l’enquête reprendrait, toujours avec cet espoir de retrouver son véritable « moi ».
Mais ce moi n’existait plus.
Il l’avait perdu pour toujours.
Il passa aux photos d’enfance. François, 13 ans, en kimono de judo, souriant à la caméra, sans parvenir à se débarrasser de cet air de solitude et de détresse vague déjà présent sur les autres photos. Maintenant, cette tristesse remplissait tout le visage. Détail : ses cheveux n’étaient pas encore bruns mais blonds. Le petit Kubiela avait changé de couleur de cheveux avec la puberté.
1979. François, âgé de huit ans, à la foire du Trône. Chemise aux épaules larges, pantalon serré aux chevilles, chaussettes blanches : un pur uniforme eighties. Sur fond de manèges et d’attractions, le petit garçon souriait encore, mains dans les poches. Toujours ce sourire discret, un peu triste, qui ne voulait pas déranger.
1973. Cette fois, il se tenait entre les bras de sa mère — sans doute l’une des dernières photos avant que la femme ne soit internée. On ne voyait pas le visage de Francyzska qui baissait la tête, mais le regard fixe de l’enfant, âgé de deux ans, irradiait l’image. Au fond de ses iris, on percevait déjà la même tristesse éblouie, solaire.
Kubiela leva les yeux. La pluie avait cessé. À travers les fenêtres encore liquides, le terrain vague s’égouttait. Des filets d’eau, le long des pneus, des clapiers, des débris, s’étoilaient et décochaient des étincelles. Quelque part, invisible, le soleil lançait ses rayons. Cette vision aurait dû lui remonter le moral mais elle l’enfonçait plutôt dans sa mélancolie. Pourquoi cet air de chien battu sur les photos ? D’où venait sa détresse ? L’ombre de la folie de sa mère ?
Il restait une enveloppe de grande dimension, frappée d’un tampon d’hôpital. Peut-être l’explication. Une pathologie, une anémie quelconque dans son enfance. Il ouvrit l’enveloppe Kraft et ne réussit pas à sortir tout à fait les documents, collés par l’humidité.
Des clichés médicaux.
Il tira encore. Des échographies. Celles du ventre de sa mère, captées en mai 1971 — il pouvait voir la date dans le coin du premier tirage. On était au tout début de cet usage en obstétrique.
Читать дальше