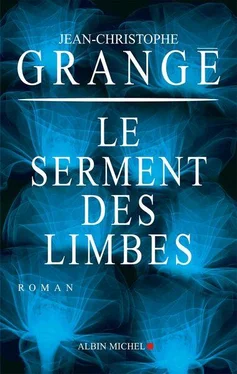J’opérai une large boucle et revins vers lui, par l’arrière. Je n’étais plus qu’à dix mètres. Il dévissait le silencieux de son fusil. Le tube devait être brûlant. Il ne cessait de le saisir puis de le lâcher, comme lorsqu’on veut attraper un objet trop chaud.
Trois mètres. Un mètre… À cet instant, mû par un sixième sens, il tourna la tête. Je ne le laissai pas achever son geste. Je plongeai sur lui, enserrant sa gorge du bras gauche, pointant mon couteau sous son menton :
— Lâche ton fusil, haletai-je. Sinon, je te jure que je finis le boulot.
Il s’immobilisa, toujours à genoux. Arc-bouté sur son dos, j’avais l’impression d’étrangler un bœuf. J’enfonçai ma lame d’un bon centimètre. Sa graisse épousa le mouvement, sans saigner :
— Lâche-le, putain… Je ne plaisante pas !
Il hésita encore, puis lança l’arme à un mètre devant lui. Pas vraiment une distance de sûreté. Je soufflai :
— Maintenant, tu vas te retourner doucement et…
Un éclair dans sa main, un mouvement en arc, sur la droite. J’esquivai de côté. Le couteau commando siffla dans le vide. Je plantai mon genou dans ses reins, le forçant à se cambrer. Il abaissa à nouveau sa lame pour me toucher par la gauche. J’évitai encore le coup, les jambes pliées, les talons plantés dans le sol.
Il tenta de se retourner. Sa puissance était hallucinante. Nouveau coup, par le haut. Cette fois, il m’écorcha l’épaule. Je gémis et, d’un mouvement réflexe, plantai mon arme sous son oreille droite. Jusqu’à la garde. Un éclair de sang artériel zébra le ciel.
Le mastodonte se pencha en avant, se balança d’un genou sur l’autre. Je suivis le mouvement sans lâcher mon couteau. J’opérais un geste de va-et-vient serré, exactement comme un boucher tranchant la tête d’un bœuf. Le sang me poissait les doigts, surchauffait ma peau déjà brûlante. Ses chairs se refermaient sur mon poignet en un baiser abominable, une emprise de mollusque sous-marin.
Dans un sursaut, il posa un talon sur le sol et parvint à se relever pour retomber en arrière. Ses cent cinquante kilos s’écrasèrent sur moi. Mon souffle se bloqua net.
Je perdis conscience une seconde, me réveillai. Je n’avais pas lâché mon arme. Le poids lourd m’enfonçait dans la boue, battant des jambes et des bras, à la manière d’un poulpe géant. Son sang coulait et me submergeait.
Je m’asphyxiais. Dans quelques secondes, je serais dans le cirage, et ce serait la fin, pour moi aussi. Je n’avais toujours pas atteint mon putain d’objectif — remonter dans les chairs jusqu’à l’oreille gauche. J’attrapai à deux mains la garde de mon couteau pour achever le travail.
Puis, je lâchai tout et poussai avec mon dos, mes coudes, en un ultime effort pour me dégager. Enfin, le gros bascula sur le côté. Il leva son bras pour m’atteindre encore une fois mais sa main ne tenait plus rien. Il roula deux fois sur lui-même, dévalant la pente sur plusieurs mètres, englué dans son sang et les plis de sa cape de pluie.
Je m’extirpai de la boue, m’adossai à l’arbre, reprenant mon souffle. Poumons broyés, gorge bloquée, des étoiles plein le crâne. Soudain, je sentis un violent spasme monter de mes tripes. Je fis volte-face et vomis au pied du tronc. Mon sang battait à me fendre les tempes. Mon visage était enduit d’un vernis glacé — un vernis de mort.
Je restai prostré, à genoux, de longues minutes. Étranger à tout. Enfin, je me relevai et fis face au cadavre. Il était sur le dos, les bras en croix, cinq mètres plus bas. Capuche relevée, dévoilant une grosse face cernée d’une barbe courte. La plaie à la gorge lui dessinait un deuxième collier, noir et atroce. Mon couteau s’était brisé dans la chute.
Sous les battements de mon crâne, une idée émergea lentement.
Celui-là aussi, je le connaissais.
Richard Moraz, premier suspect dans l’affaire Manon Simonis.
L’homme aux mots croisés. « On se reverra », lui avais-je dit dans la taverne bavaroise. C’était chose faite. À tous ses doigts, des bagues. Celles qui m’avaient envoyé des signaux sous le soleil.
Je remarquai, à son majeur gauche, une chevalière particulière.
D’un coup, tout se mit en place : c’était à ce doigt que j’avais vu le sigle de Cazeviel. Le fer de forçat relié à une chaîne, barré d’une tige horizontale. Je m’approchai et observai la bague. Exactement le même symbole, en reliefs d’or.
Je relevai la manche droite du cadavre, à titre de vérification — le bras portait un bandage. Je l’arrachai : la plaie était nette, longitudinale, d’environ dix centimètres. C’était bien l’obèse qui s’était pris le couteau de Cazeviel, dans la cohue des musées du Vatican.
Je venais de régler la deuxième partie de mon problème.
Celui qui avait commencé dans le col du Simplon.
Paysage brûlé par l’hiver. Arbres nus, calcinés. Champs de terre noire, retournés comme des tombes. Ciel blanc, irradiant une lumière aiguë, radioactive.
Sur cette toile de fond sinistre, je me reculai et contemplai l’arbre au sommet du coteau, qui se dressait en toute solitude. Prisonnier de la terre, tendu vers le ciel, pétrifié de froid. Je songeai à ma propre situation. Un mort au sol, la vérité au-dessus, et moi entre les deux.
Depuis un moment déjà, je ne menais plus l’enquête.
C’était elle qui m’emmenait droit en enfer.
Je décidai de prier. Pour Moraz, sans doute lié au secret des Sans-Lumière et à l’affaire de Manon Simonis, et pour Bucholz, victime innocente dont la malédiction, jusqu’au bout, s’était appelée Agostina Gedda.
Puis je descendis la pente, d’un pas mal assuré. Le désert qui m’entourait n’avait qu’un seul avantage : pas un témoin en vue. Je rentrai chez Bucholz et attrapai mon imperméable resté dans le vestibule. Malgré moi, je lançai un coup d’œil dans la pièce ravagée, où s’étendait le cadavre du médecin. Je reconstituai, mentalement, mes déplacements dans la maison afin de vérifier que je n’avais pas laissé la moindre empreinte.
Je refermai la porte d’entrée, la main dans ma manche.
Je plaçai vingt kilomètres entre moi et le lieu du massacre, puis m’arrêtai dans un sous-bois. Là, j’attrapai une chemise propre dans mon sac et me changeai. Mon épaule m’élançait mais la blessure était superficielle. J’entassai la chemise, la cravate et la veste collées d’hémoglobine avec le couteau brisé que j’avais récupéré, puis j’allumai le tout. Le feu prit avec difficulté. Je grillai une Camel au passage. Lorsqu’il ne resta plus que quelques cendres et l’os du couteau, je creusai un trou et enterrai les vestiges de mon crime.
Je revins à la voiture et regardai l’heure : 17 heures. Je décidai de trouver un hôtel à Pau. Du sommeil et de l’oubli : mon seul horizon à court terme.
Je fonçai vers Lourdes puis me dirigeai vers le nord, par la D 940, pour emprunter l’autoroute — la Pyrénéenne. En chemin, j’appelai les gendarmes d’une cabine téléphonique, histoire de tenir leur nécro à jour.
Au volant de ma voiture, je murmurai une nouvelle prière. Pour moi cette fois. Le Miserere , psaume 51 de David. Ma tête fracassée était trouée comme une éponge et je ne parvenais pas à me souvenir du texte complet. Bientôt, l’enquête, avec ses morts, ses questions, ses béances, revint m’agripper l’esprit. Je songeai à Stéphane Sarrazin. Je n’avais pas eu de contact avec lui depuis Catane, et il m’avait laissé trois messages la veille.
J’aurais dû l’appeler dès la découverte de l’identité de Cazeviel. N’était-il pas le mieux placé pour exhumer le passé du tueur ? Avec Moraz dans la danse, le gendarme avait du pain sur la planche. Je composai son numéro. Répondeur. Je ne laissai pas de message, mû par un réflexe de prudence, et revins à mes propres cogitations.
Читать дальше